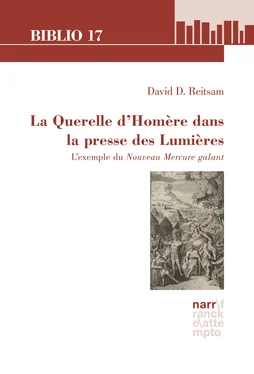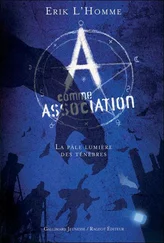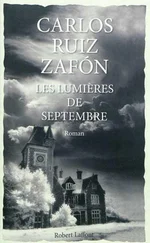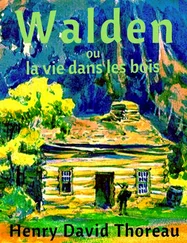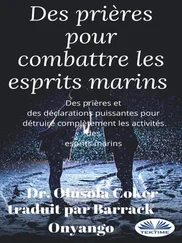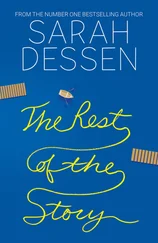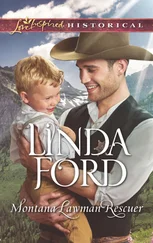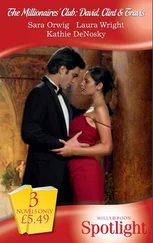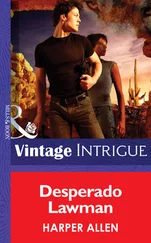David D. Reitsam - La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières
Здесь есть возможность читать онлайн «David D. Reitsam - La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mais nous avons encore deux choses qui nous sont partiuclieres, & qui contribuent autant que tout le reste à la corruption du goust. L’une, ce sont ces spectacles licentieux qui combattent directement la Religion & les mœurs […]. L’autre, ce sont ces Ouvrages fades & frivoles, dont j’ai parlé dans la Préface sur l’Iliade, ces faux Poëmes Epiques, ces Romans insensez que l’Ignorance & l’Amour ont produits15.
Quelques mois plus tard, l’idée que les romans s’adressent aux femmes, et spécialement aux jeunes femmes, est exprimée d’une manière dramatique : dans le Nouveau Mercure galant d’août 1715, Le Fèvre de Fontenay publie la « Scene d’Arlequin, Deffenseur d’Homere » sans mentionner toutefois son auteur, Louis Fuzelier, LouisFuzelier16 : afin de distraire Grognardin, le père d’Angélique, qui s’oppose à l’amour de sa fille avec Leandre, Arlequin organise une mascarade et se présente en tant que « Bouquinides […] soûteneur d’Homere17 » à Grognardin. Il est accompagné par quatre serviteurs qui « apportent deux cabinets de Livres, ornez de deux grosses inscriptions. A l’un on lit ANCIENS, & à l’autre MODERNES18 ». Ce qui peut sembler paradoxal – un défenseur d’Homère qui voyage avec des livres des Modernes – est rapidement résolu : Leandre se cache dans la boîte « MODERNES » tandis que l’autre cabinet est rempli de livres d’auteurs gréco-romains. Et pendant qu’Arlequin conduit Angélique vers son amant caché, il entraîne le père vers les auteurs de l’Antiquité19.
Si l’intrigue de cette comédie n’est guère novatrice et rappelle les pièces de Molière [Moliere]Molière, la mise en scène retient notre attention. Pour le déroulement de l’action, il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de boîtes « MODERNES » et « ANCIENS ». Par conséquent, il faut supposer que Jean Fuzelier, LouisFuzelier tient à s’inscrire dans la Querelle d’Homère et à soutenir la cause des Modernes. Tout comme l’auteur de la « Lettre curieuse & tres-amusante » d’avril 1715, il n’estime pas que les jeunes femmes doivent lire les auteurs anciens. Selon lui, les livres qui correspondent le plus à leur goût sont les nouvelles galantes ou les romans. En revanche, les auteurs anciens sont destinés aux personnes moins habituées aux idéaux sociaux que sont la galanterie et l’honnêteté – le prénom du père d’Angélique paraît relativement explicite. En le nommant Grognardin, Fuzelier, LouisFuzelier a probablement pensé au verbe « grogner » ou à l’adjectif « grogneux ». Voici comment Antoine Furetière, AntoineFuretière les définit :
GROGNER. v. n. qui se dit au propre du cri des pourceaux. On le dit par extension des hommes, quand ils font un bruit & murmure sourd, & qui n’est pas articulé, lors qu’ils sont mescontens, ce qui imite assez le cri du pourceau. […] GROGNEUX, EUSE. adj. Celuy qui grogne, qui murmure tout bas, qui fait la mine & qui tesmoigne du chagrin20.
De cette manière, Fuzelier, LouisFuzelier distingue clairement entre le public ordinaire – apparemment quelque peu misanthrope – des auteurs anciens et celui des ouvrages contemporains. En outre, il signale qu’une jeune femme est le prototype de la lectrice des romans et nouvelles galantes.
Ainsi, force est de constater que les contributeurs du Nouveau Mercure galant ne considèrent pas les écrivains grecs et romains comme des auteurs indispensables aux femmes. Selon eux, la lecture qui correspond le mieux aux dames de la haute société est celle des romans et des nouvelles galantes. Ces réflexions sont d’ailleurs confirmées par les nombreux textes appartenant à ce genre publiés dans la revue. Cette nette préférence pour les romans n’empêche cependant pas quelques auteurs d’admettre qu’Anne Dacier excelle dans son domaine et qu’elle est une femme exceptionnelle. Mais, au vu de la perte de vitesse de l’érudition – un aspect qui sera étudié plus précisément dans un autre chapitre –, Dacier ne peut pas devenir un modèle pour les jeunes filles.
Quelques qualités féminines selon le périodique
Une deuxième question attire notre attention. Ci-dessus, il est non seulement devenu évident que les femmes ne sont pas obligées de lire les grands auteurs de l’Antiquité, mais également que d’autres qualités sont plus importantes : il ne faut pas oublier les paroles que le « galant homme » contribuant au Nouveau Mercure galant d’avril 1715 met dans la bouche de sa Moderne : « Nous avons toutes interest à […] applaudir [Anne Dacier], Madame, je voudrois seulement qu’en se saisissant des avantages que les hommes se sont reservez, elle conservât toute la douceur, toute la modestie qui font nostre partage & qui nous siéent bien1. » L’auteur anonyme de ce dialogue probablement fictif s’en prend à la traductrice d’Homère en soulignant des traits de caractères typiquement féminins : la douceur et la modestie – deux qualités féminines centrales au siècle de Louis XIVLouis XIV selon Myriam Dufour-Maître : « Le modèle éthique galant triomphe, fait de naturel, de grâce, de douceur, de délicatesse, d’enjouement, [et] de modestie2. » Et Florian Gelzer confirme qu’il s’agit de traits caractéristiques indispensables qui permettent aux femmes de bien mener une conversation galante et de briller dans la vie sociétale de l’époque3. Ainsi, il n’est pas étonnant que la modestie et la douceur soient défendues dans la revue. En revanche, au vu de l’orientation globale du périodique d’Hardouin Le Fèvre de Fontenay, il est relativement surprenant que de tels passages soient peu présents dans le Nouveau Mercure galant et que peu de contributeurs définissent de manière théorique les qualités typiquement féminines.
Parallèlement, nous pouvons constater que les auteurs qui publient des textes dans la revue ne critiquent pas trop agressivement les vices des femmes. Et, même si quelques auteurs décrivent les défauts du beau sexe, ils le font de manière inoffensive ; il s’agit plus de lieux communs que de dénonciations. La contribution du « galant homme » qui prétend transcrire une discussion entre deux femmes en constitue toujours un bon exemple. Voici le début de leur conversation :
Aprés que chacune d’elle eût donné des loüanges à la beauté de l’autre, & que pour excuser les deffauts de la sienne, elle eût allegué ou supposé quelque legere incommodité, enfin aprés qu’elles eurent épuisé tout ce qu’enseigne le grand art de flatter l’amour propre d’autruy, & de ménager les interêts du sien, j’entendis la plus grande dire à l’autre4.
En résumant ainsi les préliminaires de leur discussion, le contributeur inconnu paraît se moquer des femmes et dénoncer leurs conversations vides de sens : ironiquement, il ne parle pas d’un échange poli ou galant, mais du « grand art de flatter » et sa répétition d’« aprés », respectivement d’« enfin aprés », souligne que ce préambule – à ses yeux – n’ajoute rien au thème central de sa contribution qui est la Querelle d’Homère. D’après lui, il faut donc supporter ce genre de paroles avant de pouvoir parler de choses plus sérieuses. Certes, l’écrivain anonyme est bien moins agressif que Nicolas Boileau, NicolasBoileau dans sa « Satire X », mais il dénonce néanmoins une certaine hypocrisie et des caractères faux ainsi que superficiels5. Malgré l’absence total de sens, le « galant homme » ne se passe pas de ce passage apparemment dénué de signification – au contraire, il l’introduit volontairement dans sa discussion fictive – et semble donc se distancier d’une galanterie qui est réduite à un jeu sociétal où la forme prime sur le contenu.
Un constat similaire s’impose après une relecture de la fin de la conversation qui dérape : « La grande Blonde rougit à ce mot de Dragon ; les tons s’aigrirent, & nos deux Dames commençoient à faire les Déesses6. » Sans aucun doute, en parlant des « Déesses », l’auteur inconnu pense aux divinités païennes de l’ Iliade 7. Or, il ne semble pas critiquer les femmes en soi, mais il paraît préférablement vouloir terminer sa contribution au Nouveau Mercure galant par une allusion aux femmes passionnelles et non pas raisonnables – un lieu commun qui a certainement été compris par les lecteurs de la revue et qui les a peut-être même amusés8.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.