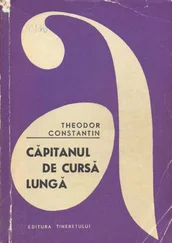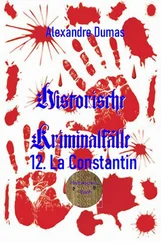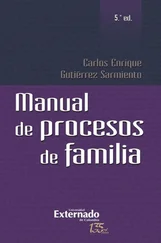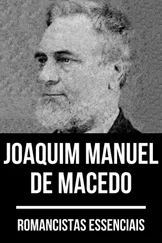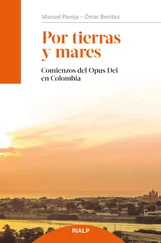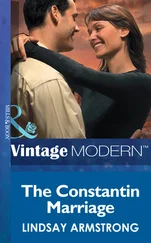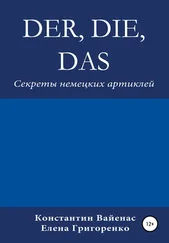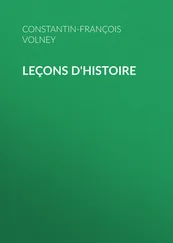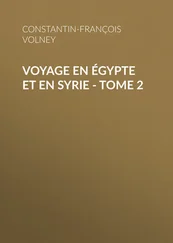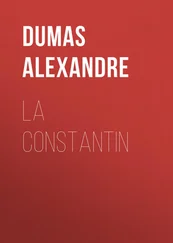Le droit d’être entendu selon l’art. 36 al. 1 LAsi est accordé au requérant après l’audition sommaire. Cependant, l’existence d’éventuels risques au sens de l’interdiction du refoulement prévue par la CR et par la CEDH doit être complètement clarifiée dans ce cadre.
[86]La garantie du droit d’être entendu peut certes en principe être donnée oralement ou par écrit. Sous la forme écrite, cette garantie est toutefois problématique à notre avis lorsque le requérant ne parle aucune des langues officielles. Dans ce cas, celui-ci n’est en effet pas en mesure de profiter du droit d’être entendu même si le contenu du document lui est traduit. Le fait que les œuvres d’entraide offrent des consultations juridiques gratuites ne remplace pas, à notre avis, l’obligation des autorités de garantir le droit d’être entendu sous une forme accessible à son bénéficiaire.
Dans tous les autres cas a lieu une audition ordinaire sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi.
7.2.2 Audition sur les motifs d’asile
7.2.2.1 Généralités
L’audition approfondie permet de déterminer la suite à donner à la procédure d’asile. Cela suppose que les faits déterminants pour la décision – concernant la qualité de réfugié et les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi – doivent être complètement recueillis. En matière de preuve, il est fait application des règles de l’art. 7 LAsi et c’est selon elles que la qualité de réfugié doit au moins être rendue vraisemblable (sur la vraisemblance, voir chap. XII, pt 5).
Le SEM peut charger l’autorité cantonale de l’audition si cette mesure permet d’accélérer sensiblement la procédure (art. 29 al. 4 LAsi).
Les personnes suivantes sont présentes à l’audition sur les motifs d’asile au sens des art. 29 s LAsi : le requérant d’asile, un auditeur du SEM, en règle générale l’interprète prévu d’office – pour autant que le requérant ne s’y oppose pas expressément – et un représentant d’une œuvre d’entraide autorisée (art. 30 al. 1 LAsi). En outre, un secrétaire assiste en règle générale aussi à l’audition pour rédiger le procès-verbal.
Le requérant d’asile peut se faire accompagner d’un mandataire et/ou d’un interprète de son choix (art. 29 al. 2 LAsi). Toutefois, ces personnes ne doivent pas être elles-mêmes des requérants d’asile.
7.2.2.2 Représentant des œuvres d’entraide (ROE)
L’institution de la représentation des œuvres d’entraide est une particularité de la procédure d’asile suisse. Elle existe depuis 1968 et doit contribuer, grâce à l’observation de l’audition des requérants d’asile par des représentants de la société civile, à un déroulement équitable et transparent de la procédure.
[87]Au début de l’audition, le rôle du ROE est expliqué au requérant et il est demandé explicitement à ce dernier s’il accepte la participation du ROE à l’audition. Si le requérant y consent, le ROE observe l’audition, peut poser des questions complémentaires et suggérer d’autres mesures d’instruction comme par exemple une expertise médico-légale pour assurer la preuve de traces de torture, ou une audition complémentaire. Par ailleurs, le ROE peut apporter des objections au procès-verbal par exemple au sujet du climat de l’audition ou de son déroulement. 86Au cours de l’audition, le ROE peut rédiger des notes manuscrites. Ces notes ne seront toutefois remises au requérant ou à son mandataire qu’après la fin de la procédure de première instance (art. 26 al. 2 OA 1). A la fin de l’audition, le ROE confirme sa participation par une signature, non pas sur le procès-verbal, mais sur une feuille séparée sur laquelle il peut apporter ses observations et ses remarques. Le ROE est soumis au secret vis-à-vis des tiers.
Deux heures avant l’audition, le ROE peut consulter les procès-verbaux des auditions précédentes. Cette règle garantit que le ROE ait une idée, avant l’audition, du contexte de la demande d’asile et des motifs de fuite, ce qui lui est indispensable pour remplir son rôle.
Le ROE ne jouit pas des droits de partie à la procédure. 87La présence d’un représentant des œuvres d’entraide est censée renforcer la confiance quant à l’objectivité de l’audition et augmenter la légitimité de la procédure. 88
Cependant, la présence du ROE ne doit pas être considérée comme une règle impérative découlant des garanties du droit d’être entendu. Selon la jurisprudence, l’absence d’une ROE, qui ne découle pas d’un choix du requérant, constitue certes un vice de procédure, mais ne conduit pas impérativement à l’invalidation de l’audition. 89Pour permettre aux œuvres d’entraide d’assurer leur rôle dans la procédure, les dates des auditions doivent leur être communiquées à temps (art. 30 al. 3 LAsi) ; « à temps » signifie en règle générale cinq jours ouvrables avant l’audition (art. 25 al. 1 OA 1). Si la convocation parvient à temps aux œuvres d’entraide et que celles-ci n’y donnent pas suite ou ne comparaissent pas en temps voulu, l’audition déploie son plein effet juridique malgré l’absence du ROE (art. 30 al. 3 LAsi et art. 25 OA 1).
[88] 7.2.2.3 Le déroulement de l’audition
L’audition se déroule en règle générale selon un schéma de questions que l’on trouve en annexe de la directive du SEM relative à la procédure d’asile (non accessible au public) et qui comprend les points suivants :
Introduction : salutations, présentation des personnes présentes, explications sur les devoirs du requérant durant la procédure (voir chap. XII, pt 3).
Questions préliminaires : données personnelles (relations de famille et de parenté à l’étranger et en Suisse, cursus scolaire, indications concernant le service militaire, l’activité professionnelle, les séjours à l’étranger et les mandataires éventuellement consultés) pour autant que la première audition n’ait pas été complète sur ces points ou que des questions importantes pour la décision restent ouvertes.
Motifs d’asile : le requérant est d’abord invité à présenter spontanément ses motifs ; suit, au moyen de questions précises, une clarification des faits présentés : précisions concrètes, dissipation des malentendus, chronologie des événements, localisation et circonstances des principaux événements, questions sur les pays et questions spécifiques au cas particulier, approfondissement de certains éléments (activité politique, méthodes de persécution, explications relatives aux divers moyens de preuve, etc.). Il est ensuite donné une nouvelle fois au requérant l’occasion de dissiper les malentendus. En vertu de la maxime inquisitoire et de la garantie du droit du requérant d’être entendu, l’autorité a le devoir de procéder à une clarification complète des faits en ce qui concerne la qualité de réfugié et les obstacles à l’exécution du renvoi (voir chap. XII, pt 2).
Fin de la clarification des faits : à la fin, l’autorité pose des questions pour clarifier les circonstances du départ. Elle invite, le cas échéant, le requérant à se prononcer sur les contradictions importantes contenues dans son exposé des faits, puis elle lui demande s’il a pu aborder tous les éléments importants à l’appui de sa demande d’asile.
Information sur la suite de la procédure et sur le droit d’être entendu concernant le renvoi : le requérant est informé sur la suite de la procédure ainsi que sur les conséquences juridiques possibles. Il lui est donné l’occasion de se prononcer sur un éventuel renvoi et il a la possibilité d’indiquer tous les motifs qui n’ont pas encore été invoqués, mais qui lui paraissent importants (par exemple des motifs d’ordre humanitaire qui s’opposeraient au renvoi tels que des motifs médicaux). Il est enfin informé des autres devoirs de collaborer, en particulier de son devoir de se tenir à disposition des autorités pendant la procédure et d’annoncer ses changements d’adresse.
Читать дальше