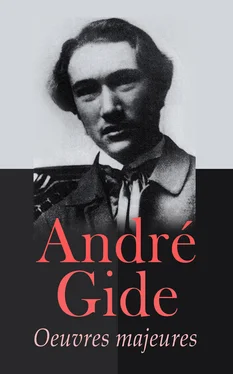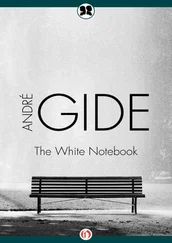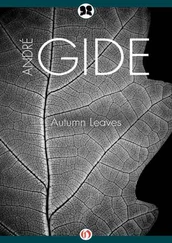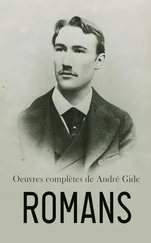— Monsieur ne voulait pas garder chez lui un sale ivrogne, qui débauchait les meilleurs ouvriers...
— Je sais mieux que vous ceux que je désire garder.
— Un galvaudeur ! On ne sait même pas d’où qu’il vient. Dans le pays, ça ne faisait pas bon effet... Quand, une nuit, il aurait mis le feu à la grange, Monsieur aurait peut-être été content.
— Mais enfin cela me regarde, et la ferme est à moi, je suppose ; j’entends la diriger comme il me plaît. À l’avenir, vous voudrez bien me faire part de vos motifs, avant d’exécuter personne.
Bocage, je l’ai dit, m’avait connu tout enfant ; quelque blessant que fût le ton de mes paroles, il m’aimait trop pour beaucoup s’en fâcher. Et même il ne me prit pas suffisamment au sérieux. Le paysan normand demeure trop souvent sans créance pour ce dont il ne pénètre pas le mobile, c’est-à-dire pour ce que ne conduit pas l’intérêt. Bocage considérait simplement comme une lubie cette querelle.
Pourtant je ne voulus pas rompre l’entretien sur un blâme, et, sentant que j’avais été trop vif, je cherchais ce que je pourrais ajouter.
— Votre fils Charles ne doit-il pas bientôt revenir ? me décidai-je à demander après un instant de silence.
— Je pensais que Monsieur l’avait oublié, à voir comme il s’inquiétait peu après lui, dit Bocage encore blessé.
— Moi, l’oublier ! Bocage, et comment le pourrais-je, après tout ce que nous avons fait ensemble l’an passé ? Je compte même beaucoup sur lui pour les fermes...
— Monsieur est bien bon. Charles doit revenir dans huit jours.
— Allons, j’en suis heureux, Bocage, — et je le congédiai.
Bocage avait presque raison : je n’avais certes pas oublié Charles, mais je ne me souciais plus de lui que fort peu. Comment expliquer qu’après une camaraderie si fougueuse, je ne sentisse plus à son égard qu’une chagrine incuriosité ? C’est que mes occupations et mes goûts n’étaient plus ceux de l’an passé. Mes deux fermes, il me fallait me l’avouer, ne m’intéressaient plus autant que les gens que j’y employais ; et pour les fréquenter, la présence de Charles allait être gênante. Il était bien trop raisonnable et se faisait trop respecter. Donc, malgré la vive émotion qu’éveillait en moi son souvenir, je voyais approcher son retour avec crainte.
Il revint. — Ah ! que j’avais raison de craindre et que Ménalque faisait bien de renier tout souvenir ! — Je vis entrer, à la place de Charles, un absurde Monsieur, coiffé d’un ridicule chapeau melon. Dieu ! qu’il était changé ! Gêné, contraint, je tâchai pourtant de ne pas répondre avec trop de froideur à la joie qu’il montrait de me revoir ; mais même cette joie me déplut ; elle était gauche et ne me parut pas sincère. Je l’avais reçu dans le salon, et, comme il était tard, je ne distinguais pas bien son visage ; mais quand on apporta la lampe, je vis avec dégoût qu’il avait laissé pousser ses favoris.
L’entretien, ce soir-là, fut plutôt morne ; puis, comme je savais qu’il serait sans cesse sur les fermes, j’évitai, durant près de huit jours, d’y aller, et je me rabattis sur mes études et sur la société de mes hôtes. Puis, sitôt que je recommençai de sortir, je fus requis par une occupation très nouvelle :
Des bûcherons avaient envahi les bois. Chaque année on en vendait une partie ; partagés en douze coupes égales, les bois fournissaient chaque année, avec quelques baliveaux dont on n’espérait plus de croissance, un taillis de douze ans qu’on mettait en fagots.
Ce travail se faisait à l’hiver, puis, avant le printemps, selon les clauses de la vente, les bûcherons devaient avoir vidé la coupe. Mais l’incurie du père Heurtevent, le marchand de bois qui dirigeait l’opération, était telle, que parfois le printemps entrait dans la coupe encore encombrée ; on voyait alors de nouvelles pousses fragiles s’allonger au travers des ramures mortes, et lorsque enfin les bûcherons faisaient vidange, ce n’était point sans abîmer bien des bourgeons.
Cette année la négligence du père Heurtevent, l’acheteur, passa nos craintes. En l’absence de toute surenchère, j’avais dû lui laisser la coupe à très bas prix ; aussi, sûr d’y trouver toujours son compte, se pressait-il fort peu de débiter un bois qu’il avait payé si peu cher. Et de semaine en semaine il différait le travail, prétextant une fois l’absence d’ouvriers, une autre fois le mauvais temps, puis un cheval malade, des prestations, d’autres travaux... que sais-je ? Si bien qu’au milieu de l’été rien n’était encore enlevé.
Ce qui, l’an précédent, m’eût irrité au plus haut point, cette année me laissait assez calme ; je ne me dissimulais pas le tort que Heurtevent me faisait ; mais ces bois ainsi dévastés étaient beaux, et je m’y promenais avec plaisir, épiant, surveillant le gibier, surprenant les vipères, et parfois, m’asseyant longuement sur un des troncs couchés qui semblait vivre encore et par ses plaies jetait quelques vertes brindilles.
Puis, tout à coup, vers le milieu de la première quinzaine d’août, Heurtevent se décida à envoyer ses hommes. Ils vinrent six à la fois, prétendant achever tout l’ouvrage en dix jours. La partie des bois exploitée touchait presque à la Valterie ; j’acceptai, pour faciliter l’ouvrage des bûcherons, qu’on apportât leur repas de la ferme. Celui qui fut chargé de ce soin était un loustic nommé Bute, que le régiment venait de nous renvoyer tout pourri — j’entends quant à l’esprit, car son corps allait à merveille ; c’était un de ceux de mes gens avec qui je causais volontiers. Je pus donc ainsi le revoir sans aller pour cela sur la ferme. Car c’est précisément alors que je recommençai de sortir. Et durant quelques jours, je ne quittai guère les bois, ne rentrant à la Morinière que pour les heures des repas, et souvent me faisant attendre. Je feignais de surveiller le travail, mais en vérité ne voyais que les travailleurs.
Il se joignait parfois, à cette bande de six hommes, deux des fils Heurtevent ; l’un âgé de vingt ans, l’autre de quinze, élancés, cambrés, les traits durs. Ils semblaient de type étranger, et j’appris plus tard, en effet, que leur mère était Espagnole. Je m’étonnai d’abord qu’elle eût pu venir jusqu’ici, mais Heurtevent, un vagabond fieffé dans sa jeunesse, l’avait, paraît-il, épousée en Espagne. Il était pour cette raison assez mal vu dans le pays. La première fois que j’avais rencontré le plus jeune des fils, c’était, il m’en souvient, sous la pluie ; il était seul, assis sur une très haute charrette au plus haut d’un entassement de fagots ; et là, tout renversé parmi les branches, il chantait ou plutôt gueulait une espèce de chant bizarre et tel que je n’en avais jamais ouï dans le pays. Les chevaux qui traînaient la charrette, connaissant le chemin, avançaient sans être conduits. Je ne puis dire l’effet que ce chant produisit sur moi ; car je n’en avais entendu de pareil qu’en Afrique... Le petit, exalté, paraissait ivre ; quand je passai, il ne me regarda même pas. Le lendemain j’appris que c’était un fils de Heurtevent. C’était pour le revoir, ou du moins pour l’attendre que je m’attardais ainsi dans la coupe. On acheva bientôt de la vider. Les garçons Heurtevent n’y vinrent que trois fois. Ils semblaient fiers, et je ne pus obtenir d’eux une parole.
Bute, par contre, aimait à raconter ; je fis en sorte que bientôt il comprît ce qu’avec moi l’on pouvait dire ; dès lors il ne se gêna guère et déshabilla le pays. Avidement je me penchai sur son mystère. Tout à la fois il dépassait mon espérance, et ne me satisfaisait pas. Était-ce là ce qui grondait sous l’apparence ? ou peut-être n’était-ce encore qu’une nouvelle hypocrisie ? N’importe ! Et j’interrogeais Bute, comme j’avais fait les informes chroniques des Goths. De ses récits sortait une trouble vapeur d’abîme qui déjà me montait à la tête et qu’inquiètement je humais. Par lui j’appris d’abord que Heurtevent couchait avec sa fille. Je craignais, si je manifestais le moindre blâme, d’arrêter toute confidence ; je souris donc ; la curiosité me poussait.
Читать дальше