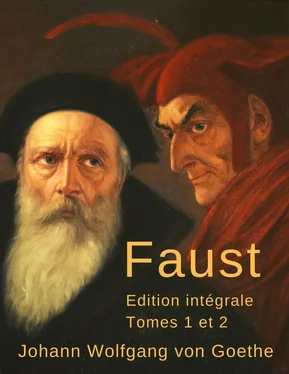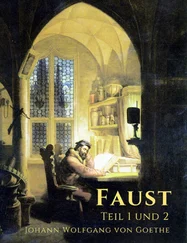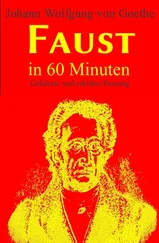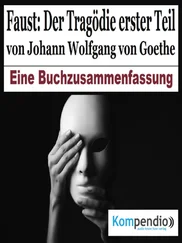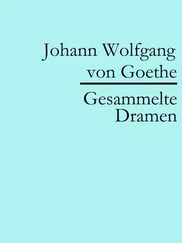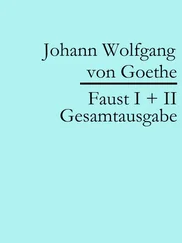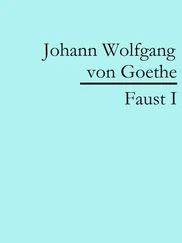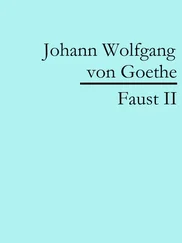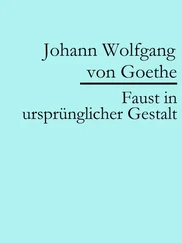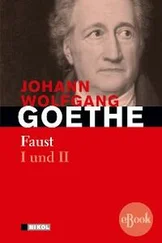Ici commence la seconde partie, dont nous avons donné plus loin l’analyse et fait comprendre la marche logique. Il nous suffit ici d’en relever le dessin général. Du moment que le désespoir d’amour n’a pas conduit Faust à rejeter l’existence ; du moment que la curiosité scientifique survit à cette mort de son cœur déchiré, la tâche de Méphistophélès devient plus difficile, et on l’entendra s’en plaindre souvent. Faust a rafraîchi son âme et calmé ses sens au sein de la nature vivante et des harmonies divines de la Création toujours si belle. Il se résout à vivre encore et à se replonger au milieu des hommes. C’est au point le plus splendide de leur foule qu’il va descendre cette fois. Il s’introduit à la cour de l’empereur comme un savant illustre, et Méphistophélès prend l’habit d’un fou de cour. Ces deux personnages s’entendent désormais sans qu’on puisse le soupçonner. La satire des folies humaines se manifeste ici sous deux aspects, l’un sévère et grand, l’autre trivial et caustique. Aristophane inspire à l’auteur l’intermède de Plutus ; Eschyle et Homère se mêleront à celui d’Hélène. Faust n’a songé tout d’abord qu’à étonner l’empereur et sa cour par sa science et les prestiges de sa magie. L’empereur, toujours plus curieux à mesure qu’on lui montre davantage, demande au docteur s’il peut faire apparaître des ombres. Cette scène, empruntée à la chronique de Faust , conduit l’auteur à ce magnifique développement dans lequel, cherchant à créer une sorte de vraisemblance fantastique aux yeux mêmes de l’imagination, il met à contribution toutes les idées de la philosophie touchant l’immortalité des âmes. Le système des monades de Leibnitz se mêle ici aux phénomènes des visions magnétiques de Swedenborg. S’il est vrai, comme la religion nous renseigne, qu’une partie immortelle survive à l’être humain décomposé, si elle se conserve indépendante et distincte, et ne va pas se fondre au sein de l’âme universelle, il doit exister dans l’immensité des régions ou des planètes, où ces âmes conservent une forme perceptible aux regards des autres âmes, et de celles mêmes qui ne se dégagent des liens terrestres que pour un instant, par le rêve, par le magnétisme ou par la contemplation ascétique. Maintenant, serait-il possible d’attirer de nouveau ces âmes dans le domaine de la matière créée, ou du moins formulée par Dieu, théâtre éclatant où elles sont venues jouer chacune un rôle de quelques années, et ont donné des preuves de leur force et de leur amour ? Serait-il possible de condenser dans leur moule immatériel et insaisissable quelques éléments purs de la matière, qui lui fassent reprendre une existence visible plus ou moins longue, se réunissant et s’éclairant tout à coup comme les atomes légers qui tourbillonnent dans un rayon de soleil ? Voilà ce que les rêveurs ont cherché à expliquer, ce que des religions ont jugé possible, et ce qu’assurément le poëte de Faust avait le droit de supposer.
Quand le docteur expose à Méphistophélès sa résolution arrêtée, ce dernier recule lui-même. Il est maître des illusions et des prestiges ; mais il ne peut aller troubler les ombres qui ne sont point sous sa domination, et qui, chrétiennes ou païennes, mais non damnées, flottent au loin dans l’espace, protégées contre le néant par la puissance du souvenir. Le monde païen lui est non-seulement interdit, mais inconnu. C’est donc Faust qui devra lui seul s’abandonner aux dangers de ce voyage, et le démon ne fera que lui donner les moyens de sortir de l’atmosphère de la terre et d’éclairer son vol dans l’immensité.
En effet, Faust s’élance volontairement hors du solide hors du fini, on pourrait même dire hors du temps. Monte-t-il ? descend-il ? C’est la même chose, puisque notre terre est un globe. Va-t-il vers les figures du passé ou vers celles de l’avenir ? Elles coexistent toutes, comme les personnages divers d’un drame qui ne s’est pas encore dénoué, et qui pourtant est accompli déjà dans la pensée de son auteur ; ce sont les coulisses de la vie où Gœthe nous transporte ainsi. Hélène et Pâris, les ombres que cherche Faust, sont quelque part errant dans le spectre immense que leur siècle a laissé dans l’espace ; elles marchent sous les portiques splendides et sous les ombrages frais qu’elles rêvent encore, et se meuvent gravement, en ruminant leur vie passée. C’est ainsi que Faust les rencontre, et, par l’aspiration immense de son âme à demi dégagée de la terre, il parvient à les attirer hors de leur cercle d’existence et à les amener dans le sien. Maintenant, fait-il partager aux spectateurs son intuition merveilleuse, ou parvient-il, comme nous le disions plus haut, à appeler dans le rayon de ces âmes quelques éléments de matière qui les rende perceptibles ? De là résulte, dans tous les cas, l’apparition décrite dans la scène. Tout le monde admire ces deux belles figures, types perdus de l’antique beauté. Les deux ombres, insensibles à ce qui se passe autour d’elles, se parlent et s’aiment là comme dans leur sphère. Paris donne un baiser à Hélène ; mais Faust, émerveillé encore de ce qu’il vient de voir et de faire, mêlant tout à coup les idées du monde qu’il habite et de celui dont il sort, s’est épris subitement de la beauté d’Hélène, qu’on ne pouvait voir sans l’aimer. Fantôme pour tout autre, elle existe en réalité pour cette grande intelligence. Faust est jaloux de Pâris, jaloux de Ménélas, jaloux du passé, qu’on ne peut pas plus anéantir moralement, que physiquement la matière ; il touche Pâris avec la clef magique, et rompt le charme de cette double apparition.
Voilà donc un amour d’intelligence, un amour de rêve et de folie, qui succède dans son cœur à l’amour tout naïf et tout humain de Marguerite. Un philosophe, un savant épris d’une ombre, ce n’est point une idée nouvelle ; mais le succès d’une telle passion s’explique difficilement sans tomber dans l’absurde, dont l’auteur a su toujours se garantir jusqu’ici. D’ailleurs, la légende de son héros le guidait sans cesse dans cette partie de l’ouvrage ; il lui suffisait donc, pour la mettre en scène, de profiter des hypothèses surnaturelles déjà admises par lui. Cette fois, il ne s’agit plus d’attirer des fantômes dans notre monde ou de tirer de l’abîme deux ombres pour amuser l’empereur et sa cour. Ce n’est plus une course furtive à travers l’espace et à travers les siècles. Il faut aller poser le pied solidement sur le monde ancien, pénétrer dans le monde des fantômes, prendre part à sa vie pour quelque temps, et trouver les moyens de lui ravir l’ombre d’Hélène, pour la faire vivre matériellement dans notre atmosphère. Ce sera là presque la descente d’Orphée ; car il faut remarquer que Gœthe n’admet guère d’idées qui n’aient pas une base dans la poésie classique, si neuves que soient, d’ailleurs, sa forme et sa pensée de détail.
Voilà donc Faust et Méphistophélès qui s’élancent hors de l’atmosphère terrestre, plus hardis cette fois, après une première épreuve : Faust, en proie à une pensée unique, celle d’Hélène ; le diable, moins préoccupé, toujours froid, toujours railleur, mais curieux, lui, d’un monde où il n’est jamais entré. Tandis que le docteur, perdu dans l’univers antique, s’y reconnaît peu à peu avec le souvenir de ses savantes lectures ; qu’il demande Hélène au vieux centaure Chiron, à Manto la devineresse, et finit par apprendre qu’elle habite avec ses femmes l’antre de Perséphone, le mélancolique Hadès, situé dans une des cavernes de l’Olympe ; Méphistophélès s’arrête de loin en loin dans ces régions fabuleuses ; il cause avec les vieux démons du Tartare, avec les sibylles et les parques, avec les sphinx plus anciens encore. Bientôt il prend un rôle actif dans la comédie fantastique qui va se jouer autour du docteur, et revêt le costume et l’apparence symbolique de Phorkyas, la vieille intendante du palais de Ménélas.
Читать дальше