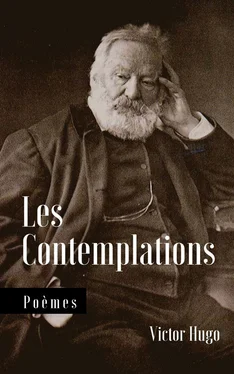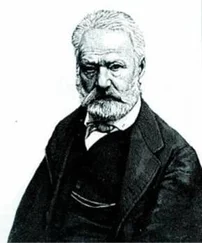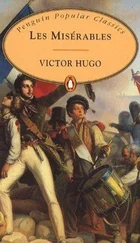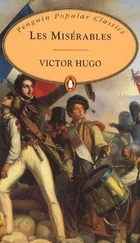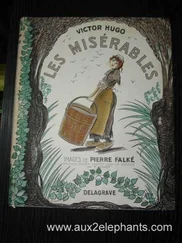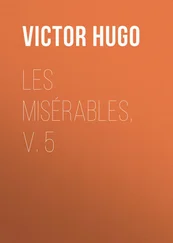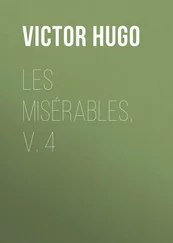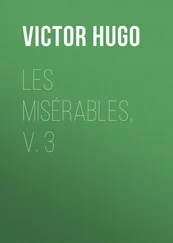1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Je me courbai sur la belle,
Et je pris la coccinelle ;
Mais le baiser s’envola.
« Fils, apprends comme on me nomme »,
Dit l’insecte du ciel bleu,
« Les bêtes sont au bon Dieu ;
Mais la bêtise est à l’homme. »
Paris, mai 1830.
Denise, ton mari, notre vieux pédagogue,
Se promène ; il s’en va troubler la fraîche églogue
Du bel adolescent Avril dans la forêt ;
Tout tremble et tout devient pédant, dès qu’il paraît :
L’âne bougonne un thème au bœuf son camarade ;
Le vent fait sa tartine, et l’arbre sa tirade ;
L’églantier verdissant, doux garçon qui grandit,
Déclame le récit de Théramène, et dit :
Son front large est armé de cornes menaçantes.
Denise, cependant, tu rêves et tu chantes,
À l’âge où l’innocence ouvre sa vague fleur ;
Et, d’un œil ignorant, sans joie et sans douleur,
Sans crainte et sans désir, tu vois, à l’heure où rentre
L’étudiant en classe et le docteur dans l’antre,
Venir à toi, montant ensemble l’escalier,
L’ennui, maître d’école, et l’amour, écolier.
XVII.
À M. Froment Meurice
Nous sommes frères : la fleur
Par deux arts peut être faite.
Le poëte est ciseleur ;
Le ciseleur est poëte.
Poëtes ou ciseleurs,
Par nous l’esprit se révèle.
Nous rendons les bons meilleurs,
Tu rends la beauté plus belle.
Sur son bras ou sur son cou,
Tu fais de tes rêveries,
Statuaire du bijou,
Des palais de pierreries !
Ne dis pas : « Mon art n’est rien… »
Sors de la route tracée,
Ouvrier magicien,
Et mêle à l’or la pensée !
Tous les penseurs, sans chercher
Qui finit ou qui commence,
Sculptent le même rocher :
Ce rocher, c’est l’art immense.
Michel-Ange, grand vieillard,
En larges blocs qu’il nous jette,
Le fait jaillir au hasard ;
Benvenuto nous l’émiette.
Et, devant l’art infini,
Dont jamais la loi ne change,
La miette de Cellini
Vaut le bloc de Michel-Ange
Tout est grand ; sombre ou vermeil,
Tout feu qui brille est une âme.
L’étoile vaut le soleil ;
L’étincelle vaut la flamme.
Paris, octobre 1841.
Je rêvais dans un grand cimetière désert ;
De mon âme et des morts j’écoutais le concert,
Parmi les fleurs de l’herbe et les croix de la tombe.
Dieu veut que ce qui naît sorte de ce qui tombe.
Et l’ombre m’emplissait.
Autour de moi, nombreux,
Gais, sans avoir souci de mon front ténébreux,
Dans ce champ, lit fatal de la sieste dernière,
Des moineaux francs faisaient l’école buissonnière.
C’était l’éternité que taquine l’instant.
Ils allaient et venaient, chantant, volant, sautant,
Égratignant la mort de leurs griffes pointues,
Lissant leur bec au nez lugubre des statues,
Becquetant les tombeaux, ces grains mystérieux.
Je pris ces tapageurs ailés au sérieux ;
Je criai : – Paix aux morts ! vous êtes des harpies.
– Nous sommes des moineaux, me dirent ces impies.
– Silence ! allez-vous-en ! repris-je, peu clément.
Ils s’enfuirent ; j’étais le plus fort. Seulement,
Un d’eux resta derrière, et, pour toute musique,
Dressa la queue, et dit : – Quel est ce vieux classique ?
Comme ils s’en allaient tous, furieux, maugréant,
Criant, et regardant de travers le géant,
Un houx noir qui songeait près d’une tombe, un sage,
M’arrêta brusquement par la manche au passage,
Et me dit : – Ces oiseaux sont dans leur fonction.
Laisse-les. Nous avons besoin de ce rayon.
Dieu les envoie. Ils font vivre le cimetière.
Homme, ils sont la gaîté de la nature entière ;
Ils prennent son murmure au ruisseau, sa clarté
À l’astre, son sourire au matin enchanté ;
Partout où rit un sage, ils lui prennent sa joie,
Et nous l’apportent ; l’ombre en les voyant flamboie ;
Ils emplissent leurs becs des cris des écoliers ;
À travers l’homme et l’herbe, et l’onde, et les halliers,
Ils vont pillant la joie en l’univers immense.
Ils ont cette raison qui te semble démence.
Ils ont pitié de nous qui loin d’eux languissons ;
Et, lorsqu’ils sont bien pleins de jeux et de chansons,
D’églogues, de baisers, de tous les commérages
Que les nids en avril font sous les verts ombrages,
Ils accourent, joyeux, charmants, légers, bruyants,
Nous jeter tout cela dans nos trous effrayants ;
Et viennent, des palais, des bois, de la chaumière,
Vider dans notre nuit toute cette lumière !
Quand mai nous les ramène, ô songeur, nous disons :
« Les voilà ! » tout s’émeut, pierres, tertres, gazons ;
Le moindre arbrisseau parle, et l’herbe est en extase ;
Le saule pleureur chante en achevant sa phrase ;
Ils confessent les ifs, devenus babillards ;
Ils jasent de la vie avec les corbillards ;
Des linceuls trop pompeux ils décrochent l’agrafe ;
Ils se moquent du marbre ; ils savent l’orthographe ;
Et, moi qui suis ici le vieux chardon boudeur,
Devant qui le mensonge étale sa laideur,
Et ne se gêne pas, me traitant comme un hôte,
Je trouve juste, ami, qu’en lisant à voix haute
L’épitaphe où le mort est toujours bon et beau,
Ils fassent éclater de rire le tombeau.
Paris, mai 1835.
XIX.
Vieille chanson du jeune temps
Je ne songeais pas à Rose ;
Rose au bois vint avec moi ;
Nous parlions de quelque chose,
Mais je ne sais plus de quoi.
J’étais froid comme les marbres ;
Je marchais à pas distraits ;
Je parlais des fleurs, des arbres ;
Son œil semblait dire : « Après ? »
La rosée offrait ses perles,
Le taillis ses parasols ;
J’allais ; j’écoutais les merles,
Et Rose les rossignols.
Moi, seize ans, et l’air morose ;
Elle, vingt ; ses yeux brillaient.
Les rossignols chantaient Rose,
Et les merles me sifflaient.
Rose, droite sur ses hanches,
Leva son beau bras tremblant
Pour prendre une mûre aux branches ;
Je ne vis pas son bras blanc.
Une eau courait, fraîche et creuse
Sur les mousses de velours ;
Et la nature amoureuse
Dormait dans les grands bois sourds.
Rose défit sa chaussure,
Et mit, d’un air ingénu,
Son petit pied dans l’eau pure ;
Je ne vis pas son pied nu.
Je ne savais que lui dire ;
Je la suivais dans le bois,
La voyant parfois sourire
Et soupirer quelquefois.
Je ne vis qu’elle était belle
Qu’en sortant des grands bois sourds.
« Soit ; n’y pensons plus ! » dit-elle.
Depuis, j’y pense toujours.
Paris, juin 1831.
Merci, poëte ! – au seuil de mes lares pieux,
Comme un hôte divin, tu viens et te dévoiles ;
Et l’auréole d’or de tes vers radieux
Brille autour de mon nom comme un cercle d’étoiles.
Chante ! Milton chantait ; chante ! Homère a chanté.
Le poëte des sens perce la triste brume ;
L’aveugle voit dans l’ombre un monde de clarté.
Quand l’œil du corps s’éteint, l’œil de l’esprit s’allume.
Paris, mai 1842.
Elle était déchaussée, elle était décoiffée,
Assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants ;
Читать дальше