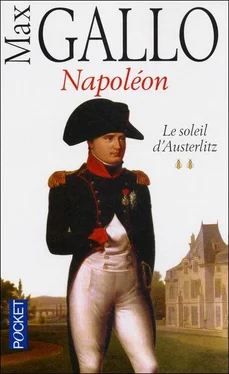Mais il n'a plus aucune pensée pour l'île de son enfance. Il ne reste d'elle que sa famille, ses frères et sœurs, sa mère. Il connaît leurs défauts. Mais ils se sont arrachés, avec lui, de la Corse. Ou on les a chassés. Et il est devenu, parmi les hommes de France, ses soldats d'Italie ou d'Égypte, français.
Il connaît ce pays, qui ne lui a pas été donné mais qu'il a conquis et dont il veut la grandeur. Au fond, lui et cette nouvelle nation surgie en 1789 sont nés ensemble. Mais il ne se contente pas de cela. Car la France ne commence pas avec la Révolution. Il veut donc que la fusion de tous ces âges de l'histoire française s'opère par lui. Et il le peut seul, parce qu'il n'est d'aucun clan politique, qu'il vient d'ailleurs, que la mémoire de ce pays, il l'a acquise dans les livres d'histoire. Il ne regrette pas le temps d'avant 1789. Mais il sait que cet « avant » existe. Et c'est pourquoi, aussi, il veut la paix intérieure, le Concordat, pour que la pacification religieuse établisse définitivement l'ordre dans la société et les âmes.
Il dit à Bourrienne :
- Je suis convaincu qu'une partie de la France se ferait protestante, surtout si je favorisais cette disposition ; mais je le suis encore davantage que la grande partie resterait catholique...
Il médite, pensif.
- Je crains les querelles religieuses, reprend-il, les dissensions dans les familles, des troubles inévitables. En relevant la religion qui a toujours dominé dans le pays et qui domine encore dans les cœurs et en laissant les minorités exercer librement leur culte je suis en harmonie avec la nation et je satisfais tout le monde.
Il montre à Bourrienne un livre qu'Élisa lui a apporté. L'auteur, François René de Chateaubriand, est un émigré rentré d'exil qui fréquente le salon de la sœur de Napoléon. Son livre, Atala , exalte le génie du christianisme. Voilà le sentiment de ce peuple, ce qu'il désire aujourd'hui.
Il pense fréquemment à la religion, durant ce printemps 1801, alors que se poursuit la négociation avec les envoyés du pape.
Il séjourne le plus souvent à la Malmaison, où il réunit chaque jour le Conseil, les ministres. Le soir, dans la fraîcheur qui monte du parc et des bois, Joséphine préside aux réceptions. Il accueille le roi et la reine d'Étrurie. Il galope et il chasse, malgré Joséphine.
Il se promène dans le parc.
Un soir, il invite Thibaudeau à l'accompagner. Il apprécie cet ancien conventionnel, devenu membre du Conseil d'État et qu'il moque en l'appelant « le jacobin poudré ». Mais c'est un bon interlocuteur.
- Tenez, lui dit Napoléon en marchant lentement, j'étais ici dimanche dernier, me promenant dans cette solitude, dans ce silence de la nature. Le son de la cloche de Rueil vint tout à coup frapper mon oreille. Je fus ému, tant est forte la puissance des premières habitudes et de l'éducation !
Il jette un coup d'œil à Thibaudeau, qui l'approuve.
- Je me dis alors, continue Napoléon, quelle impression cela ne doit-il pas faire sur les hommes simples et crédules !
Il s'arrête, prend Thibaudeau par le bras.
- Que vos philosophes, que vos idéologues répondent à cela ! Il faut une religion au peuple. Il faut que cette religion soit dans la main du gouvernement. Cinquante évêques émigrés et soldés par l'Angleterre conduisent aujourd'hui le clergé français. Il faut détruire leur influence. L'autorité du pape est nécessaire pour cela...
Il recommence à marcher, restant plusieurs minutes silencieux, puis il murmure :
- On dira que je suis papiste. Je ne suis rien. J'étais mahométan en Égypte ; je serai catholique pour le bien du peuple.
Il fixe Thibaudeau. Peut-on tout dire de ce que l'on pense ?
- Je ne crois pas aux religions, confie-t-il. Mais l'idée d'un Dieu... !
Il montre le ciel.
- Qui est-ce qui a fait tout cela ?
Il écoute, la tête penchée, Thibaudeau argumenter que même si l'on croit en Dieu, le clergé n'est pas nécessaire.
Napoléon secoue la tête. Thibaudeau est-il si naïf ?
- Le clergé existe toujours, dit Napoléon. Il existera tant qu'il y aura dans le peuple un esprit religieux, et cet esprit lui est inhérent... Il faut donc rattacher les prêtres à la République.
Il se sent libre, mais il connaît la force que représentent les préjugés. Il faut compter avec eux quand on veut gouverner un peuple.
Il a revêtu le costume rouge brodé d'or de Premier consul, et il porte au côté l'épée consulaire sertie de diamants, pour recevoir le cardinal Consalvi, qui vient enfin d'arriver à Paris.
Il le voit s'avancer dans le grand salon de réception des Tuileries où sont rassemblés les ministres et les représentants des Assemblées. Tous ont revêtu leur tenue d'apparat. Il faut que cette audience soit solennelle.
Il va au-devant du cardinal Consalvi, qui est en habit noir, bas et colette rouge, et chapeau à glands de cardinal de la curie romaine.
C'est une nouvelle partie qui commence, et Napoléon doit la gagner.
- Je vénère le pape, qui est excellent, commence-t-il à voix basse, et je désire m'arranger avec lui, mais je ne puis admettre les changements que vous avez imaginés à Rome... On vous présentera un autre projet. Il faudra absolument que vous le signiez dans cinq jours.
Consalvi paraît décontenancé. Il doit en référer à Rome, dit-il.
- Cela ne se peut pas.
Napoléon a à peine haussé le ton, mais son regard oblige Consalvi à baisser la tête.
- J'ai les raisons les plus graves de ne plus accorder le moindre délai, ajoute-t-il. Vous signerez dans cinq jours, ou tout sera rompu et j'adopterai une religion nationale. Rien ne me sera plus facile que de réussir dans cette entreprise.
Il a tracé le plan de bataille. Que Joseph Bonaparte conduise maintenant avec l'abbé Bernier la négociation.
Lorsqu'il revoit Consalvi, le 2 juillet, à la Malmaison, il semble qu'on approche d'un accord.
- Vous savez, dit Napoléon en souriant, quand on ne s'arrange pas avec le bon Dieu, on s'arrange avec le Diable.
Il n'écoute même pas les protestations de Consalvi. Il ne prête pas attention à sa nervosité. Il n'est pas préoccupé. Le projet doit aboutir.
Il reste à la Malmaison. Il est fiévreux. Il vomit. Il ressent parfois de violentes douleurs au côté. Il pense qu'il faut vivre avec la maladie, qu'on peut en dompter les effets. Mais il a confiance en son nouveau médecin, Corvisart. Il tend son bras. Corvisart place des vésicatoires. La peau gonfle. Il éprouve une sensation de brûlure. Et il ne peut donner d'audience. Mais il peut lire, écrire. Il ne veut pas être l'esclave de son corps.
- L'état de maladie, dit-il, est un moment opportun pour s'arranger avec les prêtres.
Dans la matinée du 14 juillet, alors qu'il s'apprête à présider la fête de la Concorde et qu'il achève de dicter la proclamation dans laquelle il célèbre « la paix continentale », la fin prochaine des « divisions religieuses » et la disparition des « dissensions politiques », et au terme de laquelle il dit : « Jouissez, Français, jouissez de votre position, tous les peuples envient votre destinée », Joseph entre dans son cabinet de travail.
Il a une expression qui hésite entre la contrition, l'inquiétude et la satisfaction.
Napoléon se sent emporté par l'impatience. Que Joseph lui donne le texte auquel il a abouti avec Consalvi. Il prend les feuillets, les parcourt, les jette dans la cheminée où, malgré la chaleur, il a fait faire du feu. Pourquoi donc Joseph a-t-il accepté toutes ces concessions ? Lui ne cédera pas.
Le soir, au dîner qu'il offre aux Tuileries, il apostrophe le cardinal Consalvi. Il veut employer un ton méprisant, montrer sa force et sa colère.
Читать дальше