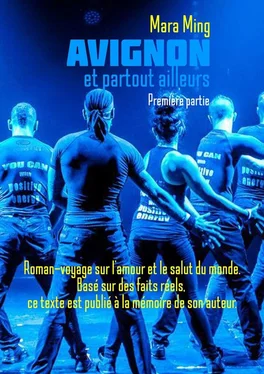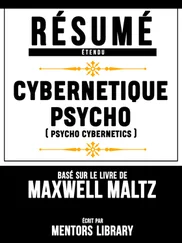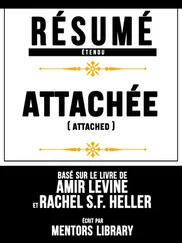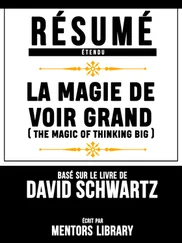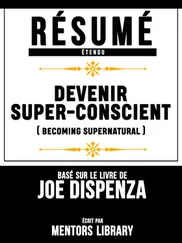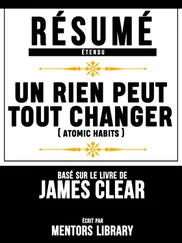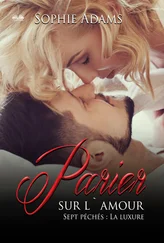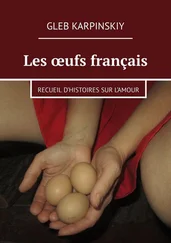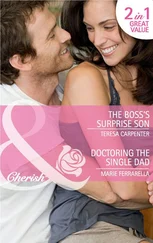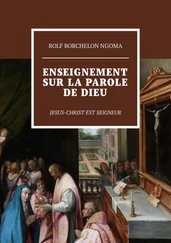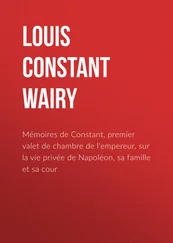– –
Au début, les étendues vides – sous-sols, carrières, chantiers – me servaient de mondes parallèles. Je pouvais les peupler d’habitants de mon choix, à la différence de la réalité. J’appréciais particulièrement les toits. Tous les toits non fermés étaient miens: il n’y avait pas de plus grande joie que de grimper par l’escalier d’incendie sur la calvitie plate d’un immeuble de cinq étages et de rester là, sans bouger, pendant des heures, arrachant du bout des doigts des morceaux de goudron poisseux du revêtement. Dans ma tête, des films tournaient en boucle: j’inventais des histoires que seul un enfant infiniment solitaire peut inventer. Une fois accrochée à un scénario ou un rêve quelconque, je pouvais le détortiller pendant des jours, ajoutant ou enlevant quelque chose à ma guise. Atterrissant doucement sur ce même toit deux heures plus tard, je rampais vers son bord – avec beaucoup de précaution, pour que les balayeurs ne me voient pas – et jetais en bas, dans ce micro-monde insignifiant et futile, des morceaux de goudron. Je les regardais voler, puis devenir des points.
Au Baïkal, où on allait avec mes parents en été, au lieu des toits il y avait de grands cèdres. Je m’enfonçais dans la taïga, grimpais sur des troncs rugueux jusqu’à leur cime, et là où le tronc devenait dangereusement fin, je me balançais. Un sentiment de toute-puissance secrète m’envahissait alors: youhou! Je peux aussi faire ça!
Ma deuxième passion – et aussi un monde parallèle – était la lecture. Pendant que les autres adolescents apprenaient à fumer et à s’embrasser, je lisais passionnément. Ça venait de ma mère. C’était elle qui se constituait une bibliothèque maison, se procurait sans cesse toutes sortes de livres par un système complexe d’abonnement (à cette époque, on devait commander les collections de qualité en avance, faire la queue et cetera), rapportait chez nous des petits tomes déclassés de la salle de lecture où elle arrondissait ses fins de mois. J’adorais lire: la littérature, comme la galopade sur les chantiers, me transportait hors de la réalité. Je revenais à la maison, en sueur et sale, et oubliant de prendre une douche, je me saisissais d’un livre. J’avalais tout ce qui me tombait sous la main: d’abord Mayne Reid et « La Bibliothèque des Aventuriers», puis, Bounine, Tchekhov, un ouvrage de dix volumes à la couverture grise, Kouprine revêtu de velours vert, Gogol en noir, autrement dit des classiques; impossible de se les rappeler tous. Plus tard, j’ai passé en revue Wilder, Fitzgerald, Nabokov, Evelyn Waugh. Et d’autres. Tout ce que ma mère aimait. Puis, vers treize ans, j’ai effectué un rétrogradage littéraire: je me suis intéressée aux romans d’amour de bas étage.
«N’est-ce pas trop tôt pour elle? a demandé une fois, les lèvres pincées, une voisine de compartiment dans un train.
– Il vaut mieux qu’elle apprenne des choses des livres plutôt que des cages d’escalier», avait répondu ma mère avec une politesse glaciale.
J«étais toute seule, je souffrais de mon mutisme et me détestais chaque fois que je me retrouvais au milieu des gens, mais seule avec moi-même, je ne m’ennuyais jamais. Dans ma tête se fragmentaient sans cesse des cellules; je créais des mondes.
Ce n’est que bien plus tard que j’ai remarqué: les mondes parallèles existent, et je ne suis pas la seule à m’y intéresser. Des milliers de personnes les cherchent, et en perdent le sommeil et la tranquillité: dans les chroniques mondaines, dans le journal « L’oracle», dans la vie des extra-terrestres et des gens à tête de chien. Partout, sauf sous leur nez, alors que pour les trouver, il suffit de presque rien: tu n’as qu’à tourner au coin de la route battue, et alors qui rencontreras-tu? John par exemple. John le patriote, John le réalisateur, John l’éboueur, avec son caractère querelleur, ses yeux brillants de pirate, et il t’entraînera dans des aventures. Et ce même John se préoccupera de toi, te protègera comme si tu étais une fleur, te fera un plan de voyage et mettra ses amis à contribution pour qu’ils te prennent dans leurs bras et te distraient; il ne te lâchera pas et insistera pour que tu ne te promènes pas toute seule la nuit. Il t’expliquera toutes les subtilités. John était aussi mon monde parallèle, mais familier en même temps: proche, harmonieux. Si j’avais voulu quelque chose d’autre, je me serais installée dans un hôtel luxueux; pas le plus cher, bien entendu, mais au moins avec un évier en marbre et une rose dans un vase. J’y aurais passé mes matins à boire du thé, très contente de moi. Mais non. Au lieu de ça, je faisais des va-et-vient avec John, le long de la rue de la Carreterie.
La rue de la Carreterie; si j’avais su combien de fois il me faudrait la parcourir, la remontant et la descendant, de long en large, tous ces aller-retour, tous ces kilomètres, si j’avais su que je devrais faire le tour du globe, passer le point de non-retour et oublier beaucoup de ce que je pensais de moi. Mais me souvenir aussi de quelque chose. De la rue de la Carreterie à l’avenue de la Synagogue et vice-versa, à nouveau la rue de la Carreterie, puis la rue Carnot, la place du Palais et la rue de la Réplublique, et enfin la ruelle en face du théâtre « Le Paris», où se passera tout ce qui était écrit, tout ce qui devait m’arriver et ne pouvait pas arriver autrement.
– –
[…]
– –
La chaleur a cédé, les ombres se sont allongées. John m’a traînée au deuxième niveau de la place, vers la fontaine sous l’église Notre Dame des Doms. La fontaine – lourde, avec trois calices – rappelait un vase de fruits à trois étages. Il n’y avait pas d’eau; des papiers et quelques bouteilles en plastique gisaient sur le fond ébréché. Une aire panoramique avec un parapet dominait la fontaine. Les plus courageux y grimpaient et s’installaient là-haut, les jambes ballantes.
«I’ll go up, Jonhy Boy, ai-je dit. There’s a good point to make some photos.»
John avait de nouveau disparu dans les profondeurs de son bac poubelle: soit il était en train de chercher quelque chose, soit il en examinait le fond. Il a marmonné de là-dedans :
«Okay!
– «Okay!», l’ai-je taquiné en russe. «Une voix s’est fait entendre de la poubelle!»»
La phrase-grenade de mon enfance de l’époque de la perestroïka, l’arme universelle contre n’importe quelle réplique insultante. Te voilà en train de courir dans le couloir pendant la récréation, les joues ponceau, les cheveux te rentrent dans la bouche, les collants en coton te tombent jusqu’aux genoux, et quelque chose d’irréparable va se passer dans un instant – tu vas te casser la figure! – tandis que Petrov te court après :
«Mara-marine, vieille sardine!»
Et tu lui cries par-dessus l’épaule, sans reprendre haleine :
«Une voix s’est fait entendre de la poubelle!»
Et tu appuies de nouveau sur l’accélérateur. Parce que les toilettes pour les filles, elles ne sont qu’à deux bonds, et là, aucun Petrov ne s’y aventurera. Il te faut donc y parvenir et te cacher là-bas en attendant la sonnerie.
Dans mon enfance de l’époque de la perestroïka, l’essentiel était de ne pas vasouiller, de ne pas bayer aux corneilles; on n’aimait pas les faibles. A y regarder de plus près, en ce temps-là tout était infiniment bizarre. Je me souviens qu’en classe de CE2 – était-ce bien le CE2? et donc, l’année 93? – la conseillère principale d’éducation nous avait attrapés, nous les amateurs de sprint de couloir. On faisait du tapage dans les escaliers pendant la leçon: la prof de maths était en retard, et rester assis sans rien faire dans une salle de classe étouffante, aux rideaux rouges en nylon, ce n’est pas tout le monde qui peut le supporter. Le soleil brillait si fort! Plein de joie, quelqu’un a planté un stylo-bille entre les omoplates de son voisin; celui-ci a répliqué par une bourrade, et les chaises ont volé, un piaillement a retenti, la porte s’est ouverte brusquement, et une boule de foudre de couleur noire-bleue-marron (à cette époque, on portait encore l’uniforme scolaire) a dévalé l’escalier.
Читать дальше