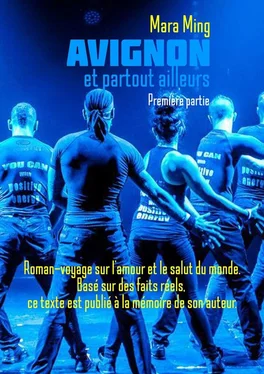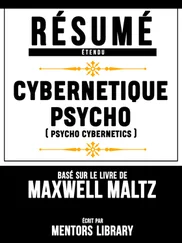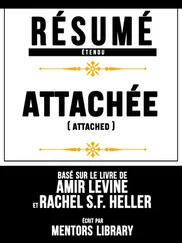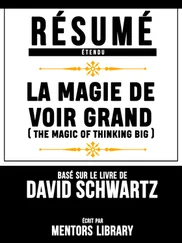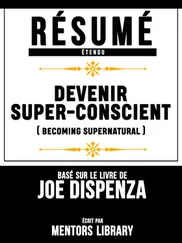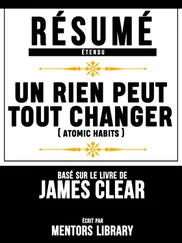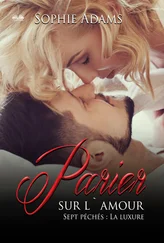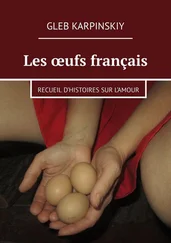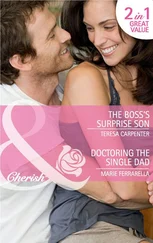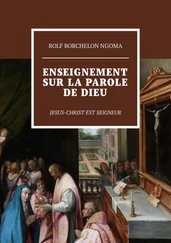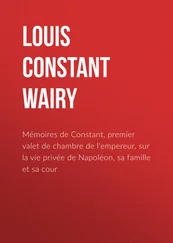1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 repasser 5 5 Les fers à souder et à repasser étaient les instruments de torture les plus populaires.
n’étaient pas vraiment des plaisanteries. Des corps pourrissants étaient retrouvés dans des recoins de parcs aux odeurs désagréables. Quelque chose de sombre se tramait la nuit dans les garages. « La capitale du crime des banlieues de Moscou», « le monde de la truanderie et de l’illégalité absolue», « le banditisme sans foi ni loi»: les journalistes à la plume jaune aiguisaient leur éloquence dans les gros titres. Ma mère m’interdisait de lire le journal « Moskovskij Komsomolets» 6 6 Journal populaire dans les années 90, numéro un de la presse jaune.
, mais je m’enfermais dans les toilettes et le lisais quand même.
Des centaines de gars dans la ville étaient soit liés à la mafia, soit ils rêvaient de rejoindre ses rangs. « Des incendies et des fusillades. Des vols de voitures et des explosions. Des accidents et des meurtres»: l’émission « Patrouille de police» était l’une des plus populaires à Moscou et dans ses environs. Dans notre famille, c’était par elle que la journée commençait. Tout comme dans des centaines d’autres.
Tôt le matin, alors qu’il ne faisait pas encore jour, papa s’asseyait avec une tasse d’un litre de thé et pressait la télécommande.
«Sur le boulevard Volzhskij, commençait à rapporter, sans même saluer, une voix froide de femme, un accident de la route s’est produit. Deux personnes ont été blessées…»
Je me préparais pour l’école. Ma mère me peignait et me tressait les cheveux, attachant la natte avec un élastique « made in China», aux couleurs vives. Je me lavais, me brossais les dents, enfilais mes collants.
«Blablabla… se faisait entendre du salon. Des restes humains ont été découverts… Des corps carbonisés… Blablabla… L’identification des restes humains… Blablabla…»
Maman me préparait une tartine de pain blanc avec du beurre et du sucre. Et pour elle se faisait du café.
«Blablabla… Un incendie dans la rue Initsiativnaya… L’ambulance… Le cadavre d’un homme… Des restes humains sous la neige…»
Dans cette émission, l’expression « des restes humains» était répétée plus que toute autre.
«Ton grand-père est là», m’informait enfin maman, regardant par la fenêtre. Chaque matin, grand-père m’emmenait à l’école dans sa voiture. « Dépêche-toi!»
Je sortais de l’appart et me retrouvais dans le matin glacé. Là, la neige étincelait, toute bigarrée de jaunes signatures canines, et la « Volga» de grand-père, aux flancs arrondis, pétaradait, s’ébrouant de froid. Des restes humains, il n’y en avait pas. Et on ne peut pas dire qu’ils me préoccupaient: mes parents ont tout fait pour me laisser en dehors de ce chaos. Dès le mois d’octobre du cours préparatoire, ma mère m’a retirée de l’école qui se trouvait sous nos fenêtres et m’a transférée dans une autre, un peu meilleure. Là-bas, du moins, on ne sniffait pas de la colle pendant les recréations. Il y avait là des classes de danse de salon et des cours d’étiquette (et aussi une conseillère principale d’éducation qui forçait les élèves de CE2 à baisser leurs culottes au tableau, mais il me semble que je n’ai jamais raconté cela à maman). Mes classes de français continuaient. On ne me laissait pas fréquenter les enfants des rues; aucune violence, les adultes déplaçaient simplement, de façon très fine, pas du tout importune, la focale de mon attention sur d’autres enfants. Plus convenables. « Enfant des rues», c’était une sorte de verdict. On avait peur pour moi: des fois que quelqu’un lui apprenne à fumer ou la serre dans un coin. Quant aux bandits, je ne m’en souciais pas: quel rapport pouvaient-ils avoir avec moi, une petite fille?
Mais ce n’était pas eux le problème. C’étaient les gens ordinaires: ceux avec qui on avait affaire chaque jour.
Les vibrations radioactives qui s’échappaient des recoins, le bruit de fond qu’émettaient les garages et les sous-sols ne pouvait pas ne pas influencer les gens ordinaires. C’était comme si un signal venait toujours de là-bas: on est tout près. On est proche de toi. Demain, tu nous rencontreras par hasard dans la rue. Ou bien, peut-être, on te tombera dessus dans ta cage d’escalier, et tu n’auras même pas le temps de comprendre ce qui se passe. En plus de ça, la précarité générale, les licenciements, la peur. Le monde était imprégné d’une odeur de désespoir. Personne ne savait de quoi demain serait fait. Le salaire? Dis plutôt merci d’avoir un travail. Un business honnête? Vous rigolez?
Lubertsy était une ville prolétarienne, grossière. Ceux qui ne faisaient pas partie de la mafia ne dessoûlaient jamais. Tout le monde buvait. On buvait de l’eau de Cologne et sniffait de la colle. La cruauté était à la fois une forme d’autodéfense et la norme du quotidien. On se battait dans les familles. On donnait des gifles aux enfants. La racaille torturait les chats et les chiens. Je me souviens qu’une fois Katia, ma copine du sixième étage, avait laissé échappé que son frère appâtait des petites mésanges avec un morceau de lard sur son balcon. Rien de criminel a priori, mais en pensant à ce Serioga, âgé de dix-huit ans, lugubre, au visage malsain marqué de petite vérole, je me suis méfiée. « Pourquoi? ai-je demandé. Tu es sûre qu’il ne les torture pas?» Katia a hoché la tête, mais plus tard elle a avoué: bien sûr, il les torture. Il leur verse de la vodka dans la gorge et regarde ce qui se passe. C’est simplement amusant. J’ai sangloté, le visage dans l’oreiller, pendant deux jours.
C«était une époque méchante. La cruauté était le moyen le plus rapide de se reposer un tant soit peu sur quelque chose, de se sentir fort ne serait-ce qu’un instant. Donc, les règles étaient simples: après dix heures, il vaut mieux ne pas marcher dans le noir. Ce chantier, contourne-le, même le jour: là, quelqu’un a été violé avec un morceau de barre d’armature. Ici, on a assassiné quelqu’un: son cadavre a été trouvé dans une benne à ordures. Un long regard droit dans les yeux, c’est une provocation: c’est toi qui auras tort. C’est ce dont je me souviens de l’enfance. C’est comme ça que je vivais, en regardant le sol.
– –
En ce temps, dans les années quatre-vingt-dix, ma famille passait pour être relativement prospère. D’un statut plus élevé que les autres dans l’immeuble. A cause de cela, on ne nous aimait pas trop. Et aussi du fait que mes parents ne voulaient pas boire de vodka, mais au lieu de ça se démenaient comme des fous, essayant de gagner de quoi vivre, d’une façon ou d’une autre. Qu’est-ce qu’ils n’ont pas fait après que l’Union s’était effondrée! En URSS tout était clair: grand-père membre du Parti, mère pianiste, père architecte. Pendant la pérestroïka, plus personne n’avait besoin de pianistes et d’architectes (sans parler des fonctionnaires du Parti). Et mon architecte de père allait dans les jardins d’enfants et photographiait les enfants à la demande. Il dessinait et faisait des vitraux, ayant par la même occasion orné de ces derniers les trois fenêtres de notre appart: dans une pièce, il y avait des arabesques de gel, dans une autre des fleurs, et dans le salon d’harmonieux losanges. Des fenêtres vitraux. De fait, le salon s’était mis à ressembler soit à un temple, soit à une chambre de demoiselle russe des temps anciens, telles qu’elles apparaissent dans les dessins animés. Très joli et impossible de voir quelque chose de l’extérieur, au cas où il aurait pris l’envie à quelqu’un de l’immeuble d’en face de regarder avec des jumelles s’il n’y avait pas un petit quelque chose de valeur dans notre appartement. Ça arrivait; après que deux apparts au dessus avait été cambriolés en l’espace de deux semaines (» L’or, je le gardais pour le mariage de ma fille, sanglotait l’une des victimes, et ils ont emporté aussi le manteau de fourrure!»), mes parents s’étaient procuré de l’argent et avaient fait installer une massive porte blindée. Elle est toujours là, dans l’appart de Lubertsy, en souvenir de cette époque, tout comme les contours des vitraux à demi effacés.
Читать дальше