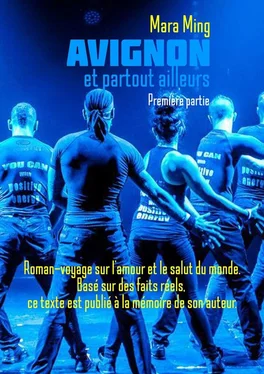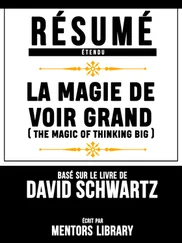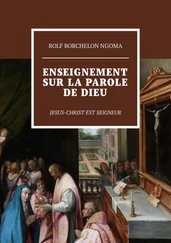1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Un pays étonnant. Il m’a raconté beaucoup, et il me semble que tout ce qui m’arrive depuis déjà tant d’années et tout ce que j’ai fait moi-même de ma vie, provient de là-bas, de cette Inde narquoise, enivrante et impossible, le pays des miracles et la patrie des éléphants. L’Inde m’a joué ce tour; elle a tranché le monde devant moi comme une pastèque: voici du vivant, et voilà du carton-pâte. L’Inde m’a appris le courage et le rire, tandis que la steppe et la danse, elles, me rendaient mon âme.
– –
[…]
– –
Je suis revenue vers John autour de quatre heures: j’ai mangé une glace molle ressemblant à un petit amas de neige de printemps coulant entre les doigts, ai bu un café, ai fourré mon nez dans quelques boutiques de souvenirs. Là, on étouffait et avait mal aux yeux à cause de toute cette camelote à deux euros. Dans n’importe quel pays, si on jette un coup d’œil dans n’importe quelle boutique de ce type, on y verra la même chose: de petits aimants grossièrement peints, des sous-verres avec des armoiries, des torchons à vaisselle qui restent présentables jusqu’au premier lavage. Et des tasses rappelant des vieilles filles de province: bedonnantes, grosses sur les flancs et toujours peinturlurées comme pour leur dernier voyage. Plus c’est moche, mieux c’est. Je n’ai finalement rien acheté.
John continuait à bavarder avec quelqu’un, soutenant de sa paume le Palais des Papes, mais une fois qu’il m’a vue, il a agité frénétiquement la main: « où étais-tu?»
La ruelle étroite semblable à un gué est devenue quasiment impraticable: les touristes s’y étaient entassés comme des esturgeons. Ils écarquillaient les yeux sur une Française minuscule en haillons et avec des dreads: elle raclait du violon, et un chapeau noir à ses pieds avait ouvert tout grand sa gueule affamée (» she’s my friend», a lancé John). Près du mur, d’autres artistes attendaient leur tour.
Ayant parcouru à toute vitesse quelques places kaléidoscopiques – des affiches, des affiches et encore des affiches – on a tourné dans une ruelle pavée de dalles marron-rouges. Une série de bornes en pierre séparait le trottoir de la route. Sur l’une d’elles avait grimpé un distributeur de tracts; se tenant immobile sur un pied, il ressemblait à un jeune coq. L’ombre de la maison d’en face recouvrait encore la borne, mais le soleil était déjà en train de la lécher. Et le distributeur, pétrifié sur son piédestal, m’a semblé, à moi qui était aveuglée par l’éclat du soleil, noir comme du charbon: un trou en forme de garçon sur la toile blanche et colorée d’un mur éclairé de lumière.
John s’est élancé vers une créature masquée et lui a serré la main.
La créature n’avait pas l’air très agréable: maigre comme un poulet déplumé, torse nu (la peau sur les os), un large pantalon noir sur ses hanches décharnées. Ses avant-bras étaient empaquetés dans des protège-coudes en néoprène. Un masque en forme de casque: rouge et entièrement fermé, brillant. On avait l’impression qu’on lui avait arraché la peau du crâne et qu’on avait laqué celui-ci. Brrr.
Néanmoins, la créature était pleine d’empathie: elle a hurlé quelque chose en japonais, a empoigné ma main et s’est mise à la secouer.
«C’est Mara, elle est russe (par bonheur, John ne m’a pas proposé d’embrasser le monstre en papier mâché laqué). Alors, ça va?»
Le monstre s’est mis à jacasser à toute allure en français, avec un accent japonais. Dans un trou pour la bouche scintillaient, comme des galets humides, de petites dents. John, poli, m’a traduit :
«He says that this year they have a new show. Et a ajouté avec respect: He is a samurai, did you understand? There are not many people here, but they don’t give up. They are real fighers.»
Le thème des fighters était, il faut le dire, la ligne générale de nos conversations. L’artiste de rue est toujours un combattant, m’instruisait John. Dans la rue, c’est une lutte perpétuelle: pour l’autorité, pour la meilleure place, pour le public. On lutte avec tout le monde, sans arrêt, au propre comme au figuré. Avec la police, avec les gens, avec soi-même (évidemment!). Quand je suis parti en Australie, racontait John, je vivais sous un fourgon et m’entraînais quatorze heures par jour. Je le harcelais de questions: « l’Australie? Comment tout cela a-t-il commencé? Où sont tes parents, garçon?» Selon John, il s’avérait qu’il n’y avait aucun problème avec ses parents, que c’était une famille ordinaire, que tout était normal. C’est juste qu’il aimait se la péter. Il faisait toujours des trucs dans la rue; il voulait que les gens le regardent. Puis il s’est pris au jeu. Pourquoi? Qui sait! C’est mon caractère. Maintenant ça va, mais tu sais comment j’étais avant? Je cherchais toujours la merde. Je me pointais sur le territoire de quelqu’un, je disais: ok, tu te produis ici, mais moi je vais venir et te piquer ton public. Parce que je suis le plus fort, et que toi tu es nul. Beaucoup de gens ne m’aimaient pas, et encore aujourd’hui pas tout le monde ne m’aime. Je me comporte de manière normale seulement avec ceux que je respecte.
Le voilà, le pathos du monde de la rue.
«Alors, qui est-ce que tu respectes?» le taquinais-je avec insistance. Il y en a peu, répondait John d’un geste de dépit. Ceux qui font mieux que moi, par exemple. Je ricanais: « y en a-t-il vraiment?» Et John – il faut lui rendre justice – disait: bien sûr, il y en a. Il essayait d’être juste.
Restait bien sûr la question: qu’avais-je donc à faire ici avec mon opéra et Aïvaz? Mais c’est très clair. Je vivais ma vie nacrée, remuais mes nageoires dans mon bassin d’esthète (et quoi? j’en avais le droit: je l’avait construit toute seule, personne ne m’avait aidée), mais quelque chose d’aventuriste, quelque chose de vivant et de sauvage m’a de nouveau fait signe, et, comme un vieil ivrogne, j’ai craqué. Je me suis lancée à sa poursuite.
– –
[…]
– –
J’en suis convaincue: tout vient de là, de l’enfance. Dans mon cas, le goût pour la belle vie, l’aventurisme, le désir de mettre un pied dans d’autres mondes. Mon enfance, c’était Lubertsy. Ce Lubertsy des banlieues de Moscou, la ville où on te couvre d’injures avant même que tu aies pu compter jusqu’à trois – et alors? Ne reste pas planté là à faire des yeux de merlan frit, insulte juste courtoisement en retour, c’est normal.
A propos de Lubertsy, voilà ce dont je me souviens: cette ville n’a jamais été tranquille, et pendant la perestroïka elle a totalement pété les plombs. La ville était tout simplement sens dessus dessous. Il me semble que c’était particulièrement inquiétant au milieu des années quatre-vingt-dix; ou alors, c’est peut-être juste à partir de ce moment-là que je m’en souviens le mieux. Je me souviens de cette époque comme d’un éternel hiver: brumeuse, humide, avec des tas de neige gris sale partout et un ciel lourd et bas. Les racketteurs brûlaient des kiosques d’alimentation et faisaient sauter des voitures. De temps à autre, de petits entrepreneurs locaux disparaissaient sans nouvelles; plus tard, on découvrait leurs corps dans des coffres de voiture (de ça, on en parlait à voix basse dans la cuisine, et à haute voix à la télé). Les problèmes avec les « partenaires de business» (c’est ainsi qu’on les appelait), on les résolvait à la dure: on les égorgeait par familles entières. Le mot « toit» 4 4 Protection « proposée» aux petits entrepreneurs par la mafia, aussi bien que par la police, en échange de grosses sommes d’argent, afin d’assurer la sécurité de leur affaire; c’est à cette seule condition que l’entreprise pouvait exister.
ne dégageait pas un sentiment de confort, mais plutôt de menace. Les plaisanteries sur le fer à souder et le fer à
Читать дальше