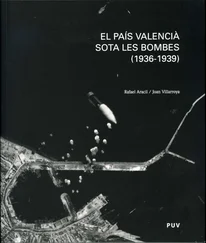– Mais quand je serais assez faible, madame, répondis-je à cette corruptrice, pour me livrer à vos affreux systèmes, comment parviendriez-vous à étouffer le remords qu’ils feraient à tout instant naître dans mon cœur?
– Le remords est une chimère, Sophie, reprit la Dubois, il n’est que le murmure imbécile de l’âme assez faible pour ne pas oser l’anéantir.
– L’anéantir, le peut-on?
– Rien de plus aisé, on ne se repent que de ce qu’on n’est pas dans l’usage de faire. Renouvelez souvent ce qui vous donne des remords et vous parviendrez à les éteindre; opposez-leur le flambeau des passions, les lois puissantes de l’intérêt, vous les aurez bientôt dissipés. Le remords ne prouve pas le crime, il dénote seulement une âme facile à subjuguer.
Qu’il vienne un ordre absurde de t’empêcher de sortir à l’instant de cette chambre, tu n’en sortiras pas sans remords, quelque certain qu’il soit que tu ne ferais pourtant aucun mal à en sortir. Il n’est donc pas vrai qu’il n’y ait que le crime qui donne des remords; en se convainquant du néant des crimes ou de la nécessité dont ils sont eu égard au plan général de la nature, il serait donc possible de vaincre aussi facilement le remords qu’on aurait à les commettre, comme il te le deviendrait d’étouffer celui qui naîtrait de ta sortie de cette chambre d’après l’ordre illégal que tu aurais reçu d’y rester. Il faut commencer par une analyse exacte de tout ce que les hommes appellent crime, débuter par se convaincre que ce n’est que l’infraction de leurs lois et de leurs mœurs nationales qu’ils caractérisent ainsi, que ce qu’on appelle crime en France cesse de l’être à quelque cent lieues de là, qu’il n’est aucune action qui soit réellement considérée comme crime universellement dans toute la terre et que par conséquent rien dans le fond ne mérite raisonnablement le nom de crime, que tout est affaire d’opinion et de géographie. Cela posé, il est donc absurde de vouloir se soumettre à pratiquer des vertus qui ne sont que des vices ailleurs, et à fuir des crimes qui sont de bonnes actions dans un autre climat. Je te demande maintenant si cet examen fait avec réflexion peut laisser des remords à celui qui pour son plaisir ou pour son intérêt aura commis en France une vertu de la Chine ou du Japon, qui pourtant le flétrira dans sa patrie. S’arrêtera-t-il à cette vile distinction, et s’il a un peu de philosophie dans l’esprit, sera-t-elle capable de lui donner des remords? Or si le remords n’est qu’en raison de la défense, n’en naît qu’à cause du brisement des freins et nullement à cause de l’action, est-ce un mouvement bien sage à laisser subsister en soi, n’est-il pas absurde de ne pas l’anéantir aussitôt? Qu’on s’accoutume à considérer comme indifférente l’action qui vient de donner des remords, qu’on la juge telle par l’étude réfléchie des mœurs et coutumes de toutes les nations de la terre; en conséquence de ce raisonnement, qu’on renouvelle cette action quelle qu’elle soit, aussi souvent que cela sera possible, et le flambeau de la raison détruira bientôt le remords, il anéantira ce mouvement ténébreux, seul fruit de l’ignorance, de la pusillanimité et de l’éducation. Il y a trente ans, Sophie, qu’un enchaînement perpétuel de vices et de crimes me conduit pas à pas à la fortune, j’y touche; encore deux ou trois coups heureux et je passe de l’état de misère et de mendicité dans lequel je suis née à plus de cinquante milles livres de rente. T’imagines-tu que dans cette carrière brillamment parcourue, le remords soit un seul instant venu me faire sentir ses épines? Ne le crois pas, je ne l’ai jamais connu. Un revers affreux me plongerait à l’instant du pinacle à l’abîme que je ne l’admettrais pas davantage; je me plaindrais des hommes ou de ma maladresse, mais je serais toujours en paix avec ma conscience. – Soit, mais raisonnons un instant sur les mêmes principes de philosophie que vous. De quel droit prétendez-vous exiger que ma conscience soit aussi feutre que la vôtre, dès qu’elle n’a pas été accoutumée dès l’enfance à vaincre les mêmes préjugés; à quel titre exigez-vous que mon esprit qui n’est pas organisé comme le vôtre, puisse adopter les mêmes systèmes? vous admettez qu’il y a une somme de maux et de biens dans la nature, et qu’il faut qu’il y ait en conséquence une certaine quantité d’êtres qui pratique le bien, et une autre classe qui se livre au mal. Le parti que je prends, même dans vos principes, est donc dans la nature; n’exigez donc pas que je m’écarte des règles qu’il me prescrit, et comme vous trouvez, dites-vous, le bonheur dans la carrière que vous suivez, de même il me serait impossible de le rencontrer hors de celle que je parcours. N’imaginez pas d’ailleurs que la vigilance des lois laisse en repos longtemps celui qui les transgresse; n’en venez-vous pas de voir l’exemple sous vos yeux mêmes? de quinze scélérats panai lesquels j’avais le malheur d’habiter, un se sauve, quatorze périssent ignominieusement.
– Est-ce cela que tu appelles un malheur? qu’importe premièrement cette ignominie à celui qui n’a plus de principes?
Quand on a tout franchi, quand l’honneur n’est plus qu’un préjugé, la réputation une chimère, l’avenir une illusion, n’est-il pas égal de périr là, ou dans son lit? Il y a deux espèces de scélérats dans le monde, celui qu’une fortune puissante, un crédit prodigieux met à l’abri de cette fin tragique et celui qui ne l’évitera pas s’il est pris; ce dernier, né sans bien, ne doit avoir que deux points de vue s’il a de l’esprit: la fortune, ou la roue. S’il réussit au premier, il a ce qu’il a désiré; s’il n’attrape que l’autre, quel regret peut-il avoir puisqu’il n’a rien à perdre? Les lois sont donc nulles vis-à-vis de tous les scélérats, car elles n’atteignent pas celui qui est puissant, celui qui est heureux s’y soustrait, et le malheureux n’ayant d’autre ressource que leur glaive, elles doivent être sans effroi pour lui.
– Eh, croyez-vous que la justice céleste n’attende pas dans un monde meilleur celui que le crime n’a pas effrayé dans celui-ci?
– Je crois que s’il y avait un dieu, il y aurait moins de mal sur la terre; je crois que si le mal existe sur la terre, ou ces désordres sont nécessités par ce dieu, ou il est au-dessus de ses forces de l’empêcher; or je ne crains point un dieu qui n’est qu’ou faible ou méchant, je le brave sans peur et me ris de sa foudre.
– Vous me faites frémir, madame, dis-je en me levant, pardonnez-moi de ne pouvoir écouter plus longtemps vos exécrables sophismes et vos odieux blasphèmes.
– Arrête, Sophie, si je ne peux vaincre ta raison, que je séduise au moins ton cœur. J’ai besoin de toi, ne me refuse pas tes secours; voilà cent louis, je les mets à tes yeux de côté, ils sont à toi dès que le coup aura réussi.
N’écoutant ici que mon penchant naturel à faire le bien, je demandai sur-le-champ à la Dubois de quoi il s’agissait, afin de prévenir de toute ma puissance le crime qu’elle s’apprêtait à commettre.
– Le voilà, me dit-elle, as-tu remarqué ce jeune négociant de Lyon qui mange avec nous depuis trois jours?
– Qui, Dubreuil?
– Précisément.
– Eh bien?
– Il est amoureux de toi, il me l’a confié. Il a six cent mille francs ou en or, ou en papier dans une très petite cassette auprès de son lit. Laisse-moi faire croire à cet homme que tu consens à l’écouter; que cela soit ou non, que t’importe? Je l’engagerai à te proposer une promenade hors de la ville, je lui persuaderai qu’il avancera ses affaires avec toi pendant cette promenade; tu l’amuseras, tu le tiendras dehors, le plus longtemps possible; je le volerai pendant ce temps-là, mais je ne m’enfuirai point, ses effets seront déjà à Turin que je serai encore dans Grenoble. Nous emploierons tout l’art possible pour le dissuader de jeter les yeux sur nous, nous aurons l’air de l’aider dans ses recherches; cependant mon départ sera annoncé, il n’étonnera point, tu me suivras, et les cent louis te sont comptés en arrivant l’une et l’autre en Piémont.
Читать дальше