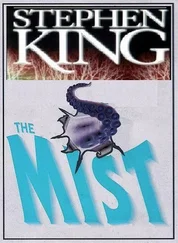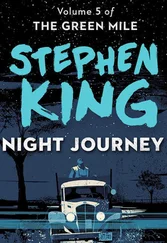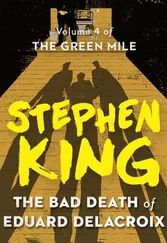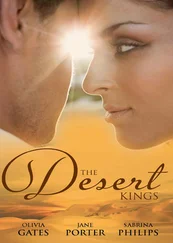Et Tim s’endormait alors, sachant qu’il était aimé et qu’il avait une place en ce monde, écoutant le vent nocturne caresser le cottage de son étrange souffle : il s’y mêlait le doux parfum des florus poussant à la lisière de la Forêt sans Fin et l’odeur âcre — mais plutôt agréable — des arbres de fer qu’on trouvait dans ses profondeurs, là où seuls les plus braves s’aventuraient.
C’étaient des temps heureux, mais comme nous l’apprennent la vie et les contes, les temps heureux jamais ne durent.
Un jour, alors que Tim avait onze ans,le Grand Ross et son associé, le Grand Kells, menèrent leurs chariots sur la Grand-Route pour gagner la Piste du Bois de Fer, comme ils le faisaient chaque jour hormis le septième, car alors tout le village de L’Arbre se reposait. Mais, ce jour-là, seul le Grand Kells revint de la forêt. Sa tunique était roussie par le feu et sa peau noircie de suie. Il y avait un trou dans la jambe gauche de sa culotte de laine. En dessous, sa peau était rougie de cloques. Il était avachi sur le banc de son chariot, comme trop fatigué pour se tenir droit.
Nell Ross sortit sur le seuil de sa maison et s’écria :
— Où est le Grand Ross ? Où est mon mari ?
Le Grand Kells secoua lentement la tête et des cendres tombèrent de ses cheveux pour se poser sur ses épaules. Il ne prononça qu’un seul mot, mais cela suffit à faire flageoler les jambes de Tim et à faire hurler sa mère.
Ce mot était dragon .
Aujourd’hui, il n’existe rien de comparable à la Forêt sans Fin, car le monde a bien changé. Il était alors plein de ténèbres et de dangers. Les bûcherons de L’Arbre le savaient mieux que personne dans l’Entre-Deux-Mondes, mais eux-mêmes ignoraient tout de ce qui pouvait vivre ou prospérer à dix roues de l’endroit où les bosquets de florus faisaient place aux arbres de fer — ces immenses et sombres sentinelles. La forêt profonde demeurait une énigme, peuplée d’étranges plantes et d’étranges animaux, d’inquiétants et puants marécages, et — disait-on — de vestiges souvent meurtriers laissés par les Anciens.
Les habitants de L’Arbre redoutaient la Forêt sans Fin — et avec raison ; le Grand Ross n’était pas le premier bûcheron à ne jamais revenir de la Piste du Bois de Fer —, mais ils l’aimaient, car c’était grâce aux arbres de fer qu’ils nourrissaient et vêtaient leurs familles. Ils savaient (même si aucun d’eux ne l’aurait avoué) que la forêt était vivante. Et, comme tous les êtres vivants, elle devait manger.
Imaginez que vous soyez un oiseau survolant cette immense étendue sauvage. Vue des hauteurs, elle évoque une robe géante, d’un vert si foncé qu’il en est presque noir. En bas court un ourlet d’un vert plus clair. Ce sont les bosquets de florus. Juste en dessous, à l’extrémité de la Baronnie du Nord, se trouve le village baptisé L’Arbre. C’était la dernière cité de cette contrée qu’on disait alors civilisée. Un jour, Tim avait demandé à son père ce que signifiait civilisé .
— Taxé, avait-il répondu en riant — mais il ne semblait pas amusé.
La plupart des bûcherons s’arrêtaient aux bosquets de florus. Le danger y était néanmoins présent. Le pire, c’étaient les serpents, et on trouvait aussi des wervels , des rongeurs venimeux aussi grands que des chiens. Au fil des ans, nombre d’hommes avaient péri parmi les florus, mais le jeu en valait la chandelle. Le bois de florus, doté d’un grain très fin et d’une belle couleur dorée, était si léger qu’il aurait pu flotter dans l’air. On l’utilisait pour construire des bateaux d’eau douce, mais il ne convenait pas à la mer, car le moindre coup de vent aurait réduit en pièces un navire bâti de bois de florus.
Non, le bois de fer était nécessaire à la navigation maritime, et Hodiak, l’envoyé de la Baronnie qui venait deux fois l’an à la scierie, l’achetait un bon prix. C’étaient les arbres de fer qui coloraient la Forêt sans Fin de ce vert tirant sur le noir, et seuls les plus hardis des bûcherons osaient les exploiter, car les dangers ne manquaient pas sur la Piste du Bois de Fer — qui ne s’enfonçait guère dans la Forêt sans Fin, rappelez-vous —, des dangers à côté desquels serpents, wervels et abeilles mutées semblaient inoffensifs.
Les dragons, par exemple.
Et c’est ainsi que, dans sa onzième année, Tim Ross perdit son pa. Désormais, plus de hache dans la main du Grand Ross, ni de pièce porte-bonheur pendant à une chaîne d’argent autour de son cou de taureau. Bientôt, sans doute n’y aurait-il plus de lopin de terre, ni de place en ce monde. Car, à cette époque, quand venait le temps de la Terre Vide, arrivait alors le Collecteur de la Baronnie. Il portait un rouleau de parchemin sur lequel figuraient toutes les familles de L’Arbre, et à chacune d’elles était associé un chiffre. Ce chiffre était le montant de la taxe due. Si vous pouviez la payer — quatre, six ou huit barrettes d’argent, voire une barrette d’or pour les grandes maisonnées —, tout allait bien. Sinon, la Baronnie confisquait votre lopin et vous étiez condamné au vagabondage. Cette décision était sans appel.
Tim passait la moitié de ses journées au cottage de la Veuve Smack, qui instruisait les enfants en échange de nourriture — des légumes en général, parfois un peu de viande. Jadis, avant que les ulcères n’aient dévoré la moitié de son visage (du moins les enfants le murmuraient-ils, mais aucun d’eux ne l’avait vu), c’était une grande dame vivant dans les lointains domaines de la Baronnie (du moins les parents le prétendaient-ils, mais aucun d’eux n’en savait rien). À présent, elle portait un voile et apprenait aux garçons les plus futés, mais aussi à quelques filles, à écrire et à pratiquer cet art quelque peu douteux qu’on appelle la mathmatica .
C’était une femme d’une intelligence redoutable, qui ne s’en laissait jamais conter et n’était que rarement fatiguée. Ses élèves finissaient en général par l’aimer, et ce en dépit de son voile et des horreurs qu’ils imaginaient en dessous. Mais, de temps à autre, elle s’écriait que sa tête allait éclater et qu’elle devait aller s’allonger. Ces jours-là, elle renvoyait les enfants chez eux, leur enjoignant parfois de dire à leurs parents qu’elle ne regrettait rien, et surtout pas son prince charmant.
Sai Smack fit une crise environ un mois après que le dragon eut incinéré le Grand Ross, et, lorsque Tim regagna son cottage, qui s’appelait Bonnevue, il jeta un coup d’œil par la fenêtre et vit que sa mère pleurait dans la cuisine, la tête posée sur la table.
Il laissa choir son ardoise, encore couverte de problèmes de mathmatica (des divisions, un sujet qu’il redoutait jusqu’à ce qu’il découvre que c’étaient tout bêtement des multiplications à l’envers), et se précipita à ses côtés. Elle leva les yeux vers lui et tenta de lui sourire. En voyant le contraste entre ses lèvres incurvées et ses yeux mouillés, Tim eut envie de pleurer lui aussi. Elle était au bout du rouleau, ça se voyait.
— Que se passe-t-il, mama ? Qu’est-ce qui ne va pas ?
— Je pensais à ton père, c’est tout. Parfois, il me manque beaucoup. Pourquoi rentres-tu si tôt ?
Il commença à lui expliquer, mais se tut en voyant la bourse en daim fermée par un lacet. Elle avait posé son bras dessus, comme pour la dissimuler, et quand elle comprit qu’il l’avait repérée, elle l’enleva de la table pour la poser sur son giron.
Tim était loin d’être idiot, aussi prépara-t-il du thé avant de dire quoi que ce soit. Lorsqu’elle en eut bu quelques gorgées — avec du sucre, avait-il insisté, bien qu’il n’en reste guère dans le pot — et se fut un peu calmée, il lui demanda ce qui n’allait pas.
Читать дальше