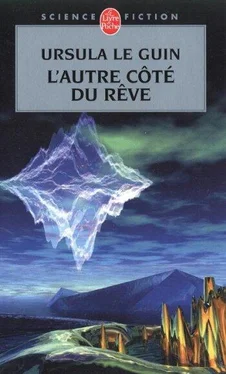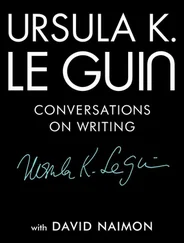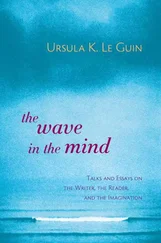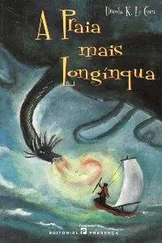— Mais ce n’est pas un psychotique, d’après ce que vous m’avez dit, remarqua Miss Lelache d’un air soupçonneux.
— Exact. J’ai dit : déséquilibré. S’il craque, bien sûr, il craquera complètement, pour tomber sans doute dans la schizophrénie catatonique. Une personne déséquilibrée n’est pas moins susceptible de devenir psychotique qu’un être normal.
Il ne pouvait plus parler, les mots se desséchaient sur sa langue, se transformaient en brindilles de sottises. Il lui semblait qu’il avait débité pendant des heures un déluge de phrases absurdes, et maintenant il ne pouvait plus du tout le contrôler. Heureusement Miss Lelache également n’en pouvait plus, c’était visible ; elle cliqueta, lui serra la main et sortit.
Haber se dirigea aussitôt vers le magnétoscope dissimulé derrière un panneau de bois mural, près du divan, avec lequel il enregistrait toutes les séances ; les magnétophones silencieux étaient un privilège des psychothérapeutes et du Bureau des Renseignements. Il effaça l’enregistrement de l’heure passée.
Il s’assit dans son fauteuil derrière le grand bureau de chêne, ouvrit le tiroir du bas, en sortit un verre et une bouteille et se versa un grand doigt de bourbon. Mon Dieu, il n’y avait pas de bourbon ici, une demi-heure auparavant – pas depuis vingt ans ! Les graines étaient bien trop précieuses, avec sept milliards de bouches à nourrir, pour en faire des liqueurs. Il n’y avait que de la pseudo bière ou (pour un médecin) de l’alcool pur ; voilà ce que contenait cette bouteille une demi-heure auparavant : de l’alcool pur.
Il en but la moitié d’un trait, puis resta immobile. Au bout d’un moment, il se leva et se plaça devant la fenêtre, balayant du regard les toits et les arbres. Cent mille âmes. Le soir commençait à obscurcir la rivière paisible, mais les montagnes restaient énormes et claires, lointaines, dans la lumière des hauteurs.
— À un monde meilleur ! déclara le docteur Haber en levant son verre à sa création, et il savoura une longue gorgée de whisky.
Il nous faudra peut-être continuer à apprendre… que notre tâche ne fait que commencer, et qu’il ne nous sera jamais donné la moindre assistance, sinon celle du Temps impénétrable et indicible. Nous devrons peut-être apprendre que le tourbillon infini de la mort et de la naissance, auquel nous ne pouvons échapper, est né de notre propre création, de notre propre quête ; que les forces qui constituent les mondes sont les erreurs du Passé ; que le chagrin éternel n’est que la faim éternelle d’un désir insatiable ; et que les soleils éteints ne peuvent être rallumés que par les passions inextinguibles des vies disparues.
Lafcadio Hearn,
Out of the East .
L’appartement de George Orr se situait au dernier étage d’une vieille maison de bois, dans Corbett Avenue, en remontant la colline ; un quartier minable où la plupart des habitations étaient vieilles d’un siècle, ou même plus. Il avait trois grandes pièces, une salle de bains avec une volumineuse baignoire à pieds et, par-dessus les toits, on voyait la rivière, sur laquelle passaient des péniches, des bateaux de plaisance, des troncs d’arbres, des mouettes, de longs vols tournoyants de pigeons.
Il se souvenait parfaitement de son ancien appartement, bien sûr : le studio de 2,50 m × 3 m, avec le fourneau et le lit mural, et la salle de bains commune, au fond du couloir recouvert de linoléum, au dix-huitième étage de la tour Corbett Condominium, qui n’avait jamais été construite. Il descendit du trolley à Whiteaker Street et remonta la colline, puis les larges escaliers sombres ; il entra, laissa tomber sa sacoche sur le sol et s’allongea sur le lit. Il était terrifié, angoissé, effaré, épuisé. « Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose », pensait-il sans cesse, mais il ne savait pas quoi faire. Il n’avait jamais su quoi faire. Il avait toujours fait ce qui semblait devoir se faire, sans poser de questions, sans se forcer, sans même s’en préoccuper. Mais cette assurance l’avait quitté quand il avait commencé à prendre des drogues, et maintenant, il était complètement perdu. Il fallait qu’il agisse ; il devait agir . Il ne devait plus laisser Haber se servir de lui comme d’un outil. Il devait s’occuper lui-même de son destin.
Il ouvrit ses mains et les regarda, puis il y enfouit son visage ; celui-ci était mouillé de larmes. « Oh, bon sang, pensa-t-il amèrement, quelle sorte d’homme suis-je donc ? Des larmes plein ma barbe ? Pas étonnant que Haber se serve de moi. Comment pourrait-il s’en empêcher ? Je n’ai pas la moindre force, pas la moindre volonté, je suis un outil-né. Je n’ai pas d’avenir. Je n’ai que mes rêves. Et maintenant, ce sont les autres qui les dirigent. »
« Je dois échapper à Haber », se dit-il encore, essayant d’être ferme et résolu ; mais, même en pensant cela, il savait qu’il ne le ferait pas. Haber le tenait, et par plus d’un moyen.
Une structure aussi inhabituelle, en fait unique, avait dit Haber, était inestimable pour la recherche scientifique : la contribution d’Orr à la connaissance humaine serait énorme. Orr croyait que Haber en était persuadé, et savait de quoi il parlait. Pour lui, l’aspect scientifique de la chose était le seul aspect positif ; il lui semblait que la science pourrait peut-être tirer un peu de bien de son don terrible et si particulier, l’employer à quelques fins utiles, ce qui compenserait un peu le mal immense qu’il avait fait.
Le meurtre de six milliards de gens qui n’existaient pas !
Orr avait atrocement mal à la tête. Il fit couler de l’eau froide dans la grande baignoire craquelée et y plongea tout le visage pendant une demi-minute, pour en ressortir trempé, rouge et aveuglé, comme un bébé qui vient de naître.
Haber le tenait ainsi par un lien moral, mais aussi, et surtout, par un lien légal. Si Orr abandonnait le traitement thérapeutique volontaire, il serait poursuivi pour avoir obtenu des médicaments d’une façon illégale, et serait envoyé en prison ou à l’asile. Il ne s’en sortirait pas de cette manière. Et s’il n’abandonnait pas le traitement, mais négligeait les visites à son psychiatre et refusait de coopérer, Haber possédait un redoutable moyen de coercition : les drogues supprimant les rêves, qu’Orr ne pouvait se procurer qu’avec une ordonnance du docteur. À présent, il était plus effrayé que jamais à l’idée de rêver spontanément, sans contrôle. Dans l’état où il était, et ayant été entraîné à rêver d’une façon effective chaque fois qu’il se rendait au laboratoire, il ne voulait pas songer à ce qui pourrait arriver s’il faisait un rêve effectif sans la retenue rationnelle imposée par l’hypnose. Ce serait un cauchemar, un cauchemar pire que celui qu’il venait de faire dans le bureau de Haber ; il en était sûr, et ne voulait pas que cela se produise. Il devait prendre des drogues atténuantes. C’était la seule chose qu’il savait devoir faire, qui devait être faite. Mais il ne le pourrait que tant que Haber le lui permettrait ; donc, il devait coopérer avec lui. Il était pris. Fait comme un rat. Il courait dans le labyrinthe du savant fou, et il n’y avait pas d’issue. Aucune issue.
« Mais ce n’est pas un savant fou, pensa Orr avec lassitude, il est plutôt sain d’esprit, ou du moins il l’était. C’est cette possibilité de puissance que lui donnent mes rêves qui le rend ainsi. Cela lui procure des atouts majeurs. Et maintenant, il utilise même sa science comme un moyen et non comme une fin… Mais ses intentions sont bonnes, pas vrai ? Il veut améliorer la vie de l’humanité. Est-ce mal ? »
Читать дальше