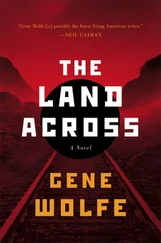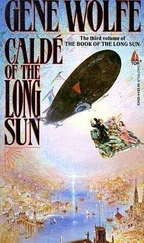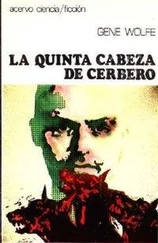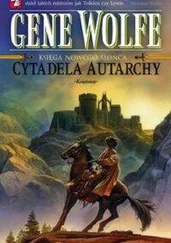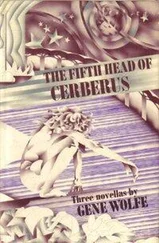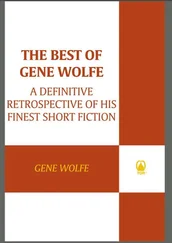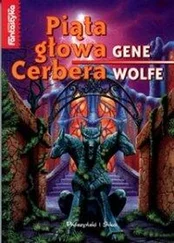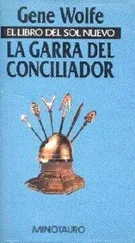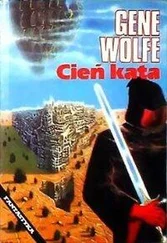Notre théâtre, comme je l’ai dit, fonctionna tout l’été et donna sa dernière représentation lorsque les feuilles mortes volèrent, telles de vieilles lettres obscures et parfumées que le vent emporte d’un coffre abandonné, jusque sur notre scène. Après avoir salué une dernière fois le public, nous qui avions écrit et joué les pièces de la saison étions trop las pour pouvoir faire autre chose que retirer nos costumes et notre maquillage et prendre, avec les derniers spectateurs attardés, le chemin de la maison, hanté par le cri nocturne de l’engoulevent. J’étais prêt, je m’en souviens, à prendre mes fonctions à la porte de la maison de mon père, mais cette nuit-là son valet m’attendait dans le hall d’entrée, avec pour instructions l’ordre de me conduire directement à la bibliothèque, où mon père m’expliqua avec brusquerie qu’il était obligé de consacrer une partie de la nuit à ses affaires et que pour cette raison il préférait s’occuper de moi (comme il disait) plus tôt. Il paraissait fatigué et en mauvaise santé, et il me vint à l’idée, pour la première fois je crois, qu’il mourrait un jour, et que je deviendrais ce jour-là en même temps riche et libre.
Ce que les drogues me firent dire cette nuit-là, je ne m’en souviens pas, bien sûr, mais je me rappelle avec autant de clarté que si je venais d’en sortir le rêve que je fis ensuite. J’étais sur un bateau, un bateau blanc pareil à ceux que les bœufs tirent, si lentement que leur étrave pointue ne trace aucun sillage, dans les eaux vertes du canal à côté du parc. J’étais le seul membre de l’équipage, et en fait le seul homme vivant à bord. À l’arrière, tenant la roue du gouvernail d’une façon si molle que c’était elle qui semblait le soutenir et le guider plutôt que le contraire, se tenait le cadavre d’un homme grand et maigre dont le visage, quand il se présenta de profil à moi, était exactement celui qui flottait sur l’écran de Mr Million. Ce visage, comme je l’ai dit, ressemblait beaucoup à celui de mon père, mais je savais que le mort qui tenait le gouvernail n’était pas mon père.
Je restai longtemps à bord de ce navire. Il semblait dériver, sous un vent fort qui venait de bâbord. Quand je grimpais dans la mâture la nuit, les mâts et les espars et les agrès frémissaient et chantaient au vent, les voiles s’étageaient au-dessus de ma tête et au-dessous de moi, et j’avais d’autres mâts drapés de voiles blanches devant et derrière. Quand je travaillais sur le pont dans la journée, les embruns mouillaient ma chemise et laissaient des traces en forme de larmes sur les planches qui séchaient rapidement au soleil.
Je ne me souviens pas être jamais monté sur un navire de ce genre, mais il est possible que je l’aie fait étant tout jeune, car tous les bruits, le grincement des mâts dans leur socle, le sifflement du vent dans les milliers de cordages, le fracas des vagues contre la coque de bois, étaient aussi distincts, aussi réels, aussi eux-mêmes que les bruits de rires et de verres brisés que j’entendais le soir, enfant, avant de m’endormir, ou que les clairons de la citadelle qui me réveillaient parfois le matin.
Je faisais un travail, je ne sais pas lequel au juste, à bord de ce navire. Je portais des seaux d’eau avec lesquels je nettoyais les traces de sang séché sur le pont, je halais des filins qui ne semblaient attachés à rien — ou plutôt, fermement attachés à des objets impossibles à déplacer encore plus haut dans les gréements. Je scrutais la surface de l’eau depuis la proue et la rambarde, du haut des mâts et du sommet d’une grande cabine qui se trouvait au milieu du navire, mais quand un stellaris, ses panneaux d’entrée dans l’atmosphère aveuglants de chaleur, plongeait en sifflant dans la mer, je n’avais de rapport à faire à personne.
Et pendant tout ce temps, le mort qui tenait le gouvernail me parlait. Sa tête pendait mollement, comme s’il avait le cou brisé, et les secousses de la roue chaque fois que le gouvernail heurtait une lame l’envoyaient d’une épaule à l’autre, ou la relevaient vers le ciel, ou la penchaient vers le pont. Mais elle continuait de me parler, et les rares mots que je saisissais suggéraient que le mort était en train de m’exposer une théorie d’éthique dont les postulats paraissaient douteux même à lui. J’étais terrorisé à l’idée d’entendre ce qu’il disait, et je me tenais le plus possible à l’avant. Mais il y avait des moments où le vent me portait ses paroles avec une grande clarté, et chaque fois que je levais les yeux de mon travail je me retrouvais beaucoup plus près de l’arrière, parfois juste à côté du timonier fantôme, que je ne l’avais supposé.
Lorsque j’eus séjourné longtemps sur ce navire, au point de me sentir très seul et très fatigué, une des portes de la cabine s’ouvrit et ma tante en sortit, flottant bien droite à une cinquantaine de centimètres du pont incliné. Sa robe ne pendait pas verticalement, comme d’habitude, mais battait au vent comme une banderole, et semblait sur le point de s’envoler. Je ne sais pas pourquoi, je lui dis : « N’approchez pas de cet homme qui tient le gouvernail, ma tante. Il pourrait vous faire du mal. »
Elle répondit, aussi naturellement que si nous nous étions rencontrés dans le couloir devant ma chambre :
« Ridicule. Il y a longtemps qu’il ne peut plus faire ni de bien ni de mal à personne, Numéro Cinq. C’est de mon frère qu’il faut nous inquiéter. »
« Où est-il ? »
« En bas. » Elle indiqua du doigt le pont, comme si elle voulait dire qu’il était dans la cale. « Il essaye de découvrir pourquoi le navire n’avance pas. »
Je courus vers la lisse, et regardai par-dessus bord. Et au lieu de voir la mer, je vis le ciel nocturne. Les étoiles — d’innombrables étoiles — s’étendaient sur une distance infinie au-dessous de moi, et en les regardant, je m’aperçus que le navire, comme venait de le dire ma tante, n’avançait pas, et ne roulait même pas, mais restait stable et immobile. Je me tournai vers elle, et elle me dit : « Il n’avance pas parce qu’il l’a amarré jusqu’à ce qu’il découvre pourquoi il n’avance pas. » Et à ce moment-là, je me trouvai en train de glisser le long d’un filin vers ce que je supposai être la cale du navire. Il y avait une odeur de bêtes. Je m’étais réveillé, bien qu’au début je ne m’en fusse pas aperçu.
Mes pieds touchèrent le sol, et je vis que David et Phaedria étaient à côté de moi. Nous étions dans une sorte d’énorme grenier, et lorsque mon regard se porta sur Phaedria, qui était ravissante mais tendue et inquiète, un coq lança son cri.
David demanda : « Où croyez-vous que se trouve l’argent ? » Il portait avec lui une trousse à outils.
Et Phaedria, qui sans doute s’était attendue à l’entendre dire quelque chose d’autre, ou bien faisant écho à ses propres pensées, déclara : « Nous avons largement le temps, Marydol fait le guet. » Marydol était l’une des filles qui faisaient partie de notre troupe.
« Si elle ne se sauve pas. Où peut être l’argent ? »
« Pas là-haut. Plutôt en bas, derrière son bureau. » Elle était accroupie, mais elle se redressa et commença à avancer. Elle était entièrement en noir, depuis les ballerines jusqu’au ruban noué dans ses cheveux, et son visage et ses bras blancs formaient un contraste violent tandis que ses lèvres carminées ne pouvaient être qu’une erreur, un morceau de couleur oublié par inadvertance. David et moi nous la suivîmes.
Il y avait des caisses éparpillées un peu partout, et quand nous passâmes devant je vis qu’elles servaient de poulaillers, et qu’elles abritaient chacune une volaille. Ce n’est que lorsque nous fûmes presque arrivés à l’échelle qui descendait par une trappe à l’extrémité opposée du grenier que je réalisai que les volailles étaient des coqs de combat. Puis un rayon de soleil filtrant par une des lucarnes éclaira une caisse, et le coq se dressa puis s’étira en révélant de féroces yeux rouges et un plumage aussi éclatant que celui d’un ara. « Venez », dit Phaedria. « Maintenant, ce sont les chiens. » Et nous descendîmes l’échelle à sa suite. L’enfer se déchaîna à l’étage au-dessous.
Читать дальше