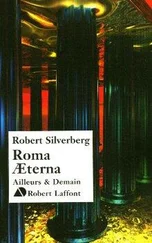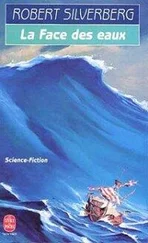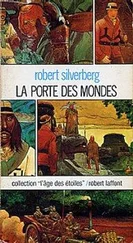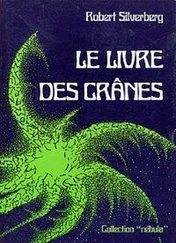J’avais douze ans et je commençais à devenir un homme quand mourut le septarque. J’étais à son côté lorsque la mort le prit. Afin d’échapper à la saison des pluies, il s’en allait chaque année chasser le cornevole dans les Basses Terres Arides, dans la zone même où, à l’heure actuelle, je me cache et attends. Jamais je ne l’avais accompagné, mais, en cette occasion, j’avais été autorisé à suivre la chasse, car j’étais désormais un jeune prince et je devais apprendre à pratiquer les activités qui convenaient à mon rang. Stirron, en tant que futur septarque, avait d’autres tâches à remplir : en l’absence de mon père, il restait dans la capitale pour le remplacer comme régent. Sous un ciel ennuagé aux teintes mornes, l’expédition, composée d’une vingtaine de voitures, se mit en route en direction de l’ouest, à travers les terres plates, détrempées et dénudées par l’hiver. Cette année-là, les pluies étaient sans merci, transformant en bourbiers les précieuses parcelles de sol fertile et érodant les affleurements rocheux de notre province. Partout, les fermiers réparaient leurs digues, sans résultat ; en voyant les rivières gonflées charrier dans leurs eaux brunâtres les richesses perdues de Salla, j’avais envie de pleurer à l’idée de ces trésors qui allaient être déversés dans la mer. Nous arrivâmes dans Salla-Ouest, et la route étroite commença à grimper les premiers contreforts de la chaîne des Huishtors ; bientôt, nous fûmes dans une région plus sèche et plus froide, où de la neige et non de la pluie tombait du ciel, et où les arbres n’étaient que des squelettes noueux se détachant sur la blancheur aveuglante de la couche neigeuse. Nous prîmes la route qui montait vers le Kongoroï. Les paysans sortaient de chez eux pour chanter des chants de bienvenue au passage du septarque. Les montagnes nues se dressaient comme des dents pourpres fendant le ciel gris, et, même à l’intérieur des voitures, nous frissonnions, mais la beauté majestueuse de l’endroit m’empêchait de penser à cet inconfort. De grands pans rocheux flanquaient la route caillouteuse et il n’y avait pratiquement ni terre ni arbres, sauf dans quelques lieux ombragés. En regardant derrière nous, nous pouvions voir Salla s’étaler sous nos yeux comme une carte, avec la blancheur des régions occidentales et les amas foncés qui parsemaient la rive orientale, plus habitée : tout cela diminué et rendu irréel par la distance. Jamais je ne m’étais autant éloigné de chez moi. Malgré l’altitude où nous nous trouvions – à mi-chemin, semblait-il, entre la mer et le ciel – les plus hauts sommets des Huishtors s’élevaient encore devant nous, comme un mur compact barrant le continent du nord au sud. Leurs crêtes neigeuses et déchiquetées couronnaient leurs versants abrupts, et je me demandais si nous allions poursuivre ainsi notre route jusqu’en haut ou s’il existait réellement un passage. J’avais entendu parler de la Porte de Salla et je savais que notre route y menait, mais elle m’apparaissait plus ou moins mythique en cet instant.
Et nous montions toujours ; nos moteurs hoquetaient dans l’air glacial, et nous devions souvent nous arrêter pour en dégeler les tuyauteries ; dans l’air raréfié, nous avions peine à respirer et notre tête tournait. La nuit, nous nous reposions dans les camps aménagés à l’intention des septarques en déplacement, mais leur installation était loin d’être royale, et dans l’un d’eux, où une équipe entière de serviteurs avait péri quelques semaines auparavant dans une avalanche, nous dûmes nous frayer une voie à travers des monceaux de neige entassée pour nous ménager un accès. Tous les membres de l’expédition appartenaient à la noblesse, et tous manièrent eux-mêmes la pelle, sauf le septarque, pour qui le travail manuel eût été un péché. Comme j’étais l’un des plus robustes, je creusais plus vigoureusement que quiconque, et, comme j’étais jeune et impétueux, je me dépensais sans compter. Je finis par m’effondrer inanimé dans la neige, où je demeurai pendant une heure avant qu’on me remarque. Mon père vint à moi alors qu’on me soignait et m’accorda un de ses rares sourires ; sur le moment, je pris cela pour une marque d’affection, ce qui aida grandement à mon rétablissement ; mais, après coup, j’en vins à penser que c’était plus probablement de sa part un signe de mépris.
Ce sourire me soutint durant le reste de notre ascension des Huishtors. Je n’avais plus hâte d’avoir passé les montagnes, car je savais que nous finissions par atteindre notre but et que, sur l’autre versant, mon père et moi chasserions ensemble le cornevole, nous gardant mutuellement des périls, traquant le gibier côte à côte, en une intimité qui n’avait jamais existé entre nous au cours de mon enfance. Quelque temps après, j’en parlai à mon frère par le lien Noïm Condorit, qui voyageait dans la même voiture que moi et qui était le seul être au monde à qui je pouvais confier de telles choses. « On espère être choisi pour faire partie du groupe de chasse personnel du septarque, lui dis-je. On a une raison de penser qu’on en recevra la demande. Et un terme sera mis à la distance entre le père et le fils.
— On rêve, me répondit Noïm Condorit. On confond son imagination avec la réalité.
— On pourrait espérer, répliquai-je, recevoir plus d’encouragements de la part de son frère par le lien. »
Noïm était toujours pessimiste ; je ne fus pas affecté par son propos et me mis à compter les jours qui nous séparaient de la Porte de Salla. Quand nous l’atteignîmes, je n’étais pas préparé à la splendeur du lieu. Toute la matinée et une partie de l’après-midi, nous avions suivi une route escarpée au flanc du mont Kongoroï, baignés par l’ombre que projetait son énorme double sommet. J’avais l’impression que notre ascension était sans fin, et toujours le Kongoroï nous dominait de toute sa hauteur. Puis notre caravane obliqua vers la gauche, les voitures disparaissant l’une après l’autre derrière un pylône enrobé de neige sur le bord de la route, et, quand ce fut le tour de la nôtre et qu’elle eut atteint le tournant, je pus contempler un spectacle grandiose : une large faille dans la paroi montagneuse, comme si une main cosmique avait soulevé un quartier du Kongoroï. Et, à travers cette faille, jaillissait la lumière du jour ainsi qu’une gerbe éblouissante. C’était la Porte de Salla, la passe légendaire par laquelle nos ancêtres avaient pénétré pour la première fois dans notre province, au terme de leur errance dans les Terres Arides. Nous la franchîmes joyeusement, à deux et même à trois véhicules de front, et, avant d’établir notre camp pour la nuit, nous pûmes contempler dans toute leur étrange splendeur les Terres Arides, dont le paysage étonnant s’étendait au pied de la montagne.
Les deux jours suivants, nous descendîmes le versant occidental du Kongoroï, avançant avec une comique lenteur sur une route en lacets à la dangereuse étroitesse : une fausse manœuvre, et un véhicule pouvait être précipité dans le vide. Il n’y avait pas de neige sur cette face des Huishtors, et la roche baignée de soleil avait un aspect oppressant qui engourdissait les sens. Devant nous, en contrebas, il n’y avait que l’étendue rougeâtre du désert vers lequel nous descendions. Nous abandonnions l’hiver pour gagner un monde suffocant, où chaque inspiration picotait les poumons, où le vent sec soulevait en nuages la poussière du sol, où des bêtes aux formes étranges s’enfuyaient avec terreur à notre approche. Le sixième jour, nous parvînmes à l’entrée de notre terrain de chasse, un lieu d’escarpements déchiquetés, situé très au-dessous du niveau de la mer. À l’heure actuelle, je ne suis pas à plus d’une heure de marche de ce site. C’est là que nichent les cornevoles ; le jour durant, ils sillonnent les plaines calcinées, en quête de proies, et, au crépuscule, ils rentrent en décrivant d’étranges spirales à la verticale pour regagner leurs gîtes presque inaccessibles.
Читать дальше