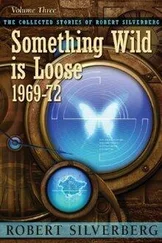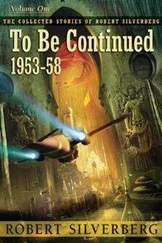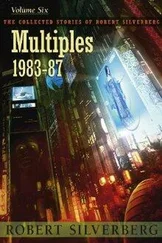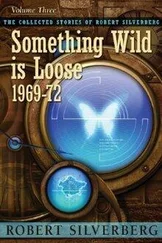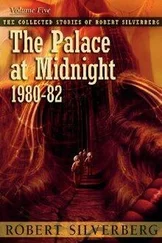Voilà mon client, le demi d’ouverture aux épaules carrées, Paul F. Bruno. Son visage est gonflé et violacé, et il n’a pas le sourire, comme si les exploits de samedi dernier lui avaient coûté quelques dents. Je défais l’élastique, je sors Les romans de Kafka et je lui remets la dissertation. « Six pages », lui dis-je. Il m’a donné dix dollars d’avance. « Vous me redevez onze dollars. Vous voulez la lire d’abord ? »
« Est-ce que c’est bon ? »
« Vous n’aurez pas à vous en plaindre. »
« Je vous crois sur parole », fait-il. Il esquisse un sourire pénible, la bouche fermée. Il extrait son portefeuille rebondi et me glisse des billets dans la main. Je pénètre rapidement son esprit, juste comme ça maintenant que j’ai retrouvé mon pouvoir, une petite incursion psychique, et je capte quelques pensées de surface : des dents cassées à la dernière rencontre de rugby, de douces chatteries compensatrices le soir au club de sa fraternité, de vagues projets de baisage après le match de samedi prochain, etc. Pour ce qui touche la transaction présente, je détecte de la culpabilité, de l’embarras et même du ressentiment envers moi pour l’avoir aidé. Bah. La gratitude du goy. J’empoche son argent. Il me gratifie d’un bref signe de tête et enserre Les romans de Kafka sous son énorme avant-bras. Honteux, il dévale précipitamment les marches et prend la direction de Hamilton Hall. Je contemple son dos d’athlète qui s’éloigne. Une soudaine bouffée de brise malveillante se lève de l’Hudson et s’approche vers l’est. Elle me perce jusqu’à l’os.
Bruno s’est arrêté devant le cadran solaire, où un étudiant noir grand et maigre qui doit dépasser deux mètres l’a intercepté. Un joueur de basket, de toute évidence. Le Noir porte un blazer, des baskets vertes et un pantalon jaune à manches tubulaires. Rien que ses jambes semblent mesurer un mètre cinquante. Bruno et lui parlent quelques instants. Bruno pointe son doigt dans ma direction. Le Noir hoche la tête. Je suis sur le point de gagner un nouveau client. Bruno disparaît, et le Noir trotte sur ses longues jambes vers les marches qu’il escalade. Il a la peau extrêmement foncée, tirant presque sur le bleu, et cependant les traits de son visage ont une acuité caucasienne : pommettes avancées, nez aquilin et fier, lèvres minces et froides. Il est terriblement beau. C’est une sorte de statue ambulante, une idole. Peut-être que ses gènes ne sont pas du tout négroïdes : un Éthiopien, qui sait ? Ou bien un habitant des bords du Nil ? Pourtant, il a une masse de cheveux frisés soigneusement arrangés à la manière afro en un halo agressif de trente centimètres de diamètre au moins. Je n’aurais pas été surpris s’il avait eu des joues scarifiées et un os en travers des narines. Tandis qu’il s’approche de moi, mon esprit, à peine entrouvert, perçoit l’émanation périphérique générale de sa personnalité. Tout est comme prévu, d’une manière stéréotypée même. Je m’attendais à le trouver crispé, arrogant, hostile, sur la défensive, et je reçois un embrouillamini de féroce fierté raciale, d’écrasante autosatisfaction physique, et de défiance explosive, particulièrement vis-à-vis des Blancs. D’accord. Ce n’est pas nouveau.
Son ombre démesurée tombe soudain sur moi tandis que le soleil transperce momentanément les nuages. Il oscille latéralement sur la pointe des pieds. « Vous vous appelez Selig ? » demande-t-il. Je fais un signe de tête affirmatif. « Yahya Lumumba », fait-il.
« Je vous demande pardon ? »
« Yahya Lumumba. » Ses yeux, d’un blanc luisant contre le bleu luisant de sa peau, étincellent de fureur. De son ton impatient, je déduis qu’il est en train de me dire son nom, ou du moins le nom qu’il préfère qu’on lui donne. Sa voix indique aussi qu’il est convaincu que n’importe qui sur le campus a entendu ce nom. Mais moi, je ne suis pas obligé de m’intéresser aux vedettes de basket-ball universitaires. Il pourrait enfiler le ballon dans le panier cinquante fois consécutives par match que je n’entendrais quand même pas parler de lui.
« On m’a dit que vous faites des dissertations », me dit-il. « Exact. »
« Vous êtes recommandé par mon copain Bruno, là-bas. Combien vous prenez ? »
« Trois dollars et demi la page. Dactylographiée, double interligne. »
Il réfléchit. Il découvre d’innombrables dents et dit : « Qu’est-ce que c’est que cette putain de combine ? »
« C’est ainsi que je gagne ma vie, Mr. Lumumba. » Je me déteste aussitôt pour cette forme d’adresse servile et lâche. « Ça fait une vingtaine de dollars pour un devoir de longueur moyenne. Il faut du temps pour faire quelque chose de correct, vous ne croyez pas ? »
« Ouais, ouais. » Un haussement d’épaules élaboré. « D’accord. Je ne vais pas discuter, mon vieux. J’ai besoin de votre travail. Vous avez entendu parler d’Heuropide ? »
« Euripide ? »
« C’est ce que j’ai dit. » Il s’amuse avec moi, en me sortant ses maniérismes noirs de marchand de pastèques. « Heuropide. Ce mec qui écrivait des tragédies grecques. »
« Je vois ce que vous voulez dire, Mr. Lumumba. De quelle sorte de dissertation avez-vous besoin ? »
Il sort un morceau de feuille d’agenda froissée d’une poche de sa veste et la consulte avec force singeries. « Le prof, il veut qu’on compare le thème d’Electre dans Heuropide, Sophocle et Hetch. Hecht. »
« Eschyle ? »
« C’est celui-là, oui. De cinq à dix pages. À remettre le 10 novembre. Vous pouvez vous arranger ? »
« Je pense », lui dis-je en sortant mon stylo. « Il ne devrait pas y avoir de problème. » Surtout que j’ai dans mes archives un devoir de mon cru, récolte 1952, qui couvre exactement ce vieux thème d’humanités. « Mais il me faut quelques renseignements sur vous pour établir l’entête. L’orthographe exacte de votre nom, le nom du professeur, le numéro du cours… » Tandis que je note les coordonnées qu’il me donne, j’entrouvre mon esprit pour le petit coup de sonde habituel à l’intérieur du client, de manière à me faire une idée du ton à employer dans la dissertation. Serai-je capable d’imiter de façon convaincante le genre de style qu’un Yahya Lumumba est susceptible d’employer ? Ce sera une prouesse technique épuisante, si je suis obligé de rédiger tout dans le jargon noir à la mode, pittoresque et haut en couleur, se foutant de la gueule du prof blanc à chaque coin de ligne. Je pourrais le faire, je suppose. Mais est-ce bien ce que veut Lumumba ? Pensera-t-il que je suis en train de le singer si j’adopte le style à la coule en ayant l’air de me payer sa tête comme il pourrait se payer celle du prof ? Il faut que je sache à quoi m’en tenir. Je glisse mes tentacules dans sa tête laineuse, je les plonge dans la gelée grise invisible. Salut, grand homme noir. D’entrée de jeu, je reçois une version un peu plus immédiate et percutante de la personnalité globale qu’il projette constamment. La fierté noire exacerbée, la défiance envers l’inconnu au visage pâle, la conscience rengorgée de son grand corps athlétique. Mais ce ne sont là que des attitudes résiduelles, le mobilier standard de son esprit. Je n’ai pas encore atteint le niveau de la pensée immédiate. Je n’ai pas pénétré jusqu’au Lumumba essentiel, l’individu unique dont je dois revêtir le style. Je m’enfonce un peu plus. Ce faisant, je perçois un réchauffement distinct de la température psychique, un déferlement de chaleur comparable, peut-être, à ce que doit éprouver un mineur à huit mille mètres sous terre, en train de creuser son chemin vers les feux magmatiques du centre de la terre. Ce Yahya Lumumba, je le constate, est en continuelle ébullition intérieure, l’éclat de son âme tumultueuse m’avertit d’être prudent, mais je n’ai pas encore trouvé les renseignements que je cherche, et je continue d’avancer jusqu’à ce que, abruptement, la violence en fusion de son courant de conscience me heurte de plein fouet.
Читать дальше