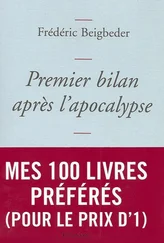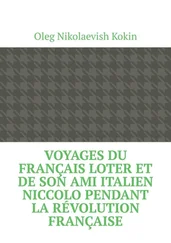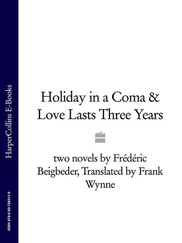Je me suis retrouvé seul avec un lascar qui venait d’être arrêté pour exhibitionnisme et vol à l’étalage. Je n’osais lui demander s’il avait d’abord volé des pommes avant de montrer son sexe à une cliente, ou s’il avait commencé par l’exhiber à la caissière avant de subtiliser une boîte de cassoulet, ou si les deux actes étaient simultanés : il devait falloir beaucoup d’adresse pour baisser son pantalon devant une ménagère de moins de cinquante ans tout en la délestant de son porte-monnaie. L’individu était en tout cas ivre et agressif, il ne cessait d’insulter la maréchaussée, dès qu’il me reconnut il devint menaçant, me demandant de lui donner 10 000 euros, criant mon nom pour que les autres prévenus sachent qui était là, et les autres prisonniers se mirent à leur tour à répéter le nom de la chaîne de télé qui m’employait, à me menacer de kidnapping ou de révélations à la presse. Le mot « enculé » revenait souvent dans leur bouche, comme une obsession, une préoccupation, peut-être un désir inavoué.
— J’ai un pote qui bosse à la Poste, il trouvera ton adresse en deux minutes sur internet. On viendra chez toi.
Je ne bronchais pas, je restais muet. Je me suis allongé en position fœtale sur un matelas en mousse dégueulasse posé au sol pour faire semblant de dormir au milieu des pelotes de poussière et des cafards morts. Mais je n’ai pas trouvé le sommeil. J’ai regretté de ne pas avoir mémorisé les mantras du hatha yoga de Sri Krishnamacharya, qui permet une ascèse engageant toutes les forces du corps et de l’esprit.
J’habite mon enfance, je m’installe dedans, j’ai le sofa mental.
Les seuls noms propres de mon enfance dont je me souvienne sont ceux des filles que j’aimais et qui n’en surent jamais rien : Marie-Aline Dehaussy, les sœurs Mirailh, Clarence Jacquard, Cécile Favreau, Claire Guionnet, Michèle Luthala, Béatrice Kahn, Agathe Olivier, Axelle Batonnier… Je crois que la plupart sont sorties avec mon frère, mais les époques et les lieux se mélangent… Ma tante Delphine m’assure que la première fille que j’ai embrassée sur la bouche est Marie-Aline, dans une cabane en bois sur la grande plage de Guéthary. Ma mère a longtemps conservé une photo de nous deux bras dessus bras dessous ; nous sourions fièrement, nos maillots de bain sont mouillés, du sable saupoudre nos cheveux. Une fossette se creuse dans sa joue quand elle sourit, la même que la mienne. Nous avions huit ou neuf ans, le premier bisou sur les lèvres était un grand événement pour moi, mais pour elle ? Je n’en sais rien. Mon frère et ma tante l’appelaient gentiment ma « fiancée » pour me faire rougir. Ai-je été plus heureux qu’en ce jour oublié ?
Je me souviens mieux de la première fille embrassée avec la bouche ouverte, en rentrant la langue. C’était beaucoup plus tard, à treize ans, dans une boum d’après-midi, rue de Buci. La fille n’était pas terrible mais un copain portant un blouson en jean Wrangler m’avait indiqué qu’elle était d’accord pour danser le slow. Il l’avait poussée vers moi tandis que je me baissais pour refaire mes lacets de Kickers, le temps de dérougir. C’était une blonde prénommée Vera, une Américaine du même âge que moi. Quand elle m’a souri, j’ai compris pourquoi elle n’était pas dégoûtée par mes bagues métalliques sur les dents : elle portait le même pare-chocs en ferraille. J’ai posé mes mains sur ses épaules mais elle me les a descendues sur ses hanches ; c’était elle qui détenait le pouvoir. Les volets étaient fermés, Vera sentait la transpiration, et moi aussi je puais sous les bras dans mon tee-shirt « Fruit of the Loom ». Quatre ampoules de couleur (une rouge, une verte, une bleue et une jaune) clignotaient approximativement en rythme sur If you leave me now de Chicago (première pelle, debout) et I’m not in love de 1 °CC (deuxième pelle, assis sur le canapé). Ces chansons me font encore pleurer à chaque fois que je les entends. Quand elles passent à la radio, si quelqu’un ose parler, zapper, ou envisage de baisser le son, je peux commettre un meurtre. J’ai appris par la suite que le garçon qui m’avait présenté Vera avait ordonné à l’Américaine de sortir avec moi parce que sinon j’allais devenir pédé — je restais seul dans mon coin à boire du Fruité à la pomme et au cassis, la tête baissée sur une tranche de Savane séchée dans une assiette en carton, cachant tant bien que mal mon sourire orthodontique. À treize ans, j’étais le dernier garçon de la classe qui n’avait jamais roulé de patins. Vera m’avait galoché pour amuser ses potes ; mon premier « french kiss » est le résultat d’un pari humiliant. Quand je l’ai su, je me suis senti merdique mais j’étais tout de même fier d’avoir franchi une étape : tourner ma langue dans d’autres appareils dentaires que les miens. J’ai crâné pendant au moins une semaine dans la cour de récréation du lycée Montaigne. Il n’y avait pas de filles à l’école Bossuet, puis soudain, à partir de la 6 e, je me suis retrouvé dans la classe mixte d’un collège public. Jusqu’à cette boum rue de Buci, j’étais puceau de la bouche. J’ai découvert à Montaigne ce que serait mon adolescence : une litanie d’amours muettes, un mélange de douleur exacerbée, de désir dispersé, d’insatisfaction masquée, de timidité absolue, une suite de déceptions silencieuses, une collection de coups de foudre non réciproques, de malentendus, de rougissements intempestifs et vains. Ma jeunesse consisterait principalement à regarder le plafond de ma chambre en écoutant If you leave me now et I’m not in love.
Une autre fois, j’avais annoncé sur un ton victorieux à mon frère que j’avais peloté les seins de Claire, une jolie fille de ma classe. Ce furent mes premières caresses sur une poitrine à peine éclose, à travers le tee-shirt Fiorucci, par-dessus le soutien-gorge, j’avais palpé cette molle fermeté circulaire, tendresse tendue, dure au centre, ronde douceur autour de la pointe dressée… Charles m’a alors dit que j’étais débile, qu’il avait aussi peloté les seins de Claire mais sous son tee-shirt, après lui avoir enlevé son soutien-gorge : il l’avait caressée à même la peau, ô grands dieux… Une fois de plus, j’étais distancé. Mon frangin était plus fou que moi, à l’adolescence. À seize ans, il baisait des filles sur le toit de notre immeuble. Une fois, il avait dépucelé une nana dans notre chambre, je me souviens de draps ensanglantés au matin qui inquiétaient ma mère et décuplaient mon admiration. J’étais le fils timide et lui le déjanté. À un moment, il a choisi de rentrer dans le rang, de dompter le malade qui est en lui… Je me suis empressé de reprendre le créneau.
Je n’ai pas non plus oublié Clarence Jacquard, la voisine d’en face rue Coëtlogon. Je l’aimais sans jamais le lui dire. Je rougissais trop pour pouvoir lui parler. Je devenais écarlate quand je la voyais à l’autre bout de Montaigne, mais aussi quand elle n’était pas là, si quelqu’un m’en parlait. Tous mes copains se foutaient de ma gueule. Le soir, enfermé dans ma salle de bain, je m’entraînais à prononcer son nom sans rougir, je n’en dormais pas de la nuit. Mais à peine arrivé au lycée, ça revenait. Il suffisait que je pense à elle, ou que quelqu’un suppose que je puisse penser à elle, ou que je suppose que quelqu’un puisse songer que j’allais éventuellement penser à elle, et je devenais rouge pivoine. De ma chambre, je la regardais dîner seule avec sa mère dans l’immeuble d’en face. C’était une brune avec une frange et un long nez. Je ne sais pourquoi j’étais aussi épris de cette voisine. Sa mère et elle avaient le même nez : parfois un simple détail suffit à faire éclore un sentiment merveilleux. Elle ne sait rien de cette passion, Clarence Jacquard. Pour moi elle était tout, pour elle je n’étais rien. Je n’ai jamais osé l’aborder de ma vie, j’ignore ce qu’elle est devenue. J’écris ici son vrai nom en me croyant adulte, mais si une quadragénaire vient un jour, dans un Salon du Livre, me gronder de l’avoir citée dans mon dernier livre, je suis à peu près certain que je rougirai encore, même si elle est devenue hypermoche, ce qui serait encore plus embarrassant.
Читать дальше