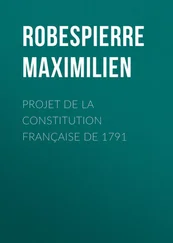La professeur de philosophie, Wanda Bannour, qui avait inspiré ma fiancée demandait aux petites nanas boutonneuses avec leurs premières règles : « Vous n’êtes pas prêtes pour écouter une leçon philosophique de Nietzsche ? Alors vous ressortez de l’école et vous rentrez en dansant. »
Ça ne paraît rien, mais c’est profond cette remarque de professeur : « venir en dansant », qui nous renvoie à une grande citation :
Il y a toujours un peu de folie dans l’amour. Mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie.
Et à moi aussi qui aime ce qui vit, il me semble que les papillons ou les bulles de savon et les êtres humains qui leur ressemblent sont ceux qui en savent le plus du bonheur.
Voir voleter ces âmes légères, un peu folles, fragiles et mobiles — voilà qui donne à Zarathoustra envie de larmes et de chansons.
Je ne croirai qu’en un dieu qui s’entendrait à danser. Et lorsque je vis mon diable, je le trouvai grave, minutieux, profond, solennel ; c’était l’esprit de pesanteur — par lui toutes choses tombent.
On ne tue pas par la colère, mais on tue par le rire. Allons, tuons l’esprit de pesanteur !
J’ai appris à marcher : depuis ce temps je me laisse courir. J’ai appris à voler : depuis je n’attends plus qu’on me pousse pour changer de place.
Maintenant je suis léger, maintenant je vole, maintenant je m’aperçois en dessous de moi-même, maintenant un dieu danse en moi.
Ainsi parlait Zarathoustra. [96] Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, op. cit., « Lire et écrire », p. 56–57.
Pour Nietzsche, il faut danser dans le miracle de l’instant parce qu’il n’y a pas de vie au-delà et le fait de croire qu’il puisse y en avoir une dévitalise la réalité.
L’analyse et Nietzsche dans ma vie, au fond, ça a souvent marché ensemble. Ça peut paraître étonnant, mais les gens qui sont en analyse ne sont pas que des mondains qui habitent le 7 earrondissement et qui s’ennuient dans la vie. L’angoisse qui les étreint n’est pas l’ennui. Celui qui y va n’a souvent pas le choix. C’est un choix désillusionnant. C’est une baffe dans la gueule du narcissisme. Dès que tu vas chez un analyste, tu n’as jamais d’écho à l’endroit qui t’arrange. La psychanalyse est héritière des moralistes du XVII e siècle. Pour elle, tout ce que nous faisons appartient à l’économie générale du moi.
Mon premier psychanalyste était un génie. Il s’appelait Bouvier Robert. J’avais 17 ans, je lui ai raconté mes premiers émois sexuels. J’avais découvert la puissance, le plaisir et j’étais exalté. Je lui dis : « J’ai accédé à la pénétration, c’était chaud et c’était doux. » Et il lance, pour seule réponse : « Ben oui, c’est mieux que dans le sable ! » C’était un homme surréaliste. Je l’avais rencontré grâce à un prêtre de la Trinité, Marc Oraison, un prêtre qui s’occupait des délinquants. Je voulais me faire réformer, il m’avait envoyé chez un psychiatre : un chemin sérieux que peu de gens empruntent. C’est austère, c’est pénible. Bouvier avait une autre formule : « Le moi, c’est comme les assouplissements, plus on avance, plus il s’assouplit. » Les grands névrosés, après cinquante ans, leur moi s’est fixé, comme le cholestérol. On voit des gens dans leurs obsessions : il n’y a pas d’assouplissements. Névrosés, en monologue avec eux-mêmes. En tout cas, la psychanalyse a donné une place à l’autre et libéré l’autre de la manière dont j’aurais pu névrotiquement le réduire. Mais, du coup, maintenant je ne vois plus personne… Souvent, je disais à Bouvier :
— C’est pas chiant, votre boulot ?
Il me répondait :
— Mais c’est assez chiant parce qu’ici c’est un peu le mur des lamentations. Tu sais, nous, pour se nettoyer, on va voir d’autres psys. C’est comme les bateaux quand il y a trop de coquillages : on les lave.
La terrible lucidité, celle de Céline comme celle de Nietzsche, est invivable. Elle vous empoisonne. Le fait de travailler la structure du XVII e siècle, d’entrer dans le mystère de la poésie vous guérit. La poésie vous donne ses vertiges, ses silences. Elle ne s’inscrit plus dans notre temps. Ses suggestions, ses silences, ses vertiges ne peuvent plus être audibles aujourd’hui. Il ne faut pas, pourtant, évoquer la poésie comme un militant qui déclamerait, l’air tragique : « Attention, poète ! » Il faut, avec Paul Valéry, se désoler de l’incroyable négligence avec laquelle on enseignait la substance sonore de la littérature et de la poésie. Valéry était sidéré que l’on exige aux examens des connaissances livresques sans jamais avoir la moindre idée du rythme, des allitérations, des assonances d’un texte. Cette substance sonore qui est l’âme est le matériau musical de la poésie.
La poésie, c’est le contraire de ce qu’on appelle le « poète », celui qui forme les clubs des poètes. Stendhal disait que le drame, avec les poètes, c’est que tous les chevaux s’appellent des « destriers ». Mais La Fontaine, Racine, Rimbaud, Baudelaire, Hugo, oui, ils ont littéralement changé ma vie. J’ai rencontré, un jour, le théâtre et la poésie comme Claudel a vu la lumière une nuit de Noël.
On dit, pour la moquer, que la poésie est ridicule, inutile ou hermétique… Elle a ces trois vertus. Ridicule, c’est évident. Il suffit de prononcer d’un air inspiré : « Poète, prends ton luth et me donne un baiser … » Musset est quatorze fois exécrable, disait Rimbaud, et tout apprenti épicier peut écrire un « Rolla ». Inutile, elle l’est aussi. Hermétique, c’est certain. J’aimerais réunir les gens capables de m’expliquer « Le Bateau ivre ». Arthur Rimbaud a dit : « Que comprendre à ma parole ? / Il faut qu’elle fuie et vole ! »
La poésie, c’est une rumination. C’est une exigence dix fois plus difficile qu’un texte de théâtre. La poésie demande une vulnérabilité, une capacité d’être fécondé. Elle m’accompagne : avec elle, j’essaye d’avancer dans le mystère du verbe et de la création, et je fais honnêtement commerce de ce qui me hante.
Avant « C dans l’air », je repense au « Sermon sur la mort » [97] Bossuet, « La Mort », Sermons, Folio, Gallimard, 2001.
de Bossuet cité dans le livre de Suzanne Julliard [98] Suzanne Julliard, Anthologie de la prose française, De Fallois, 2015.
: « Que nous servira d’avoir tant écrit dans ce livre, d’en avoir rempli toutes les pages de beaux caractères, puisqu’enfin une seule rature doit tout effacer ? Encore une rature laisserait-elle quelques traces du moins d’elle-même, au lieu que ce dernier moment qui effacera d’un seul trait toute votre vie s’ira perdre lui-même avec tout le reste dans ce gouffre du néant. Il n’y aura plus sur la terre aucun vestige de ce que nous sommes. La chair changera de nature, le corps prendra un autre nom, même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps. Il deviendra, dit Tertullien, un je ne sais quoi qui n’a plus de nom dans aucune langue. Tant qu’il est certain que tout meurt en lui, jusqu’à ces termes funèbres par lesquels on exprimait ses malheureux restes ! »
Je répète, en allant au tournage, les répliques de la scène d’aujourd’hui.
21 heures, dans l’avion d’easyjet
Retour du Festival de Venise où j’ai présenté L’Hermine , de Christian Vincent.
Читать дальше
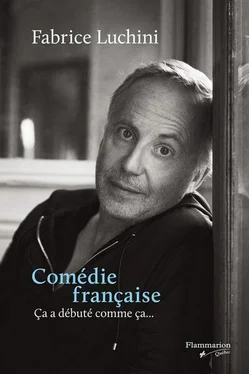
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)