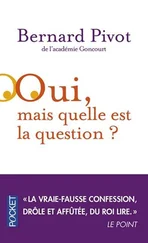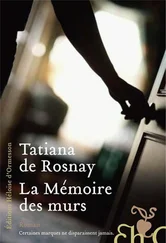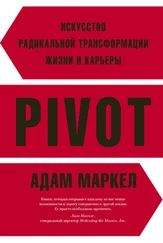Ma voiture était arrêtée à cinquante mètres de la gare Montparnasse. Dans un quart d’heure, D. irait prendre son train. C’était maintenant ou jamais. Il me semblait que l’envie de l’embrasser me gonflait les lèvres. De ma bouche sortaient des mots qui se bousculaient ; de la sienne ils s’échappaient avec plus de maîtrise. Un baiser nous réduirait enfin au silence. L’éloquence muette des baisers. Mais c’était trop tôt. Ou trop tard puisque nous ne nous reverrions peut-être pas. Ou trop risqué, ce baiser décoché à la dernière minute comme une flèche perdue, justifiant la fin de l’histoire. Ou trop désinvolte. Ou trop romantique. Ou trop cynique. Ou trop malin. Ou trop banal. La seule réaction de sa bouche à l’audace de la mienne — qu’hélas je n’envisageais pas, alors que c’était à l’évidence la plus probable, tant son visage à côté du mien à l’avant de la voiture montrait de signes de connivence — était une réaction de stimulante participation. Comment expliquer ce défaitisme ? Cette lâcheté ? Une envie impérieuse, comme paralysée par sa propre force, peut provoquer l’inaction, c’est ainsi.
Même si nous eûmes par la suite la chance de nous revancher d’abondance de la carence dont je m’étais rendu coupable, je continue de regretter ce baiser devant la gare Montparnasse resté stupidement sur mes lèvres. Comme je déplore ceux que je n’ai pas osé prendre aux jeunes filles de mon âge. Leur prudence n’avait d’égale que ma pusillanimité. À cette époque préhistorique de la sexualité, elles tenaient pour certain qu’ouvrir la bouche à la langue d’un garçon, c’était dès ce moment courir le risque de se retrouver enceintes. Les refus n’étaient pas tous de coquetterie ou d’indifférence.
Les baisers échangés n’en étaient que plus appréciés. Pour les générations suivantes, ils deviendront banals. Ils ne seront souvent que des façons un peu appuyées de faire connaissance. Les préliminaires conventionnels du passage aux choses sérieuses et urgentes du lit. Des baisers comme des papillons alors que dans ma jeunesse ils étaient les fleurs.
Encore fallait-il ne pas rater le premier baiser, si important, qui deviendrait ou non mémorable. À cet égard, les garçons et les filles nés et grandis dans les vignes ont l’avantage d’avoir appris dans les dégustations à utiliser savamment leur bouche. Ils savent faire rouler le vin sur la langue, en imprégner leurs papilles. Avec de plus en plus de maîtrise les lèvres s’ouvrent à l’envie et se ferment sur le plaisir. La cave est la salle de gymnastique des muscles labiaux. C’est pourquoi les premiers baisers des jeunes gens des régions viticoles sont plus réussis que les premiers baisers des jeunes gens nés et grandis dans les régions céréalières ou d’élevage. Quant à ceux des villes, les pauvres…
Michel Tournier, Le Vent Paraclet : « J’ai été aussi bon étudiant que mauvais lycéen. » Moi de même. Mais sans faire le clown comme Tournier, ce qui lui valut d’être souvent renvoyé des établissements scolaires. Il faut du courage ou de l’inconscience pour moquer les profs en les imitant. Il faut surtout supporter très mal « l’oppression de la société policée des adultes » pour prendre le risque de les provoquer par la dérision. Je n’étais ni heureux ni malheureux, ni aplati ni révolté. J’ai été un collégien fade, puis un lycéen quelconque. Avec des notes dans la moyenne ? Non, un peu en dessous. Dans le ventre mou de la classe, de la sixième à la terminale.
Je ne jouissais d’aucune considération, encore moins du prestige des premiers et des cancres. Les premiers étaient pour moi inaccessibles (sauf en orthographe, ce qui était déjà anecdotique). Les cancres m’attiraient et me faisaient peur. Leur refus du moindre effort ou leur inaptitude à se remplir la tête de chiffres et de mots les auréolait de noir. La plupart étaient costauds, insolents, et leur marginalité revendiquée plaisait aux filles. Ils étaient de toute façon plus rigolos que les fortiches en maths.
Michel Tournier traite ses professeurs de « pantins ». Il a gardé le souvenir de leur laideur et des ridicules de leur comportement. « Peut-être ce métier d’enseignant a-t-il plus qu’un autre pour effet d’abîmer les gens qui l’exercent. (…) Il est possible que l’autorité d’un maître sur un groupe d’enfants amoche à la longue son personnage et sa personnalité. » Les enseignants ne lui ont pas tenu rigueur de ses commentaires désobligeants à leur égard, l’invitant très souvent à répondre aux questions de leurs élèves. Lui aimait beaucoup ça.
Il disait que le meilleur lecteur est un enfant de douze ans. On peut en douter. Excessif dans ses jugements sur les professeurs et sur les élèves, à l’évidence Michel Tournier préférait les enfants aux adultes.
Le souvenir que j’ai gardé de mes profs ne me permet pas d’instruire contre eux un procès en laideur ou en ridicule. Que des hommes ! Plutôt sympathiques — à l’exception d’un arrogant professeur d’anglais dont je souhaitais la mort. Ils ressemblaient à des parents d’élèves et les parents d’élèves ressemblaient à des professeurs. Tout ce joli monde, possesseur de l’autorité et du savoir, était somme toute bien ennuyeux. Si la rêverie, les vagabondages de l’esprit, les fantasmes les yeux ouverts avaient constitué une épreuve du baccalauréat, il est certain que j’aurais décroché un 20 sur 20. Alors que j’ai dû m’y prendre à deux fois pour en passer avec succès la première partie.
Non, mes professeurs ne sont pas responsables de mon médiocre parcours scolaire. Mes mauvais génies avaient pour noms football, ping-pong, flipper, baby-foot, plus un invincible tropisme au métier de songe-creux.
Et puis, ô miracle, étudiant en journalisme à Paris, me voici parmi les meilleurs, premier surpris de capacités insoupçonnées, de mon plaisir féroce à apprendre. Je ne rêve plus le jour ni même la nuit parce que ma tête, jamais aussi souvent sollicitée et autant remplie, est fatiguée. Je découvre le bonheur des intuitions gagnantes, des observations judicieuses et des raisonnements qui emportent l’adhésion. Le choix des mots est un sport que je pratique de plus en plus en professionnel. J’éprouve enfin les délicieux tourments de l’écriture.
Comment expliquer que le médiocre lycéen soit devenu un étudiant doué ?
L’attractivité des matières enseignées n’y était pas pour rien, bien sûr. Non plus qu’une maturité qui avait traîné en route. Une clairvoyance tardive m’indiquait que j’avais trouvé mon chemin. Il passait par Paris, à 450 kilomètres de Lyon, loin du cocon familial, des copains, des matchs de football, des bals — on ne parlait pas encore des « sorties en boîte » —, des habitudes, des tentations, d’une indolence irréfléchie et bien commode.
« Il n’y a de bon étudiant que celui qui peut, qui sait, qui aime travailler seul . » Michel Tournier souligne le mot seul. Pour la première fois de ma vie j’étais, en effet, seul. Et heureux de l’être, sans en avoir eu le désir mais en en découvrant les avantages. J’étais maître de mon temps et, en dehors des cours au Centre de formation des journalistes (CFJ), maître de mon agenda. La solitude fournit beaucoup plus de lunettes pour comprendre le monde que le blablabla avec le perpétuel cercle des familiers. Dans ma petite chambre d’étudiant, il me semblait que j’avais enfin pignon sur rue.
Désormais, la compétition entre étudiants ne me faisait pas peur. Ce que j’avais appris des matchs de football et des parties de tennis de table — la volonté, l’opiniâtreté, la hardiesse, le goût de la victoire — m’était resté intact, disponible. La moitié de la classe ne passerait pas en seconde année. Je serais de la bonne moitié. Les doutes et les pusillanimités du lycéen avaient disparu.
Читать дальше