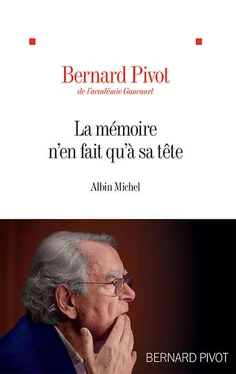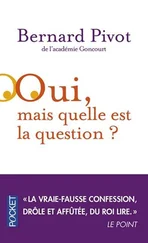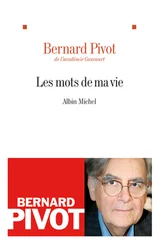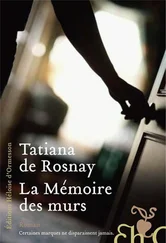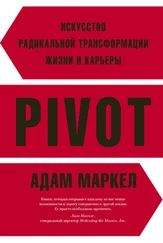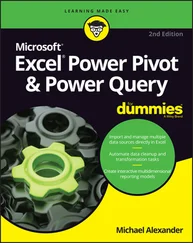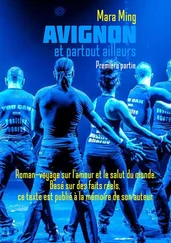Il s’était passé du temps avant que l’annonce de cette découverte parvînt aux autorités du département de l’Isère. Aussi les archéologues amateurs de Saint-Paul-de-Varces avaient-ils eu tout loisir de faire leurs emplettes dans la caverne miraculeuse. Tous les dimanches, armés de pioches, ils sondaient la montagne. C’était la ruée vers l’os. L’un des plus habiles chercheurs était le patron de l’épicerie-café-restaurant-hôtel-jeu de boules du col de l’Arc qui montrait avec fierté à ses clients un cageot plein d’ossements. On le blaguait. On lui demandait s’il avait l’intention de préparer un bouillon d’os. Il laissait dire, convaincu d’être le dépositaire de la science et le magasinier de la préhistoire.
Sur l’explication scientifique de la découverte, le village se divisa. Certains, bientôt confortés par les experts, affirmaient qu’il s’agissait d’une nécropole datant de l’âge du bronze ; d’autres, historiens du terroir, colporteurs des événements et faits divers de la région, tenaient pour certain que tous ces hommes, femmes et animaux avaient été ensevelis sous une avalanche. N’avait-on pas retrouvé les quatre premiers corps debout, dans la position verticale et glorieuse de l’éclaireur ou de la sentinelle ? Et pourquoi ne serait-ce pas cette noce engloutie par la montagne dont on se transmettait le récit de génération en génération ? Oui, pourquoi pas, mais depuis quand ? Nul ne le savait.
La fièvre de l’archéologie est retombée aussi vite qu’elle était montée. Quelques habitants de Saint-Paul-de-Varces ne regardaient cependant plus la montagne comme avant. Elle leur paraissait à la fois plus humaine et plus mystérieuse, habitée en quelque sorte. L’un d’eux m’a dit, fixant les hautes murailles du Vercors : « Des crânes, des bracelets, des vases, là-dedans il y en a encore plein ! Il faudrait creuser… » Dans ses yeux passa un instant le projet de raser le Vercors.
Duras n’aimait pas Colette
Ce n’est pas parce que leurs écritures étaient aux antipodes l’une de l’autre que Marguerite Duras n’aimait pas Colette. Les écrivains fondent souvent leur estime, voire leur amitié, sur des différences plus que sur des ressemblances qui peuvent agacer. Duras détestait Colette. Je l’appris durant notre unique conversation téléphonique qui précéda notre Apostrophes , en direct, le 29 septembre 1984.
Encore réticente à l’idée de paraître à la télévision qu’à l’époque elle abominait, mais flattée par ma proposition de tête-à-tête, elle me demanda avec qui je m’étais déjà risqué dans cet exercice.
« Jouhandeau, Nabokov, Simenon, Albert Cohen…
— Des femmes ?
— Marguerite Yourcenar, la seule… »
Silence.
« Mettons que vous invitiez des femmes d’autrefois, des écrivains, bien sûr…
— Louise Labé… Germaine de Staël… Colette… »
Silence.
« Ah, Colette ! Vraiment ? »
Le ton était ironique. J’avais commis une gaffe. On m’avait dit que Duras était très soupe au lait. Qu’un rien pouvait la fâcher. Ce n’était pas rien, Colette. Pour Duras, si.
« Colette, je vous l’abandonne », me dit-elle, me tirant de mon embarras.
Trente ans après, dans Le Livre dit (2014), entretiens enregistrés, en 1981, à Trouville pendant le tournage d’ Agatha , Marguerite Duras parle du féminisme des hommes. Tout à coup, elle s’en prend à Colette : « Les hommes sont féminins comme on l’était en 1910 ; tandis que nous sommes féminines en 1981 ; ce n’est pas du tout pareil. Ils sont féminins comme Colette. Qu’est-ce que tu as à en foutre et moi aussi de Colette ? On n’a rien à en faire, du tout. C’est-à-dire, c’est eux qui la remettent à la mode. »
Une note de l’éditrice du livre, Joëlle Pagès-Pindon, révèle pourquoi Duras, qui n’appréciait ni les romans ni les articles ni le féminisme de Colette, lui manifestait autant d’hostilité. En 1964, critique littéraire au Monde , Jacqueline Piatier avait fait un parallèle entre ces deux championnes de la littérature : « Comme Duras est loin de Colette, de sa santé, de son équilibre, de sa lucidité, de son goût de la vie, des êtres, de la nature ! » On imagine combien cette comparaison avait encoléré Duras. Elle n’a pas pardonné à la journaliste « et son dédain pour l’œuvre de Colette s’en est trouvé fortifié ».
Paul Léautaud : « Elle avait un corsage un peu ouvert. Comme elle se penchait vers moi pour me parler, je voyais ses seins. Je lui ai dit : “Tu pourrais bien ne pas montrer tes seins comme cela. — Vraiment ? On les voit ?” », Journal particulier 1935 .
Marié, je me suis sérieusement posé cette question : ne devrais-je pas renoncer à regarder dans les décolletés entrouverts ou béants ? Le temps n’était-il pas venu de détourner les yeux des seins qu’avec une louable générosité les femmes offrent à leur vis-à-vis, surtout quand les aléas de l’existence ou les contraintes du moment les obligent à se pencher ? Allais-je enfin devenir sérieux ?
Parce que, avant, surtout pendant l’adolescence — j’appartiens à la dernière génération de la farouche décence, de la clôture, du secret —, j’étais dans un safari permanent. Toutes les occasions de zyeuter étaient à saisir. Je n’hésitais pas à faire un pas de côté pour être mieux placé, bien dans l’axe de l’adorable buste incliné. Je ne lâchais pas du regard des poitrines cachées, mais dont je pressentais en expert des étoffes qu’une inclinaison soudaine, à ne pas rater, révélerait l’amorce des rondeurs.
Oh, mon Dieu, les seins opulents des vendangeuses courbées au-dessus des ceps ! Les décolletés des vendeuses de chaussures accroupies à mes pieds (« Dans ce modèle-là, j’aimerais essayer la demi-pointure en dessous et, pendant que j’y suis, pourquoi ne pas essayer d’autres couleurs ? »). Les petits seins des jeunes filles entr’aperçus dans leurs légères robes d’été.
Comme je détestais les femmes hypocrites et bégueules qui, avant de se pencher, mettaient une main sur l’ouverture de leur corsage ou de leur robe !
Marie Dormoy, maîtresse de Léautaud, s’étonne qu’on voie ses seins quand elle se penche. Coquetterie et rouerie probablement. Comment croire que les femmes ignorent qu’elles en montrent davantage quand elles plient le buste ? Preuve en est que certaines se prémunissent d’un geste de censure. Il est difficile d’imaginer que les autres sont des étourdies ou des innocentes. Soit elles assument avec élégance ces accrocs à leur pudeur, soit elles misent sur leur décolleté et ses profondeurs d’aubaine pour accroître leur séduction.
Si elles étaient rares dans ma jeunesse, les femmes sont nombreuses aujourd’hui, il est vrai, qui se fichent du regard des hommes et des femmes. L’essentiel est qu’elles se sentent bien, à l’aise, libres, belles, dans leurs vêtements, ouverts ou fermés.
Un jour qu’avec un peu trop d’insistance j’avais contemplé les seins ravissants d’une femme occupée à enlever ses chaussures et à les remettre, elle se redressa en me disant : « Il ne faut pas vous gêner ! »
Un instant décontenancé, je me suis vite repris :
« Je n’ai fait qu’admirer.
— C’est très gênant pour moi.
— Quand la beauté s’affiche, je la regarde, dis-je avec l’espoir que le compliment la calmerait.
— Je ne suis pas une affiche, je suis une femme, avec sa pudeur, me répondit-elle, toujours courroucée.
— Pudeur, pudeur… Vous avez un généreux décolleté et quand vous vous penchez, il est encore plus généreux !
Читать дальше