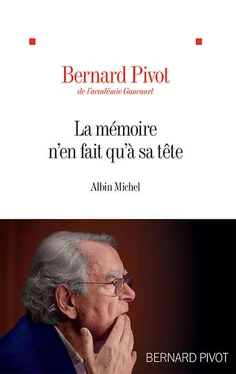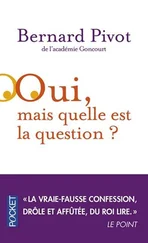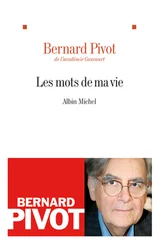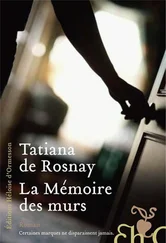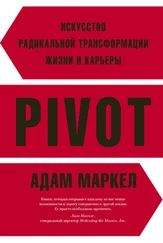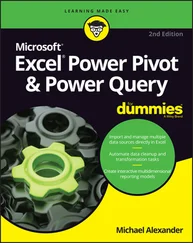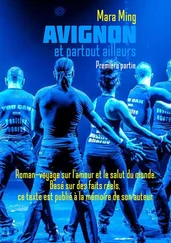Au contraire, les femmes, le plus souvent, protestent contre une réputation sulfureuse. Les hommes conquièrent, les femmes cèdent. Ce fut vrai autrefois, ça l’est beaucoup moins aujourd’hui. Mais il reste de ces époques à la Fragonard un sentiment de faute, de culpabilité, qui empêche les femmes de revendiquer avec simplicité, sérénité, fierté, aplomb (rayer les mentions inutiles) leurs bonnes fortunes. Elles minimisent, elles s’offusquent, elles disent ne pas se souvenir. Mon œil !
Car l’homme voudrait bien savoir. Combien avant lui ? Des liaisons ou des toquades ? Senso ou La Ronde ? Amour, quand tu nous tiens, ou passez muscade ?
Des artistes en chambre ou de maladroits peintres sur le motif ? lui répond-elle sans manifester de trouble, avec même une souriante désinvolture.
Lui-même, à ses questions, n’a-t-il pas embelli ou banalisé son passé amoureux, adaptant son récit à, suppose-t-il, ce qu’elle veut entendre ? Leurs conversations vont des craques aux tendres carabistouilles. Avec leur mémoire sexuelle, ils jouent tous les deux au poker menteur, lui, en plus, s’il est fanfaron, aux dames. L’important, c’est qu’ils gagnent tous les deux.
Est-il vrai qu’avant de mourir certains hommes font défiler dans leur tête les visages des femmes avec lesquelles ils ont eu une jolie aventure ? Et que certaines femmes revoient les hommes avec qui elles ont partagé leur lit ? Dans ce cas, la vieille catin de Voltaire a dû s’y prendre assez longtemps avant de rendre son âme.
Dans la lettre de Voltaire, ce qui avait d’abord arrêté ma lecture, c’étaient les faux en écriture. On ne prête qu’aux riches. Le patriarche de Ferney continuait de faire recette. Mais sa comparaison avec une vieille catin est surprenante. À l’époque, le mot désignait une prostituée. Lui attribuait-on pendant sa jeunesse autant d’amants qu’on attribuait d’écrits à Voltaire ? Ces mystères qui entourent la vie intime des hommes et des femmes m’ont interpellé. J’ai là-dessus quelques souvenirs. C’est ainsi qu’à une réflexion sur les textes apocryphes s’en est substituée une autre sur la mémoire amoureuse. Les ricochets suivent parfois des trajectoires inattendues.
Né à Lyon, supporteur des Verts
Si vous avez une ascendance stéphanoise et une descendance lyonnaise, ou inversement, occupez-vous de pharmacie, d’architecture ou de papeterie, mais surtout pas de football. La rivalité entre l’Association sportive de Saint-Étienne et l’Olympique lyonnais est exécrable. Deux derbys par an tendent les nerfs des supporteurs et déchaînent les cris d’admiration des uns et de détestation des autres. Chaque match entre les deux clubs est une revanche sur le précédent et, par une victoire éclatante, une tentative de liquidation de ce que le palmarès compte de passif pour chacun.
Dans les familles stéphano-lyonnaises, il est des dimanches où les deux accents se chevauchent dans des joutes de prétoire ou des querelles de boutiquiers.
Ce doit être bien pire quand le chef de famille est le leader de la rubrique football à L’Équipe . L’ascendance de Vincent Duluc est stéphanoise et sa descendance lyonnaise. Gamin, il a suivi avec passion ce qu’on a appelé « l’épopée des Verts » — terminée par une finale de Coupe d’Europe des clubs champions, perdue à Glasgow contre le Bayern Munich — et, depuis trente ans, c’est lui qui raconte les hauts — sept années de suite champion de France — et les bas de l’Olympique lyonnais…
« … La rivalité entre Saint-Étienne et Lyon, qu’il s’agisse de football ou d’autres domaines de la vraie vie, dessine quelque chose d’une frontière qui ne serait franchie que par les traîtres. Ceux qui ont une double vie changent de peau entre Givors et Rive-de-Gier, sur la route enchâssée au pied des monts du Lyonnais », Vincent Duluc, Un printemps 76 .
Né à Lyon, supporteur des Verts, j’ai tout l’air du traître de service, alors que la fidélité ne me fait pas changer de veste ni de trottoir quand je franchis la frontière qui sépare et oppose le Rhône et la Loire. L’explication est évidemment familiale. Ma mère, lyonnaise, se fichait bien du sport. Ce n’est pas elle qui m’emmenait assister à Gerland et au stade des Iris à des matchs de football et de rugby à XIII, mais mon père, né à Saint-Symphorien-de-Lay, dans la Loire, donc entiché du football stéphanois.
Quand, trop rarement à son goût et au mien, je recueillais au collège et au lycée des notes flatteuses, nous partions, le dimanche après-midi, au stade Geoffroy-Guichard dans la camionnette de l’épicerie. Les noms de Cuissard, Alpsteg, Rijvers, Abbes, puis N’Jo Léa, Mekloufi me sont vite devenus plus familiers que ceux de Pascal, Diderot ou Pasteur. J’ai grandi avec cette certitude qu’un match de l’ASSE est une exception et une récompense.
À Lyon, le menu était beaucoup moins alléchant. Le LOU (Lyon olympique universitaire), ancêtre de l’OL, jouait en seconde division. Nous allions voir des LOU-Alès, des LOU-Le Mans… Pas folichon. Et, pourtant, nous aussi, nous encouragions bruyamment les gones et nous nous réjouissions de leurs victoires. S’ils perdaient, notre chagrin était cependant moins vif que pour une défaite de Saint-Étienne à l’étage au-dessus. La hiérarchie des chagrins et des joies épousait la hiérarchie des clubs.
Il me semblait que Lyon, ville bourgeoise, ne pourrait jamais avoir une équipe de football aussi populaire, aussi talentueuse que celle de Saint-Étienne, ville ouvrière. Dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard, stade à l’anglaise entouré de cheminées qui crachaient la fumée d’une briqueterie, le public, à défaut du ballon, poussait les joueurs par ses chants, ses cris, ses applaudissements, sa ferveur. Au stade des Iris, puis à Gerland, stade bientôt inscrit aux Monuments historiques, même quand les Lyonnais jouaient en première division, l’adhésion du public à son équipe était moins bruyante et chaleureuse. Cependant, la conquête de trois Coupes de France m’impressionna et me réjouit. L’OL flambait avec des joueurs exceptionnels : Di Nallo, Rambert, Combin, puis Serge Chiesa et Bernard Lacombe. Mais, feu de paille, le club retomba dans la division inférieure.
Pendant ce temps, l’ASSE devenait le club français le plus aimé en France et le plus connu d’Europe, remportant championnats et coupes, et parvenant en 1976 en finale de la Coupe d’Europe. Le monde du foot était devenu vert. De Dunkerque à Nice, de Strasbourg à Biarritz, des jeunes gens chantaient : « Qui c’est les plus forts évidemment c’est les Verts. » À Saint-Chamond également. Saint-Chamond, petite ville proche de Saint-Étienne, a connu son heure de gloire grâce à Antoine Pinay, père du nouveau franc. Il en a été le maire et le vieux sage. Les hommes politiques venaient en pèlerinage le consulter. Il est mort à près de cent trois ans. Je ne l’ai jamais vu à Geoffroy-Guichard. Mais moi, on m’y voyait souvent, notamment les mercredis de matchs européens, étant chaque fois invité par mon camarade de collège, Gérard Faye, vétérinaire à Saint-Chamond. Nous nous retrouvions à quatre ou cinq couples, les épouses, surtout la mienne, n’étant pas moins expertes et passionnées que les hommes.
La télévision ouvrant bien des portes, celle du vestiaire des joueurs stéphanois s’ouvrit pour moi dès la fin des matchs. J’y retrouvais Roger Rocher le président du club, Robert Herbin l’entraîneur, Pierre Garonnaire le recruteur. Dans l’euphorie des victoires acquises contre tous les pronostics, sur le fil, le roi n’était pas mon cousin. Dans une société où les superstitions sont cultivées avec vigilance, je passais pour porter bonheur à l’équipe.
Читать дальше