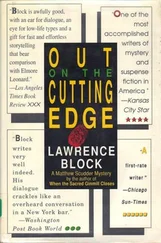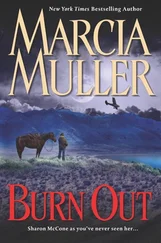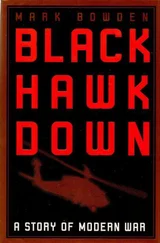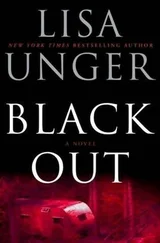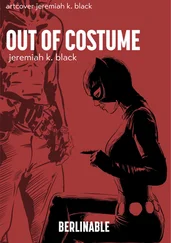Il reprit son souffle et continua sans presque marquer d’arrêt : « L’évolution des marchés de valeurs et de matières premières n’est pas prévisible. Peut-être, après la fin du black-out, y aura-t-il des réactions positives. D’autre part, les marchés n’ont pu réagir à la dégradation de la situation des semaines passées. Les putschs militaires au Portugal, en Espagne et en Grèce, par exemple, ne resteront pas sans conséquences. Le prix des obligations, y compris des obligations allemandes, est loin au-dessous de celui des grecques, des irlandaises, des italiennes ou des espagnoles à la pire période de la crise financière. De facto , il nous est impossible de nous financer pour l’instant grâce au marché financier. Ça signifie que l’Allemagne ne pourra plus, d’ici quelques mois seulement, honorer ses crédits ni payer ses fonctionnaires et ses retraités. De nombreux États européens ont été confrontés à ce problème par le passé. Les marchés financiers internationaux se trouveront alors au bord de l’effondrement, en comparaison duquel toute la crise économique que nous avons traversée ne sera rien. Il appartient maintenant aux politiques d’éviter le pire. Les scénarios possibles — il regarda sa montre — doivent être présentés et discutés dans quatre heures lors d’une visioconférence avec les chefs de gouvernement des États du G20, des représentants de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale et du Fonds monétaire international. »
Paris
Le trajet en train entre Orléans et Paris dura une éternité.
Ils atteignirent la capitale dans l’après-midi. Entourés de plusieurs dizaines d’autres voyageurs, les Bollard attendaient à la station de taxis, tandis que Doreuil retournait dans le hall de la gare afin de trouver quelqu’un susceptible de leur venir en aide. Même les guichets étaient ouverts. Mais tant de gens s’y pressaient qu’elle renonça et rejoignit les autres. Lorsqu’une voiture apparut, une bousculade éclata. Deux autres véhicules arrivèrent. Ils s’arrêtèrent alors qu’ils n’avaient pas de lumineux, l’un d’entre eux directement devant Vincent Bollard. Le chauffeur abaissa la vitre et leur demanda leur destination.
Annette lui donna l’adresse.
« Cent cinquante euros, demanda l’homme.
— C’est… », voulut-elle dire, avant de se raviser. En temps normal, le tarif habituel pour cette course était d’une trentaine d’euros.
« Entendu, lâcha-t-elle d’un ton sec.
— Montez.
— La moitié d’abord, fit l’homme en tendant la main.
— Vous venez d’où ? demanda l’homme avec curiosité tout en mettant les gaz.
— Orléans », répondit abruptement Doreuil. Elle n’avait nulle envie de s’entretenir avec ce voleur.
« Ah ! Bon Dieu, s’exclama-t-il. Je croyais que c’était une zone interdite. Ils l’ont dit aux infos. »
Les rues étaient encore plus sales qu’à Orléans ; il y avait même des cadavres d’animaux à la panse gonflée. Ici aussi roulaient essentiellement des véhicules d’urgence et des blindés. La voiture filait tout de même à 60 km/h. Il rit. « Chez nous, à Paris, c’est pas beaucoup mieux. »
Doreuil le haïssait en raison de ses allusions, mais elle demanda pourtant : « Pourquoi ?
— Parce qu’il y aurait un nuage qui serait venu d’en bas, de la centrale. C’est pas grave, qu’ont dit les officiels. Il haussa les épaules. La pluie d’après a tout rincé. Plus de risque. C’est ce qu’ils disaient, en tout cas. (Il fit un grand mouvement de la main, comme pour se débarrasser de quelque chose.) Pff, toute façon, je préfère les croire. Sinon, je pourrais pas vivre tranquille. »
Elle ne répondit rien. Elle se passa la main dans les cheveux, une sorte de tic, et l’examina à la dérobée.
« Et vous avez besoin de quelque chose, sinon ? demanda l’homme avec insouciance. À manger ? À boire ? Je peux vous trouver quelque chose. Pas évident en ce moment de dénicher quoi que ce soit.
— Non merci », répondit Doreuil, rigide.
Arrivés devant chez elle, elle lui paya la seconde moitié et releva le numéro de la plaque.
Après avoir ouvert la porte de l’appartement, elle soupira. « Enfin ! »
À l’intérieur, l’air était quelque peu rance, mais les pires effluves étaient restés dehors. Elle posa sa valise et alla vers le téléphone. Pas de tonalité. Elle se rendit alors à l’ordinateur, dans le bureau de Bertrand. Les Bollard la suivirent. Depuis que leurs enfants avaient déménagé à La Haye, elle s’était habituée à l’utilisation des moyens de communication modernes. Elle alluma le PC, lança Skype et cliqua sur le nom de sa fille. Quelques secondes plus tard apparut à l’écran le visage légèrement pixelisé de Marie. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle entendit Marie appeler les enfants. « Louise, Paul, venez ! C’est papy et mamy qui téléphonent. » Sa fille se tourna vers la caméra de son ordinateur. « Mon Dieu ! Qu’est-ce que je suis contente de te voir ! Vous allez bien ? »
Istanbul
« François ? François ? T’es encore là ? »
Il entendait la voix de sa femme, via les haut-parleurs de son ordinateur, comme si elle était étouffée. Il regardait l’écran, le visage mince et blême de son épouse s’estompait. Il ravala ses larmes.
« Il… sa voix fit défaut à Marie. Il doit être exhumé. Pour être enterré à Paris. »
C’est la deuxième fois qu’elle le disait. Ça l’accablait presque autant que l’annonce du décès lui-même.
« Je… je suis désolé, fit Bollard, la voix voilée. Je dois raccrocher maintenant. Faites attention à vous. Nous nous voyons rapidement. Je vous aime. »
Quelques secondes, il resta assis sans bouger. Il pensait à ses enfants, à Marie. Il devait rentrer chez lui. C’est lui qui avait envoyé ses beaux-parents là-bas. Où il pensait qu’ils seraient en sécurité. Dans les collines idylliques des bords de Loire. Un instant il se revit, petit garçon, en train de chasser un papillon dans un champ devant le château de Chambord. Il ne pourrait jamais plus retourner sur les lieux de son enfance. Pas plus que Louise et Paul, qui aimaient tant y gambader.
Il se leva d’un coup, fila vers les cellules d’interrogatoire, entra en trombe dans la première. Deux fonctionnaires américains cuisinaient un terroriste grec. Sa chemise était trempée de sueur, sous les bras et au col. Ses lèvres tremblaient.
Sans même prêter attention aux Américains, le Français attrapa l’homme par le col et l’arracha à sa chaise.
« Mon beau-père est mort il y a quelques jours à côté de Saint-Laurent. Infarctus. Personne n’a pu appeler les secours. Saint-Laurent, vous savez ce qui s’est passé ? » murmura Bollard d’une voix rauque.
Le Grec le regardait les yeux exorbités, sans oser le moindre mouvement. Bien entendu, il savait.
« Mes parents, poursuivit Bollard en haletant, ont dû quitter la maison dans laquelle ma famille vivait depuis des générations. J’y ai grandi, moi. Mes enfants aimaient cet endroit. Et maintenant, on ne pourra plus jamais y retourner. »
Il appuya les jointures de ses doigts contre la pomme d’Adam de l’homme dont il ressentait toute la peur.
« Tu connais ce sentiment, poursuivit Bollard, ce sentiment, lorsqu’on sait qu’on doit mourir, dans bien des supplices, et que personne ne viendra vous aider, hein ? »
Il sentit que le Grec menaçait de s’effondrer, il affermit son étreinte. Les yeux du terroriste se mirent à briller, à s’emplir de larmes. Il réalisa à son regard qu’il avait compris à quel point il était sérieux.
« Ces codes de blocage, demanda Bollard, d’une voix plus sourde encore, plus rauque, qui doivent être envoyés toutes les quarante-huit heures. C’est pour quoi ? Qu’est-ce qu’on peut empêcher avec ça ? Combien de temps il nous reste, hein ? Parle, putain de connard ! »
Читать дальше