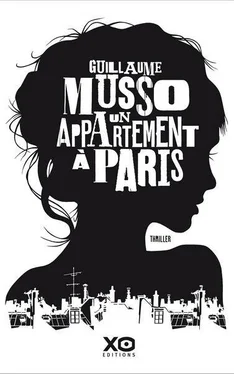Il cligna des yeux et sa vision se dissipa. Avant de se faire des films, il lui fallait des preuves. Il reprit sa réflexion sous un autre angle. Sean était un civil, pas un flic. Pour procéder à l’analyse du tapis, il avait dû solliciter un laboratoire privé. Gaspard plongea la tête entre ses mains, essayant de reconnecter tous les fils de son enquête. Sean était passé chez les Langlois le 22 décembre, la veille de sa mort. S’il s’était rendu dans un labo, c’était probablement le lendemain. Une image électrisa Gaspard : la vision de l’agenda de Sean avec, en date du 23 décembre, le rendez-vous avec le mystérieux docteur Stockhausen.
Il sortit son portable, sollicita Google, son nouveau meilleur ami, en entrant plusieurs combinaisons de mots-clés : « Manhattan », « laboratoire », « ADN », « Stockhausen »… En quelques secondes, il trouva ce qu’il cherchait : l’adresse dans l’Upper East Side du laboratoire d’hématologie médico-légale « Pelletier & Stockhausen ».
Il se rendit sur le site Web de l’établissement. D’après la présentation en ligne, le laboratoire était spécialisé dans les « analyses génétiques destinées à l’identification humaine ». Bénéficiant de quantité d’accréditations (FBI, tribunaux, département américain de la Justice), la structure était régulièrement sollicitée dans le cadre de procédures pénales et judiciaires pour identifier et analyser les traces biologiques d’une scène de crime. Les particuliers, eux, y avaient surtout recours pour des recherches de filiation. Une rubrique du site permettait de lire le CV des deux fondateurs : Éliane Pelletier, ancienne pharmacienne en chef de l’hôpital Saint-Luc de Montréal, et Dwight Stockhausen, docteur en biologie, diplômé de l’université Johns-Hopkins.
Gaspard appela le laboratoire et parvint jusqu’au secrétariat de Stockhausen. Même bobard-qui-n’en-était-pas-vraiment-un : il était un écrivain qui dans le cadre d’une biographie du peintre Sean Lorenz aurait souhaité s’entretenir avec le docteur Stockhausen. La secrétaire lui conseilla d’envoyer un mail et d’exposer sa requête par écrit. Gaspard insista pour que son numéro de téléphone soit noté et que sa demande soit transmise de vive voix à l’intéressé. L’employée assura que ce serait fait, puis lui raccrocha quasiment au nez.
Parle à mon cul… soupira-t-il.
Au même moment, il reçut un SMS de Madeline. Elle lui demandait les coordonnés d’Isabella, la cousine de Sotomayor. Fidèle à la ligne qu’il s’était fixée, il résista à l’envie de l’appeler pour en savoir davantage et se contenta de lui transférer le numéro qu’elle réclamait.
Comme sa tisane était froide, il leva la main pour en commander une autre, mais son mouvement s’arrêta net. Pendant presque une minute, son regard se bloqua sur les centaines de bouteilles qui tapissaient le mur derrière le barman. Rhum, cognac, gin, bénédictine, chartreuse. Des couleurs intenses, aussi chatoyantes que des diamants, qui l’hypnotisaient. Des liqueurs de feu, des alcools parfumés qui flamboyaient dans leurs écrins de verre. Armagnac, calvados, absinthe, curaçao, vermouth, cointreau.
Un instant, Gaspard s’autorisa à croire qu’il parviendrait à mieux réfléchir après une lampée d’alcool. À court terme, c’était sans doute vrai, mais, s’il replongeait maintenant, son enquête sortirait du chemin rigoureux, ascétique et vertueux qu’il avait commencé à tracer. Pourtant les reflets mordorés des whiskys possédaient un pouvoir d’attraction presque sans limites. Il se sentit défaillir. C’était le propre du sevrage : le danger que le manque vous cueille à un moment où vous ne vous y attendez pas. Un gouffre s’ouvrit dans son ventre. Sa poitrine se compressa, ses tempes bourdonnaient sous la sueur.
Il connaissait le goût associé à chaque bouteille, chaque marque, chaque étiquette. Ce blend japonais, doux et crémeux, les notes boisées de single malt écossais, les arômes francs d’un whiskey irlandais, le goût de miel d’un vieux bourbon, les saveurs d’orange et de pêche d’un Chivas.
Comme la veille, Gaspard déglutit, se frictionna les épaules et le cou pour faire refluer ses tremblements. Mais, cette fois, l’orage ne repartit pas comme il était venu. Il ne s’appartenait plus. Malgré toute sa volonté, il était sur le point de céder.
C’est là que son téléphone sonna. Affiché sur l’écran, un numéro de portable inconnu.
— Oui ? demanda-t-il en décrochant, avec l’impression que sa voix se tordait pour franchir la barrière de sa gorge.
— Monsieur Coutances ? Ici Dwight Stockhausen. Vous avez un créneau juste avant le déjeuner ?
2.
Madeline rabattit le pare-soleil pour se protéger de la réverbération.
La lumière était partout, aveuglante, totale, cannibalisant l’ensemble de son champ de vision.
Depuis deux heures, au volant du pick-up, elle taillait la route vers Long Island. Le panorama était contrasté, tour à tour exaspérant et envoûtant. Les manoirs tape-à-l’œil des millionnaires alternaient avec des coins de villégiature tout droit sortis des années 1950 et des paysages de fin du monde : des plages de sable blanc qui s’étendaient à l’infini sous un ciel repeint à la chaux. Ayant dépassé Westhampton, elle traversait depuis vingt kilomètres les grosses bourgades — Southampton, Bridgehampton — qui se succédaient sur la longue bande de terre bordée par l’Atlantique.
Au détour d’un chemin sablonneux, le GPS sembla bégayer. Madeline crut qu’elle s’était perdue et guetta un endroit pour faire demi-tour. C’est alors qu’elle aperçut la maison de retraite. À cinquante mètres de la plage, c’était une grande et vieille bâtisse en bardage de bois entourée de pins et de bouleaux.
Elle se gara près des arbres et claqua la porte du pick-up. L’atmosphère sauvage du lieu l’envoûta aussitôt. Sous un ciel laiteux, le vent se déchaînait, modelant les dunes, saturant l’air d’un parfum iodé et alcalin. Caspar David Friedrich revisité par Edward Hopper.
Elle monta la volée de marches qui conduisait à l’entrée. Pas de sonnette ou d’ouverture automatique. Juste une porte en peinture écaillée protégée par une moustiquaire déchirée, qui couina lorsqu’elle la poussa. Madeline atterrit dans un hall désert qui sentait l’humidité.
— Il y a quelqu’un ?
D’abord, la seule réponse fut celle du vent qui menaçait de dessouder les joints des fenêtres.
Puis un homme aux cheveux longs et roux apparut en haut d’un escalier. Débraillé, vêtu d’une tenue d’infirmier d’un blanc douteux, il tenait une canette de Dr Pepper dans la main.
— Bonjour, dit Madeline. Je me suis peut-être trompée d’adresse…
— Non, assura l’infirmier en descendant l’escalier. Vous êtes bien à l’Eilenroc House Senior Citizens.
— Il n’y a pas grand monde, on dirait.
L’homme avait une trogne un peu effrayante — déchirée par des balafres, sillonnée par des cicatrices d’acné — d’où émergeait pourtant un regard azur étonnamment doux.
— Je m’appelle Horace, se présenta-t-il, en nouant sa tignasse avec un élastique.
— Madeline Greene.
Il posa sa boisson sur la planche qui faisait office de banque d’accueil.
— La plupart des pensionnaires sont partis, expliqua-t-il. La maison de retraite fermera définitivement ses portes à la fin février.
— Ah bon ?
— Le bâtiment va être détruit pour construire un hôtel de luxe à la place.
— C’est dommage.
Horace grimaça.
— Les mafieux de Wall Street mettent à sac toute la région. Ils mettent à sac tout le pays, d’ailleurs ! Et ce n’est pas avec l’élection de cette couille molle de Tad Copeland que les choses vont s’arrêter.
Читать дальше