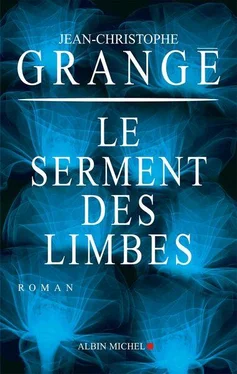À partir de ce moment, ce fut la seule idée qui me tint debout.
L’enterrement de Manon eut lieu à Sartuis, le mardi 19 novembre, dans un cimetière désert. Quelques journalistes étaient là et c’était tout. Chopard, le vieux reporter, faisait de la figuration. Le père Mariotte avait accepté de bénir le cercueil et de prononcer une oraison funèbre — il devait bien ça à Manon.
Marilyne Rosarias m’avait accompagné. Quand la sépulture fut scellée, elle murmura :
— Rien n’est fini.
Je tournai la tête, sans réagir. Mon cerveau fonctionnait en première.
— Le diable est toujours vivant, continua-t-elle.
— Comprends pas.
— Bien sûr que si. Ce carnage, ce gâchis, c’est son œuvre. Ne le laisse pas triompher.
Sa voix m’atteignait à peine. Toute ma pensée était oblitérée par Manon. Un destin marqué par une étoile noire. Et quelques souvenirs, pour moi aussi sinistres qu’une poignée d’osselets dans ma main. Elle poursuivit, en désignant la tombe :
— Lutte pour elle. Que le démon ne puisse pas emporter sa mémoire. Prouve qu’elle était ailleurs et que lui seul a tué les enfants. Trouve-le. Anéantis-le.
Sans attendre de réponse, elle fit volte-face. Les lignes coupantes de sa pèlerine fendirent l’air gris. Je la regardai s’éloigner. Elle venait de prononcer tout haut ce qu’une petite voix ne cessait de me murmurer, malgré mes vœux monastiques.
La moisson de terreur n’était pas achevée.
Avant d’abdiquer, je devais agir.
Je ne pouvais laisser le dernier mot au diable.
Il me restait à le trouver et à l’affronter.
Vendredi 22 novembre. Retour à Paris .
La ville arborait déjà ses parures de Noël. Guirlandes, boules, étoiles : ultime affront à mes propres ténèbres. Ces lumières, ces scintillements, qui peinaient à vaincre le jour terne, ressemblaient à une galaxie miteuse dans un ciel de cendres. Je conduisais maintenant une Saab — une nouvelle voiture de location.
En route pour Villejuif, je m’arrêtai d’abord porte Dorée. Je voulais me recueillir sur les tombes de Laure et des petites filles, enterrées au cimetière sud de Saint-Mandé.
Je trouvai sans difficulté la sépulture de granit, surmontée d’une stèle plus claire. Trois portraits étaient disposés en triangle, soulignés par ces mots :
« Ne pleure pas sur les morts. Ils ne sont plus que des cages dont les oiseaux sont partis. »
Je reconnus la citation. Musluh al-Dîn Saadi, poète persan du XIII esiècle. Pourquoi un auteur profane ? Pourquoi aucun signe catholique ? Qui avait choisi cette phrase ? Luc était-il en état de décider quoi que ce soit ?
Je m’agenouillai et priai. J’étais hagard, dans un état second, ne comprenant même plus ce que signifiaient ces portraits sur la pierre, mais je murmurai les mots :
« De toi Seigneur,
De toi vient notre espoir
Quand nos jours sont obscurcis
Et que notre existence est déchirée… »
Je repris la route de Villejuif. Luc Soubeyras. Depuis le carnage, je ne lui avais pas parlé directement. Je lui avais seulement laissé deux messages à l’hôpital, restés sans réponse. Plus que sa détresse, je redoutais sa colère, sa folie.
À 11 heures du matin, je retrouvai le mur aveugle de l’institut Paul-Guiraud, les terrains de sport, les pavillons en forme de hangars aériens. Je m’arrêtai au pavillon 21, craignant que Luc ait déjà été transféré à Henri-Colin, l’unité pour malades difficiles. Mais non. Il était de nouveau installé dans une chambre standard du pavillon, en Hospitalisation Libre. En réalité, il n’avait passé que quelques heures en « HO ».
— Je suis désolé de n’avoir pas été là à l’enterrement.
— Tu n’étais pas là ?
Luc paraissait sincèrement étonné. En jogging bleu clair, il était allongé sur son lit, dans une attitude de décontraction. Il paraissait plongé dans ses pensées, manipulant quelques brins de corde, sans doute piqués à l’atelier d’ergothérapie.
— J’ai dû m’occuper des funérailles de Manon.
— Bien sûr.
Il ne quittait pas des yeux son bricolage de nœuds. Il parlait avec douceur, mais aussi une autre nuance : distance, ironie. J’avais préparé un discours — une tirade chrétienne sur le sens caché des événements — mais il valait mieux m’abstenir. Je n’avais pas protégé sa famille. Je n’avais prêté aucune attention à sa requête. Je risquai :
— Luc, je suis désolé. J’aurais dû réagir plus vite. J’aurais dû placer des hommes, je…
— Ne parlons plus de ça.
Il se redressa et s’assit sur le bord du lit, en soupirant. Incapable de me contenir, j’en vins directement à mon obsession :
— Ce n’est pas elle, Luc. Elle n’était pas à Paris quand Laure et les petites ont été tuées.
Il tourna la tête et me regarda, sans me voir. Ses pupilles dorées n’étaient pas mortes, pourtant. Elles frémissaient, sous les brefs cillements.
Face à son silence, j’ajoutai, presque agressif :
— Ce n’est pas elle et ce n’est pas de ma faute !
Luc s’allongea à nouveau et ferma les yeux :
— Laisse-moi. Je dois me reposer.
Je lançai un coup d’œil autour de moi — la cellule blanche, le lit, la tablette. Pas de cahier noir. Pas de livre. Pas de télévision. Je demandai, d’une manière absurde :
— Tu… tu n’as besoin de rien ?
— Je dois me reposer. Avant d’accomplir ma mission.
— Quelle mission ?
Luc rouvrit les paupières et conserva le regard fixe. Ses cils semblaient saupoudrés de sucre de canne.
Un sourire fendit le bas de son visage :
— Te tuer.
De retour à mon bureau du 36, je verrouillai ma porte et regroupai mon dossier d’enquête. Tout ce que j’avais collecté depuis le 21 octobre dernier, depuis mes notes sur le meurtre de Larfaoui jusqu’aux renseignements imprimés concernant Moritz Beltreïn, en passant par les articles de Chopard, le rapport d’autopsie de Valleret, les notes prises au Vatican, les articles et les photos de Catane, le bilan de Callacciura, les dossiers médicaux des Sans-Lumière, les rapports de Foucault, de Svendsen…
Il y avait une clé cachée parmi ces documents.
Le venin noir de l’histoire n’était pas totalement extrait.
13 heures.
Je me jurai de ne pas sortir de là avant d’avoir trouvé un signe, un élément, qui me donne un début de piste pour expliquer comment la famille de Luc avait pu être massacrée alors que le tueur de l’affaire, Moritz Beltreïn, se trouvait à mille kilomètres du lieu du crime.
Avant de prendre le train, à Besançon, j’étais passé voir Corine Magnan. Elle était rentrée dans son fief deux jours après la mort de Manon. Elle avait aussitôt traversé la frontière pour auditionner les équipes fédérales chargées des constatations dans la villa de Moritz Beltreïn. Le meurtre de Sylvie Simonis était une affaire sortie. Le coupable était identifié. Toutes les preuves avaient été retrouvées chez lui : les photographies, les insectes, le lichen, un stock d’iboga…
La magistrate avait exposé ces éléments lors d’une conférence de presse, à Besançon, le mardi 19 novembre. Je n’y étais pas allé mais elle m’avait résumé ses conclusions. Moritz Beltreïn, spécialiste de la réanimation, avait vengé ses « pupilles », en tuant les responsables de leur plongée dans le coma. Parallèlement, il avait conditionné ces survivants grâce à un arsenal chimique et les avait persuadés qu’ils avaient eux-mêmes tué ses victimes. Le dément avait aussi éliminé Stéphane Sarrazin, qui menaçait de découvrir sa culpabilité.
Читать дальше