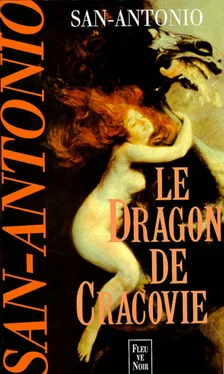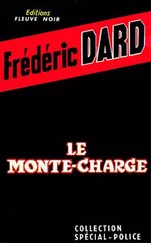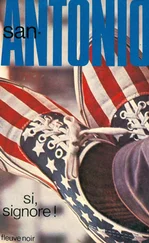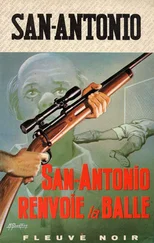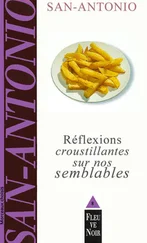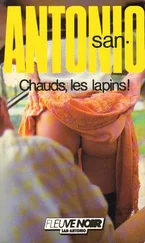San-Antonio
Le Dragon de Cracovie
À Claude Durand, en souvenir de nos quatre pas dans les nuages.
SAN-ANTONIO
L’ACTION DE CE LIVRE SE PASSE EN 1988
Avant que de commencer ce livre, il convient d’apporter quelques précisions au lecteur à propos d’une affaire tenue secrète pendant cinquante années, et qui n’aurait jamais subi l’éclairage de l’Histoire si certains événements relevant du simple fait divers ne s’étaient produits.
La chose s’opéra à Berchtesgaden le 19 novembre 1937, à l’occasion d’une visite diplomatique que Lord Halifax rendit au maître de l’Allemagne nazie.
Au soir de cette journée encombrée de tractations épineuses, Hitler se trouva aux prises avec l’une de ces irascibles migraines dont il était coutumier. Elle fut si violente qu’il sonna l’infirmière de nuit.
Celle-ci se pointa, nue sous sa blouse professionnelle, si l’on excepte une culotte d’honnête femme qu’elle n’ôtait que dans sa salle de bains.
Il s’agissait d’une gretchen blonde à la chair ferme et aux yeux couleur de myosotis. Elle dégageait une saine odeur de jambon et d’eau de Cologne qui plut au Führer cependant peu sollicité par les femelles.
Ses névralgies ne se calmant pas après la prise d’une médication, elle proposa de lui masser la nuque. Il eut la sagesse d’accepter et, presque instantanément, ses cervicales cessèrent de le tracasser.
Au cours de cette thérapie élémentaire, ils parlèrent ; comportement de toute exception de la part d’un homme qui pensait les dents serrées pour être certain de ne pas se livrer.
Elle avoua à son patient qu’elle se nommait également Hitler et que, d’après des recherches opérées par son grand-oncle, employé d’état civil, ils descendaient d’une même souche.
La nouvelle amusa énormément le Führer. Au lieu de prendre la mouche et de la faire précipiter d’une falaise voisine pour son audace, une charmante pulsion patronymique le fit se jeter sur elle et il la troussa comme l’eût fait un Feldwebel.
Éblouie — on le serait à moins —, Frida ne tenta rien pour se séparer de la semence chancelière.
Bien lui en prit, puisqu’en août 1938, elle donna le jour à un gros garçon blondasse qu’on prénomma Richard. L’enfant naturel de « qui vous savez maintenant », peu doué pour les études, se fit boucher, se maria et eut en 1970, un fils qui devait devenir le héros de cet ouvrage et dont la grand-mère exigea qu’on l’appelle Adolf.
Il est utile de préciser que le maître du Grand Reich ignora cette paternité dont son orgueil se serait mal accommodé.
Pour en finir avec le boucher transitoire, ajoutons qu’il se tua avec sa femme, en 1984, au volant d’un cabriolet Mercedes gris métallisé, de 12 cylindres, qu’il ne put maîtriser et s’en alla planter dans un poids lourd batave chargé de bière Heinenken dont, au passage, je signale qu’elle est ma préférée.
Au moment de son orphelinade, Adolf atteignait ses quatorze ans. Enfant au physique plutôt ingrat (il ressemblait à son grand-père), il présentait une constitution chétive, ne riait jamais, posait sur le monde un regard en forme de crachat, s’exprimait au plus juste, se montrait inaccueillant, lisait beaucoup, allait souvent au cinéma, dessinait avec habileté, écrivait des sentences d’une portée générale, aimait la littérature russe (principalement Dostoïevski), haïssait ses compagnons d’étude, introduisait des corps résolument étrangers dans le con de leurs sœurs (entre autres une grenouille, un soir d’été), et finissait toujours par tuer les animaux qu’il adoptait.
Après que ses parents se furent anéantis dans de la ferraille hollandaise et comme il se trouvait mineur, sa grand-mère paternelle le recueillit en sa maisonnette de la banlieue viennoise. Ce changement de vie ne lui déplut pas : il détestait l’ambiance sanguinolente de ses géniteurs.
Des animaux, morts et tronçonnés, dominaient les occupations familiales. Le pire étant les livraisons qu’on le chargeait d’effectuer. Cette substance musculaire, molle et froide à travers le papier sulfurisé, le plongeait dans un tel dégoût qu’il portait des gants pour la manipuler.
À l’époque de son double deuil, Mutti Frida allait sur ses quatre-vingts ans. Elle restait une forte femme au corsage plantureux, dont les yeux délavés ne voyaient plus guère et que des plaies variqueuses contraignaient à porter des bas épais comme des jambières de picador. N’ayant jamais possédé beaucoup d’esprit, elle conservait le sien intact. La venue de son petit-fils dans son existence la combla car elle exécrait la solitude. Elle lui aménagea la meilleure chambre de sa confortable maison et le laissa à peu près libre de gérer son temps. La présence de cet être silencieux, aux habitudes rangées, qui débarrassait la table sans qu’on le lui demande, constituait une aubaine pour la vieille dame.
Elle n’avait parlé à personne du coup de bite d’Adolf Hitler ; même sous la torture, elle ne l’eût point avoué. Il représentait l’instant culminant de son destin et restait une espèce de secret d’État qui n’appartenait même pas à l’Histoire. Il lui tint lieu d’époux.
Si elle connut quelques mâles, après sa merveilleuse aventure de Berchtesgaden, ce ne furent que des amours diurnes car, comme elle parlait en dormant, elle redoutait d’être trahie par les perfidies du sommeil.
Lorsqu’en 1945, le Dieu des Enfers s’anéantit dans l’apocalypse du bunker, elle en conçut un obscur chagrin qu’elle sut cacher à ses familiers. La certitude d’être l’unique femme à assurer la continuité terrestre d’un être à ce point exceptionnel la réconforta. Déçue par son fils, lequel n’évoquait en rien son glorieux amant, elle conservait une foi tenace, que la naissance d’Adolf récompensa. Cette fabuleuse ressemblance vainement cherchée dans le visage ingrat du boucher surgissait, sublime, sur celui de son rejeton. Quand il arrivait à Frida de comparer les photos du Führer enfant et de son petit-fils, elle fondait en larmes d’émotion à la vue d’un pareil mimétisme.
Plus tard, elle décida le jeune homme à laisser pendre une mèche sur son front, se promettant, par la suite, de lui conseiller le port de la moustache. L’épopée national-socialiste s’estompait dans les mémoires. Le nom d’Adolf Hitler ne faisait plus frissonner personne. Les enfants ignoraient son existence. Il était devenu un sujet (à choix) du baccalauréat.
1
Le dimanche, pour peu que le temps ne fût point hostile, il aimait à flâner par les hauts lieux touristiques de la ville, non qu’il prisât la foule, mais elle attisait en lui un étrange sentiment de haine qui le fortifiait. Un cahier de croquis sous le bras, il cherchait une aire de calme dans ce lent malaxage humain. Il n’en existait guère, pourtant il en dénichait toujours : de ces zones négligées, nichées dans un recoin de square ou près de l’arc-boutant d’un édifice. En garçon soigneux, il étalait au sol quelque étoffe réservée à cet usage et s’asseyait dessus en tailleur.
Adossé à une grille ou à un mur, il contemplait ces gens qui badaient, sans plaisir apparent, dans un crépitement d’appareils photographiques, à la recherche d’ils ignoraient quoi. Une forte odeur de crottin émanait des calèches en stationnement. Des amoureux, affamés d’eux-mêmes, accouraient vers son coin de repos puis, l’apercevant, s’éloignaient promptement. Il leur adressait des gestes insultants dont les couples n’osaient se formaliser.
Sa misanthropie le détendait. Il s’efforçait d’imaginer ce que serait la Terre dans quelques millions d’années : sans doute une planète morte, dépouillée comme un os de seiche, qui poursuivrait sa morne rotation sous un soleil légèrement moins ardent ?
Читать дальше