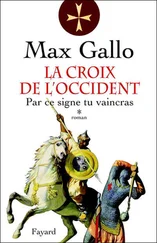Max Gallo - L'âme de la France
Здесь есть возможность читать онлайн «Max Gallo - L'âme de la France» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, fra. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:L'âme de la France
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
L'âme de la France: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «L'âme de la France»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
L'âme de la France — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «L'âme de la France», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Des manifestations de « rappelés » tentent de bloquer les voies ferrées pour arrêter les trains qui les conduisent dans les ports d'embarquement.
Des écrivains se rassemblent dans un « Manifeste des 121 » pour appuyer le « droit à l'insoumission » (Claude Simon, Michel Butor, Claude Sarraute, Jean-François Revel, Jean-Paul Sartre) en septembre 1960.
Mendès France, ministre d'État, démissionne le 23 mai 1956 du gouvernement Guy Mollet afin de marquer son opposition à cette politique algérienne.
La France vit ainsi de manière de plus en plus aiguë, à partir de 1956, un moment de tensions et de divisions qui fait écho aux dissensions qui l'ont partagée tout au long de son histoire.
On évoque l'affaire Dreyfus. On recueille, à la manière de Jaurès, des preuves pour établir les faits, identifier les tortionnaires, condamner ce pouvoir politique qui a remis aux militaires – le général Massu à Alger – les fonctions du maintien de l'ordre en laissant l'armée agir à sa guise, choisir les moyens qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
La « gangrène » corrompt ainsi le pouvoir politique et certaines unités de l'armée dans une sorte de patriotisme dévoyé.
Certains officiers s'insurgent contre cette guerre qui viole le droit : ainsi le général Pâris de Bollardière, héros de la France libre. D'autres tentent de faire la part des choses afin de conjuguer honneur et efficacité.
Le responsable de ce chaos moral est à l'évidence un pouvoir politique hésitant, instable et impuissant.
En 1956, outre l'envoi du contingent en Algérie – choix d'une solution militaire à laquelle on accorde tous les moyens, et les pleins pouvoirs sur le terrain –, il a tenté de remporter une victoire politique.
Violant le droit international, le gouvernement a détourné un avion de ligne et arrêté les chefs du FLN.
Puis, en octobre-novembre 1956, en accord avec le Royaume-Uni et l'État d'Israël, la France participe à une expédition militaire en Égypte afin de riposter à la nationalisation du canal de Suez décidée par les Égyptiens. Mais, pour Guy Mollet, s'y ajoute l'intention de frapper les soutiens internationaux du FLN en abattant au Caire le régime nationaliste du colonel Nasser.
Le moment paraît bien choisi : les Russes font face à une révolution patriotique en Hongrie.
Les États-Unis sont à la veille d'une élection présidentielle.
Guy Mollet espère aussi obtenir un regain de popularité dans l'opinion, satisfaite d'une opération militaire réussie – et qu'on exalte –, et favorable au soutien à Israël.
Mais Russes et Américains vont dénoncer conjointement cette initiative militaire, et les troupes franco-britanniques seront rapatriées.
Cet échec scelle une nouvelle étape dans la décomposition de la IV e République et annonce celle du Parti socialiste.
Il confirme que la « tragédie algérienne » domine la politique française.
Des événements lourds de conséquences – le traité de Rome, qui crée la Communauté économique européenne et Euratom en 1957, la loi-cadre de Gaston Defferre pour l'Union française, ou même l'attribution d'une troisième semaine de congés payés – sont éclipsés par les graves tensions que crée la guerre d'Algérie.
Le sort de la IV e République est bien déterminé par elle.
Il est scellé au mois de mai 1958, en quelques jours.
Paris et Alger sont les deux pôles de l'action.
À Paris, le 13 mai, Pierre Pflimlin, député MRP, est investi à une très large majorité (473 voix contre 93, les communistes lui ayant apporté leurs suffrages). Président du Conseil, on le soupçonne d'être un partisan de la négociation avec le FLN.
À Alger, depuis plusieurs mois, des gaullistes veulent se servir des complots que trament les « activistes », décidés à maintenir l'Algérie française avec l'appui de l'armée, pour favoriser un retour du général de Gaulle.
Le 13 mai, des manifestants envahissent les bâtiments publics – le siège du Gouvernement général – et les mettent à sac.
Le général Massu prend la tête d'un « Comité de salut public » qui réclame au président de la République la constitution d'un « gouvernement de salut public ».
En même temps, des éléments de l'armée préparent une opération « Résurrection » dont le but est d'envoyer en métropole des unités de parachutistes.
La perspective d'un coup d'État militaire est utilisée par les gaullistes pour lancer l'idée d'un recours au général de Gaulle, seul capable d'empêcher le pronunciamiento.
À Paris, de Gaulle, le 19 mai, au cours d'une conférence de presse, se montre disponible. Tout en n'approuvant pas le projet de coup d'État – qu'il ne désavoue cependant pas –, il affirme qu'il veut rester dans le cadre de la légalité en se présentant en candidat à la direction du pays.
Ce double jeu réussit, avec la complicité du président Coty, qui entre en contact avec le Général et le désigne en fait pour assurer la charge suprême.
Pflimlin démissionne le 27 mai.
La gauche manifeste le 28, dénonçant la manœuvre, répétant que « le fascisme ne passera pas », marchant derrière Mitterrand, Mendès France, Daladier et le communiste Waldeck Rochet.
Mais les jeux sont faits : un accord a été passé avec Guy Mollet et les chefs des groupes parlementaires. Mitterrand seul l'a refusé.
Le 1 er juin, la manœuvre gaulliste, utilisant la menace de coup d'État mais demeurant formellement dans le cadre de la légalité, a abouti : devant l'Assemblée nationale, de Gaulle obtient 329 voix contre 224.
Il dispose des pleins pouvoirs.
Le gouvernement – qui comprend notamment André Malraux, Michel Debré, Guy Mollet, Pierre Pflimlin – est chargé de préparer une Constitution.
Le 4 juin, de Gaulle se rend en Algérie. Il est acclamé et lance : « Je vous ai compris » et « Vive l'Algérie française ! »
L'ambiguïté demeure : de Gaulle a été appelé pour résoudre le problème algérien. Par la négociation ou par une guerre victorieuse ? En satisfaisant les partisans de l'Algérie française, ou en inventant un nouveau statut pour l'Algérie, voire en lui accordant l'autodétermination et l'indépendance ?
De Gaulle a les moyens d'agir.
La Constitution, qui est à la fois présidentielle et parlementaire, mais donne de larges pouvoirs au président élu par un collège de 80 000 « notables », permet à l'exécutif d'échapper aux jeux parlementaires, même si le gouvernement doit obtenir la confiance des députés.
Avec l'article 16, le président dispose en outre d'un moyen légal d'assumer tous les pouvoirs et de placer de facto le pays en état de siège.
Le 28 septembre 1958, par référendum, 79,2 % des votants approuvent la Constitution.
La IV e République est morte. La V evient de naître.
Le 21 décembre, de Gaulle est élu président de la République par 78,5 % des voix du collège des « grands électeurs », où les élus locaux écrasent par leur nombre les parlementaires.
Le 9 janvier, Michel Debré est nommé Premier ministre.
L'impuissance de la IV e République a donc conduit à sa perte.
La crise, qui pouvait déboucher sur une guerre civile, s'est dénouée dans le respect formel des règles et des procédures républicaines. Mais le passage d'une République à l'autre s'est déroulé sous la menace – le chantage ? – d'un coup d'État.
Aux yeux de certains (Pierre Mendès France avec sincérité, Mitterrand en habile politicien), là est le péché originel de la V e République. Selon eux, la Constitution gaulliste ne pourrait donner naissance qu'à un régime de « coup d'État permanent ».
En fait, le pays apaisé a choisi l'homme dont il pense qu'il peut en finir avec la tragédie algérienne.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «L'âme de la France»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «L'âme de la France» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «L'âme de la France» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.