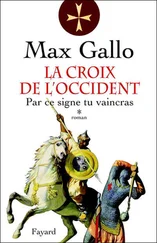Max Gallo - L'âme de la France
Здесь есть возможность читать онлайн «Max Gallo - L'âme de la France» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, fra. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:L'âme de la France
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
L'âme de la France: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «L'âme de la France»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
L'âme de la France — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «L'âme de la France», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
En même temps, la France reçoit un siège permanent – avec droit de veto – au Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies. Paris est choisi comme siège de l'Unesco. La France a ainsi retrouvé son rang de grande puissance, et quand on se remémore l'effondrement total de 1940 on mesure l'exceptionnel redressement accompli.
Le fait que la France ait été capable, dans la dernière année de la guerre, de mobiliser plusieurs centaines de milliers d'hommes (500 000) engagés dans les combats en Italie et sur le Rhin, puis en Allemagne, a été la preuve de la reconstitution rapide de l'État national et a favorisé la réadmission de la France parmi les grandes puissances.
Elle est l'un des vainqueurs.
Le plus faible, certes, le plus blessé en profondeur, celui qui commence déjà à subir en Indochine et en Algérie – à Sétif, le 8 mai 1945 – les revendications d'indépendance des nationalistes des colonies.
Mais elle peut à nouveau faire entendre sa voix, envisager une entente avec l'Allemagne.
Depuis 1870, entre les deux nations, c'est une alternance de défaites et de revanches : 1870, effacé par la victoire de 1918 ; celle-ci gommée par l'étrange défaite de 1940, annulée à son tour par la capitulation allemande de 1945. Se rendant cette année-là à Mayence, de Gaulle, face à cet affrontement toujours renouvelé et stérile entre « Germains et Gaulois », peut dire :
« Ici, tant que nous sommes, nous sortons de la même race. Vous êtes, comme nous, des enfants de l'Occident et de l'Europe. »
Ces constats ne peuvent devenir les fondations d'une politique étrangère nouvelle que si le régime échappe aux faiblesses institutionnelles qui ont caractérisé la III e République.
Ainsi se pose à la France, dès la fin de 1944, la question de sa Constitution.
De Gaulle a obtenu par référendum, contre tous les partis, que l'Assemblée élue le 21 octobre 1944 soit constituante.
Mais, dès les premiers débats, les partis politiques choisissent de soumettre le pouvoir exécutif au pouvoir parlementaire, le président de la République se trouvant ainsi réduit à une fonction de représentation.
On peut prévoir que les maux de la III e République – instabilité gouvernementale, jeux des partis, méfiance à l'égard de la consultation directe des électeurs par référendum – paralyseront de nouveau le régime, le réduisant à l'impuissance.
De Gaulle tire la conséquence de cet état de fait et démissionne le 20 janvier 1946 en demandant « aux partis d'assumer leurs responsabilités ».
C'est la fin de l'unité nationale issue de la Résistance. Dès le 16 juin 1946, le Général se présente comme le « recours » contre la trop prévisible impotence de la IV e République qui commence.
La France unie a donc été capable de restaurer l'État, de reprendre sa place dans le monde. Mais les facteurs de division issus de son histoire, avivés par la conjoncture internationale (la guerre froide s'annonce, isolant les communistes, liés perinde ac cadaver à l'URSS), font éclater l'union fragile des forces politiques. Les partis veulent être maîtres du jeu comme sous la III e République. L'exécutif leur est soumis. Il ne peut prendre les décisions qui s'imposent alors que, dans l'empire colonial, se lèvent les orages.
65.
De 1946 à 1958, durant la courte durée de vie de la IV e République, la France change en profondeur. Mais le visage politique du pays s'est à peine modifié. Le président du Conseil subit la loi implacable de l'Assemblée nationale. Il lui faut obtenir une investiture personnelle, puis, une fois le gouvernement constitué, il doit solliciter à nouveau un vote de confiance des députés.
L'Assemblée est donc toute-puissante, et le Conseil de la République (la deuxième chambre, qui a remplacé le Sénat) n'émet qu'un vote consultatif.
Dès lors, comme dans les années 30, l'instabilité gouvernementale est la règle. Chaque député influent espère chevaucher le manège ministériel. Mais ce sont le plus souvent les mêmes hommes qui se succèdent, changeant de portefeuilles.
Ces gouvernements, composés conformément aux règles constitutionnelles, sont parfaitement légaux. Mais, question cardinale, sont-ils légitimes ? Quel est le rapport entre le « pays légal » et le « pays réel » ?
Il n'est pas nécessaire d'être un disciple de Maurras pour constater le fossé qui se creuse entre les élites politiques et le peuple qu'elles sont censées représenter et au nom duquel elles gouvernent.
Cette fracture, si souvent constatée dans l'histoire nationale, s'élargit jour après jour, crise après crise, entre 1946 et 1954, année qui représentera, avec le début de l'insurrection en Algérie, un tournant aigu après lequel tout s'accélère jusqu'à l'effondrement du régime, en mai 1958.
La discordance entre gouvernants et gouvernés est d'autant plus nette que le pays et le monde ont, pendant cette décennie, été bouleversés par des changements politiques, technologiques, économiques et sociaux.
À partir de 1947, la guerre froide a coupé l'Europe en deux blocs. Les nations de l'Est sont sous la botte russe.
Le « coup de Prague » en 1948, le blocus de Berlin par les Russes, la division de l'Allemagne en deux États, la guerre de Corée en 1950, la création du Kominform en 1947, de l'OTAN en 1949, auquel répondra le pacte de Varsovie, le triomphe des communistes chinois (1949), tous ces événements ont des conséquences majeures sur la vie politique française.
Le 4 mai 1947, les communistes sont chassés du gouvernement. L'anticommunisme devient le ciment des majorités qui se constituent et n'existent que grâce à une modification de la loi électorale qui, par le jeu des « apparentements », rogne la représentation parlementaire communiste.
Le PCF ne perd pas de voix, au contraire, mais il perd des sièges. En 1951, avec 26 % des voix, il a le même nombre de députés que les socialistes, qui n'en rassemblent que 15 % !
La « troisième force » (SFIO, MRP et députés indépendants à droite) est évidemment légale, mais non représentative du pays.
Elle l'est d'autant moins qu'autour du général de Gaulle s'est créé en 1947 le Rassemblement du peuple français (RPF), qui va obtenir jusqu'à 36 % des voix.
De Gaulle conteste les institutions de la IV e République, « un système absurde et périmé » qui entretient la division du pays alors qu'il faudrait retrouver « les fécondes grandeurs d'une nation libre sous l'égide d'un État fort ».
Même s'il dénonce les communistes, qui « ont fait vœu d'obéissance aux ordres d'une entreprise étrangère de domination », de Gaulle est considéré par les partis de la « troisième force » comme un « général factieux », et Blum dira : « L'entreprise gaulliste n'a plus rien de républicain. »
En fait, l'opposition entre les partis de la « troisième force » et le mouvement gaulliste va bien au-delà de la question institutionnelle. Certes, inscrites dans la tradition républicaine, il y a le refus et la crainte du « pouvoir personnel », le souvenir des Bonaparte, du maréchal de Mac-Mahon, et même du général Boulanger, la condamnation de l'idée d'« État fort ». L'épisode récent du gouvernement Pétain – encore un militaire ! – a renforcé cette allergie.
La République, ce sont les partis démocratiques qui la font vivre. L'autorité d'un président de la République disposant d'un vrai pouvoir est, selon eux, antinomique avec le fonctionnement républicain.
Mais, en outre, le « gaullisme » est ressenti comme une forme de nationalisme qui conduit au jeu libre et indépendant d'une France souveraine.
Or, la « troisième force », c'est la mise en œuvre de limitations apportées à la souveraineté nationale, la construction d'une Europe libre sous protection américaine (l'OTAN).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «L'âme de la France»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «L'âme de la France» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «L'âme de la France» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.