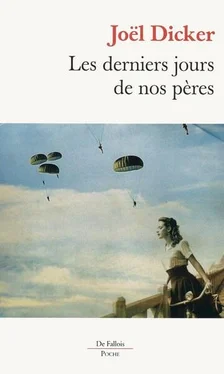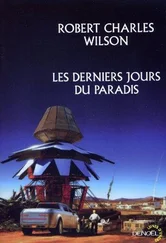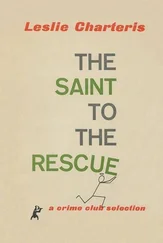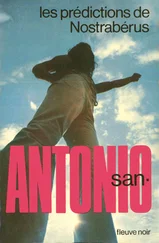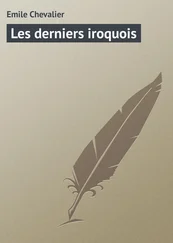Les larmes coulaient sur le visage du père, mais sa voix restait digne.
— Vous savez, je ne m’inquiétais pas. Pas trop. Grâce à ses cartes.
— Ses cartes ?
Le père sourit tristement.
— Des cartes postales. Ah, quelles cartes ! Toujours bien choisies.
Il se leva et alla les chercher sur la cheminée. Il les étala sur la table, devant Stanislas.
— Quand il m’a annoncé son départ, c’était… (il réfléchit un instant) en septembre 41. Je lui ai demandé de m’écrire. Pour que j’aie moins peur pour lui. Et il n’a pas manqué à sa promesse. Fidèle, vous avez dit ? C’est tout lui. Fidèle.
Stanislas, effaré, lisait une à une les cartes postales, les mains tremblantes. Il y en avait des dizaines, dont la plupart étaient celles de Kunszer. Mais Stanislas n’en savait rien. Ce qu’il constatait, c’était que Pal avait violé toutes les règles de sécurité ; il en connaissait d’avance les conséquences, et ça ne l’avait pas arrêté.
— Comment ces cartes vous sont-elles parvenues ?
— Dans ma boîte aux lettres. Sans timbre, dans une enveloppe. Comme si elles avaient été déposées par quelqu’un…
Pal, qu’avait fait Pal ! Stanislas avait envie de s’écrouler de désespoir : celui qu’il avait considéré comme son fils avait trahi ; même son Pal n’avait pas été un Homme. Il en tremblait. Pal était revenu à Paris pour voir son père. L’Abwehr l’attendait sûrement ; il avait dû être suivi, et il avait entraîné Faron dans sa chute. Et Laura, enceinte. Il l’avait jetée en pâture aux Allemands. Devait-il appeler Doff ? Non. Jamais. Ni Doff, ni personne ne devrait jamais savoir. Ne serait-ce que pour Philippe, pour qu’il n’ait jamais honte de son père, comme lui-même aujourd’hui. Il ne savait plus que penser. Devait-il renier celui qu’il avait aimé comme son propre fils ?
— Où Pal voulait-il vous emmener ? demanda Stanislas.
— À Genève. Il disait qu’on y serait à l’abri.
— Pourquoi n’êtes-vous pas parti ?
— Je ne voulais pas partir tout de suite. Pas comme ça. Je voulais dire au revoir à mon appartement. À mes meubles. Comme je vous ai dit, nous devions nous retrouver le lendemain, ici. Pour déjeuner, puis prendre le train de quatorze heures. Pour Lyon. Je l’ai attendu, mon Dieu comme je l’ai attendu. Il n’est jamais revenu.
Stanislas regarda le père qui sanglotait. Mais il ne lui faisait pas de peine. Son fils était venu le chercher, au moment le plus critique de la guerre, et le père avait voulu dire au revoir à ses meubles. Au fond de lui, Stanislas espérait que Pal avait été arrêté ce jour-là. Il espérait que ce n’avait pas été le lendemain, lorsqu’il était revenu vers son père pour le convaincre encore de partir. Cela aurait signifié que Pal n’était pas capable de se révolter contre son père. L’indispensable révolte des fils face à leur père. Sans doute Pal avait-il eu peur des derniers jours fatidiques : les derniers jours de son père. Mais les derniers jours de nos pères ne devaient pas être des jours de tristesse ; ils étaient des jours d’avenir et de perpétuation. Car, au dernier jour de son père, Pal était en train de devenir père lui-même.
— Que vais-je devenir désormais ? se désespéra le père qui ne voulait plus vivre.
— Pal a eu un enfant.
Le visage du père s’éclaira.
— Avec Laura ?
— Oui. Un beau garçon. Il a presque six mois.
— En voilà une nouvelle ! Je suis grand-père ! Un peu comme si mon fils n’était pas mort, alors ?
— Oui. Un peu.
— Et quand pourrais-je voir cet enfant ?
Stanislas mentit :
— Un jour… bientôt… En ce moment, il est à Londres, avec sa mère.
Laura ne devait pas rencontrer le père. Elle ne devait jamais savoir ce qu’avait fait Pal. De retour à l’hôtel, il lui mentirait, il lui dirait qu’il n’y avait plus de père, il ferait ce qu’il faudrait ; il s’arrangerait avec Doff, sans rien lui expliquer non plus, car personne ne devrait jamais savoir. Et, s’il le fallait, il tuerait le père pour que vive le secret. Oui, il le tuerait si c’était nécessaire !
*
— Racontez-moi dans les détails cette histoire, ordonna Doff à la concierge lorsqu’elle revint enfin, avec un plateau, la cafetière et des biscuits.
Il remarqua qu’elle s’était parfumée.
— Depuis les détails d’où ? La mort de la mère ?
— Non ! Cette histoire avec l’Allemand. Réfléchissez bien, c’est important.
Elle frissonna d’excitation ; elle avait une conversation importante.
— C’était il y a un an, capitaine. En septembre, je me rappelle bien le jour. J’étais ici sur ce fauteuil, ce fauteuil. Oui, c’est ça.
— Quoi ensuite ?
— J’ai entendu du brouhaha dans le couloir, là, juste devant la loge. Vous savez, colonel, les murs sont minces ici, et la porte comme du carton. Lorsque la porte de l’immeuble reste ouverte trop longtemps l’hiver, je sens le vent et le froid qui s’engouffrent dans mon salon, oui monsieur, comme du carton.
— Donc vous entendez du bruit dans le couloir…
— Parfaitement. Des voix d’hommes. En français et en allemand, même pas besoin de coller l’oreille au mur. Alors j’ouvre la porte, très doucement, je dirais même que j’entrouvre, c’est-à-dire que j’ouvre à peine mais suffisamment pour voir… Je fais souvent ça, pas pour espionner mais pour m’assurer que c’est pas des maraudeurs. Donc je regarde et je reconnais le petit Paul-Émile que j’avais pas vu depuis bien longtemps ! Et puis je vois aussi l’homme, qui le menace avec une arme, un sale type que j’avais déjà vu parce qu’il était venu me poser des questions, ici.
— Quel genre de questions ?
— Des questions sur Paul-Émile, son père, et sur Genève.
— Genève ?
— Parce que le fils était à Genève, dans une banque. Comme directeur, je crois. Mais moi, j’y ai pas trop dit, juste pour qu’il me fiche la paix, quoi.
— Mais c’était qui ce type ?
— Un policier français qu’il a dit la première fois. Mais ensuite, quand je l’ai revu dans le couloir, avec son pistolet et à parler dans sa langue de frisé avec deux autres types que j’avais jamais vus, j’ai compris que c’était un Allemand.
— Vous connaissez son nom ? l’interrompit Doff qui, à présent, prenait des notes sur un calepin en cuir vert.
— Non.
— Bon. Continuez…
— Ensuite, mon général, ce sale Allemand a jeté Paul-Émile dans le débarras, juste à gauche de l’entrée. Je pouvais plus voir, mais j’entendais qu’il le battait salement, et il lui disait de choisir. Il disait (elle prit un accent germanique grossier) : Je sais que vous êtes un agent anglais, et qu’il y a d’autres agents à Paris . Il a dit plus ou moins comme ça, mais sans accent, car il parlait le français sans accent, et c’est pour ça d’ailleurs que je ne me suis doutée de rien quand il a dit qu’il était un policier français.
— Choisir quoi ?
— Si Paul-Émile parlait, l’Allemand ne ferait pas de mal à son père. S’il ne parlait pas, le père finirait comme un Polonais, ou quelque chose comme ça.
— Et ?
— Il a parlé. J’ai pas tout entendu, mais Paul-Émile a parlé, et ils l’ont emmené. Et ce sale Allemand est revenu, ici, souvent. Ne me demandez pas pourquoi parce que j’en sais rien, mais en tout cas je sais ce que j’ai vu. Et puis au moment de la Libération, il a disparu, évidemment.
Doff resta sans voix : Pal avait donné Faron, il avait donné Laura. Celle qu’il aimait. Non, c’était impossible… Comment aurait-il pu envoyer Laura à la mort ? Quel désordre avait engendré Pal en venant ici ! Et pourquoi ? Doff décida que personne ne devrait jamais savoir, ni Stanislas ni personne. Il garderait le secret toute sa vie ; Philippe ne saurait jamais la vérité sur son père.
Читать дальше