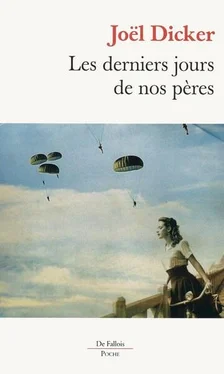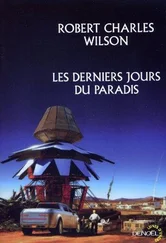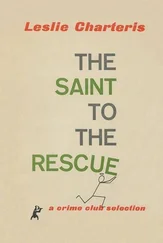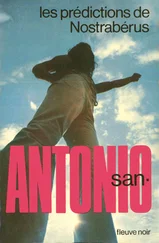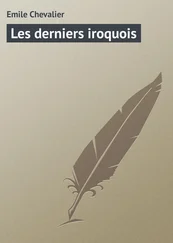C’était un bon abri ; l’intérieur sentait le vieux bois. Gros rassembla de la paille dans un coin et ils s’installèrent. La lumière du jour filtrait encore un peu ; ils étaient bien. Gros sortit de sa poche des friandises données par les GI’s. Il en proposa à la fille.
— Tu as faim ?
— Non, merci.
Silence.
— C’est un drôle de nom, « Gros », dit timidement la fille.
— C’est mon nom de guerre.
Elle le dévisagea, impressionnée.
— Vous êtes américain ?
— Je suis français. Mais lieutenant de l’armée britannique. Comment tu t’appelles ?
— Saskia.
— Tu es française ?
— Oui, lieutenant Gros.
— Saskia, c’est pas français…
— C’est pas mon vrai nom. C’est comme ça que les Allemands m’appelaient. Ceux qui revenaient du front russe m’appelaient aussi Sassioshka.
— C’est quoi ton vrai nom ?
— Saskia. Tant qu’il y aura la guerre, je serai Saskia. Comme vous, vous êtes le lieutenant Gros. Pendant la guerre, on porte son nom de guerre.
— Mais Saskia, c’est un nom plein de mauvais souvenirs…
— On a le nom de guerre qu’on mérite.
— Dis pas ça. Quel âge as-tu ?
— Dix-sept ans.
— Faudrait pas être une putain quand on a que dix-sept ans.
— Faudrait pas être une putain jamais.
— T’as raison.
— Vous êtes déjà allé chez les putes, lieutenant ?
— Oui.
— Vous avez aimé ?
— Non.
Caroline ne comptait pas. Les putes , c’étaient les bordels tristes.
— Pourquoi vous l’avez fait alors ?
— Parce que je suis seul. C’est atroce d’être toujours seul.
— Je sais.
Silence.
— Saskia, comment tu t’es retrouvée à faire ça…
— C’est compliqué.
Gros opina. Il n’en doutait pas.
— Merci de m’avoir sauvée.
— N’en parlons plus.
— Vous m’avez sauvée, c’est important. Vous pouvez me faire ce que vous voulez… pour être moins seul… Pas besoin de payer, ce sera agréable comme ça.
— Je veux rien te faire…
— Je ne dirai rien. Nous sommes bien ici, non ? Je sais garder les secrets. À l’arrière des camions, je faisais tout ce qu’ils voulaient, et je n’ai jamais rien dit à personne. Certains voulaient que je crie fort, ou alors que je reste muette. Vous savez, lieutenant Gros, j’ai vu beaucoup de soldats, dans les rues, en armes, mais dans le camion, c’était différent : ces hommes, un instant auparavant, en uniformes, étaient des militaires puissants qui avaient conquis l’Europe… mais dans l’obscurité du camion, étendus contre moi, à haleter maladroitement, ils ne m’inspiraient plus que de la pitié, nus, maigres, blancs, apeurés. Certains voulaient même que je les gifle. Ça vous paraît pas bizarre, lieutenant, ces soldats qui ont pris l’Europe, qui paradent jusque devant le camion, fiers, jusqu’au moment d’entrer dedans, et qui se mettent tout nus et veulent être giflés par une pute ?
Silence.
— Demandez-moi ce que vous voulez, lieutenant Gros. Je ne dirai rien, ce sera agréable.
— Je ne veux rien, Saskia…
— Tout le monde veut quelque chose.
— Alors peut-être que tu pourrais me serrer, comme si tu étais ma mère.
— Je peux pas être votre mère, j’ai dix-sept ans…
— Dans le noir on verra rien.
Elle se cala dans la paille et Gros s’étendit contre elle, posant sa tête sur ses genoux. Elle lui caressa les cheveux.
— Ma mère chantait souvent pour que je m’endorme.
Saskia se mit à chanter.
— Serre-moi.
Elle le serra fort. Et elle sentit couler sur sa peau nue les larmes de l’officier. Elle pleura aussi. En silence. On avait voulu la tondre, comme un animal. Elle avait peur, elle ne savait plus qui elle était. Non, elle n’était pas une traîtresse ; sa sœur, d’ailleurs, était dans la Résistance, elle le lui avait dit un jour. Il y avait si longtemps qu’elle ne l’avait pas vue. Et ses parents, qu’étaient-ils devenus ? La Gestapo était venue dans leur maison, à Lyon ; après avoir arrêté sa sœur, ils voulaient toute la famille. Ils avaient emmené les parents, mais elle s’était cachée dans le fond d’une grande armoire ; ils n’avaient pas fouillé. Elle était restée ainsi plusieurs heures après le départ des Tractions noires, tremblante de peur. Puis elle s’était enfuie ; mais seule, dehors, elle n’avait pu survivre qu’en suivant une colonne de la Wehrmacht. Ça s’était passé une année auparavant, une année passée à l’arrière d’un camion bâché en échange de conserves et d’un peu de protection. Quatre saisons. L’été, les soldats étaient tous moites et sales, ils sentaient mauvais ; l’hiver, elle grelottait de froid, et aucun ne voulait la laisser faire ça sous une couverture, à cause des maladies. Elle avait aimé le printemps, elle avait écouté les oiseaux chanter depuis le plancher en métal du camion. Et puis la chaleur de l’été, à nouveau.
Dans l’obscurité de la grange, Gros et Saskia, l’officier des services secrets et la putain, s’endormaient, fatigués du monde.
Novembre était gris à Londres. Ils n’avaient eu aucune nouvelle de Gros. Stanislas disait qu’il finirait bien par revenir, que sa vie était ici désormais.
Dans le salon de Chelsea, Laura passait l’après-midi avec sa mère ; c’était un dimanche. La guerre était terminée pour la Section F, les agents étaient démobilisés par Baker Street.
— Qu’est-ce que tu vas faire à présent ? demanda France.
— M’occuper de Philippe. Et puis je vais terminer mes études.
La mère sourit ; sa fille avait parlé comme si la guerre, finalement, ce n’était pas si sérieux. Laura poursuivit :
— J’aimerais de nouveau réunir tout le monde en décembre, dans le manoir du Sussex. Comme l’année passée… Pour le souvenir. Tu crois que les gens voudront venir ?
— Bien sûr.
— Tu sais, depuis que nous sommes tous rentrés de France, ce n’est plus comme avant.
— Ne t’inquiète pas, ça le redeviendra. Laisse du temps au temps.
— Et Gros, sera-t-il enfin revenu ? Je m’inquiète pour lui, et je voudrais tant qu’il soit là !
— Sans doute. Ne t’inquiète pas… Tu as déjà assez de tracas.
— J’aimerais inviter le père de Pal aussi. Il ne sait même pas encore qu’il a un petit-fils… Je crois qu’il ne sait même pas que son fils est mort. Il est temps de le lui dire.
France acquiesça tristement et caressa les cheveux de sa fille.
Sur le trottoir bordant la maison, Richard promenait Philippe dans un landau.
*
Tous les jours, il priait. Il allait dans les églises, les matins et les soirs, il restait des heures sur les bancs durs et inconfortables, dans les rangées désertes et glaciales, suppliant de pouvoir tout oublier. Il voulait redevenir Claude le séminariste, au pire Claude le curé, le Claude de Wanborough Manor dont tout le monde pensait qu’il ne serait jamais capable de faire la guerre. Il voulait redevenir prêtre, s’enfermer dans les abbayes ; il voulait être trappiste, et ne plus jamais parler. Oui, que le Seigneur l’emmène dans les cloîtres du silence, qu’il le lave de ses péchés pour que l’attente de la mort ne soit pas trop insupportable ; oui, peut-être son âme pourrait-elle être sauvée, peut-être n’était-il pas encore complètement abîmé ; il était encore chaste. Il avait tué mais il était resté chaste.
Que le Seigneur l’enferme dans les montagnes ; il voulait disparaître, lui qui ne valait rien, lui qui n’avait su faire que le mal. Et ce qui le rongeait le plus désormais, c’était d’avoir blessé Gros, le seul Homme d’entre eux tous. Et il en connaissait le prix : celui qui blesse un Homme ne connaîtra plus d’avenir, il n’aura plus d’horizon ; celui qui blesse un Homme ne connaîtra jamais la rédemption. Souvent, Claude regrettait de ne pas être mort à la guerre ; il jalousait Aimé, Pal et Faron.
Читать дальше