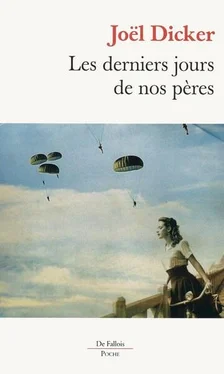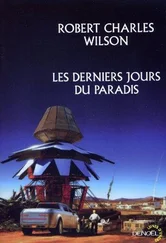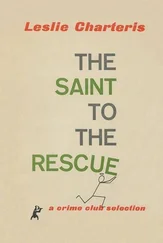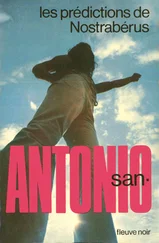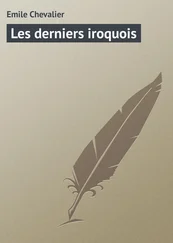Il se replongea aussitôt dans son assiette pour ne pas avoir à soutenir le regard de ses deux jeunes camarades.
— On a besoin de savoir, dit Faron. On a le droit de savoir un peu, merde ! Pourquoi est-ce qu’on est jamais au courant de rien ? Pourquoi est-ce qu’on doit se contenter d’aller effectuer des missions sans savoir rien des plans généraux ? On est quoi ? De la chair à canon ?
— Dis pas ça, Faron, protesta Stanislas.
— Mais c’est la vérité ! Alors quoi, t’as un fauteuil en cuir, tu t’assieds confortablement avec un verre de scotch et tu encercles au hasard des noms de ville sur les cartes pour y envoyer des gamins se faire tuer.
— Tais-toi, Faron ! hurla Stanislas, se dressant de sa chaise et pointant un doigt furieux dans sa direction. Tu ne sais rien ! Rien du tout ! Tu ne sais pas combien ça me ronge de vous savoir là-bas et moi ici ! Tu ne sais rien de ma souffrance ! Vous êtes comme des fils pour moi !
— Alors comporte-toi en père ! lui asséna Faron.
Il y eut un silence. Stanislas se rassit. Il tremblait de colère, contre lui, contre ces gamins auxquels il s’était attaché, contre cette maudite guerre. Il savait qu’ils repartiraient bientôt, il ne voulait pas se brouiller avec eux. Il fallait de bons souvenirs. Il se décida alors à leur dire un tout petit peu de ce qu’il savait. Rien de compromettant. Juste pour qu’ils voient en lui le père qu’il voulait être pour eux.
— Il y a eu une conférence à Québec, dit-il.
— Et ?
— Le reste n’est que des rumeurs.
— Des rumeurs ? répéta Faron.
— Des bruits de couloir.
— Je sais ce que signifie une rumeur. Mais de quoi parle-t-on ?
— Churchill aurait discuté avec Roosevelt. Ils auraient décidé d’amasser des hommes et des armes en Angleterre, en prévision de l’ouverture d’un front en France.
— Alors ils vont débarquer, dit Faron. Quand ? Où ?
— Là, tu m’en demandes trop, sourit Stanislas. Peut-être quelques mois. Peut-être au printemps. Qui sait…
Pal et Faron restèrent songeurs.
— Le printemps prochain, répéta Faron. Alors ils se décident enfin à rappliquer pour botter le cul des Allemands.
Pal regardait dans le vide. Il n’écoutait plus. Quelques mois. Mais combien ? Et comment allaient réagir les Allemands à l’ouverture d’un front en France ? À quelle vitesse se ferait la progression des armées alliées ? Les Russes avaient remporté la bataille de Koursk, ils allaient marcher sur Berlin. On s’attendait à une bataille terrible. Et qu’allait-il se passer lorsque les Alliés atteindraient Paris ? Y aurait-il un siège de la ville ? Peu à peu, ressassant les scénarios possibles, Pal fut envahi par une sourde crainte : le jour où les Alliés s’apprêteraient à reprendre la capitale, les Allemands feraient un carnage, ils ne se laisseraient pas prendre, ni eux, ni la capitale. Ils la détruiraient plutôt que de la perdre, ils la raseraient, ils la mettraient à feu et à sang. Qu’allait-il arriver à son père ? Qu’allait-il devenir si les Allemands infligeaient à Paris ce que les Alliés avaient fait subir à Hambourg ? Ce soir-là, en rentrant à Bloomsbury, Pal décida qu’il devait emmener son père loin de Paris.
*
Une dizaine de jours s’écoulèrent. Aucun des autres camarades du groupe ne rentra à Londres. C’était la mi-septembre. Stanislas était loin de se douter combien ses révélations occupaient les pensées de Faron et Pal. Faron était conforté dans ses projets ; faire tomber le Lutetia serait une opération majeure pour faciliter l’avancée des troupes alliées en France. Plus de coordination possible pour le Renseignement allemand. Croix de guerre assurée. Pal, lui, craignait pour son père. Il devait aller le chercher, le mettre à l’abri. Il devait faire en sorte qu’il ne lui arrive rien.
Les deux agents voulaient repartir au plus vite et converger vers Paris, mais pas pour les mêmes raisons. Pour leur plus grande satisfaction, la Section F ne tarda pas à décider de les renvoyer en mission car l’Europe était en ébullition. Faron était dirigé vers Paris, pour des bombardements. Pal, de nouveau dans le Sud. Il s’en fichait. Il n’irait pas dans le Sud. Il irait à Paris.
Ils passèrent quelques journées à Portman Square pour recevoir les consignes et les ordres. Le soir, ils se retrouvaient à Bloomsbury. Faron avait l’air impassible malgré le retour en France ; Pal s’efforçait de rester maître de lui-même. L’avant-dernière nuit avant les maisons de transit, Pal, frappé d’insomnie, se leva, errant dans l’appartement. Il découvrit Faron, assis à la table de la cuisine, en grande méditation : il lisait le livre d’anglais de Gros et mangeait ses biscuits devenus trop secs.
— J’ai été un sale type, hein ? demanda d’emblée Faron.
Pal fut un peu pris de court.
— Bah. On a tous nos moments de faiblesse…
Faron semblait préoccupé, plongé dans d’intenses réflexions.
— Alors ils vont débarquer, hein ? fit Pal.
— Faut pas en parler de ce débarquement.
Pal ne releva pas. Faron semblait troublé.
— T’as peur ? interrogea le fils.
— J’en sais rien.
— Quand je suis parti de France pour rejoindre le SOE, j’ai écrit un poème…
Comme Faron ne réagissait pas, Pal disparut dans sa chambre un instant et en revint avec un morceau de papier. Il le tendit à Faron, qui grogna ; il n’avait besoin ni de poésie ni de personne, mais il l’empocha tout de même.
Il y eut un long silence.
— Je vais passer par Paris, finit par dire Pal, qui savait que Faron y serait.
Le colosse leva la tête, soudain intéressé :
— Paris ? C’est ta mission ?
— Plus ou moins. Disons que je dois m’y rendre.
— Pourquoi donc ?
— Le secret, camarade. Le secret.
Pal avait volontairement révélé une partie de ses intentions à Faron : en cas de problème à Paris, il aurait certainement besoin de lui. Et Faron songea que Pal ne serait pas de trop pour son attentat sur le Lutetia. C’était un très bon agent. Aussi lui révéla-t-il sa planque.
— Retrouve-moi à Paris lorsque tu y seras. J’ai un appartement sûr. Quand viendras-tu ?
Pal haussa les épaules.
— Dans les jours qui suivront mon arrivée en France, j’imagine.
Faron lui donna l’adresse.
— Personne ne connaît cet endroit. Pas même Stanislas, si tu vois ce que je veux dire.
— Pourquoi ?
— Chacun ses secrets, camarade. Ne l’as-tu pas dit ?
Les deux hommes se sourirent. C’était la première fois depuis leur séjour à Londres qu’ils se souriaient. Peut-être la première fois depuis qu’ils se connaissaient.
Plus tard cette même nuit, alors que Pal s’était endormi, Faron se leva et s’enferma dans les toilettes. Il lut le poème de Pal. Et il éteignit la lumière parce qu’il sanglotait.
*
Le lendemain fut leur dernière journée à Londres. Ils avaient passé deux semaines en Angleterre. Pal annonça son départ à France Doyle, puis il passa l’après-midi avec Stanislas.
— Bon vent, lui dit sobrement Stanislas, lorsqu’ils se quittèrent.
— Salue bien les autres de ma part quand tu les verras.
Le vieux pilote promit.
— Surtout Laura… précisa encore Pal.
— Surtout Laura, répéta Stanislas avec douceur.
Pal regrettait tant de n’avoir pas retrouvé Laura. Il avait passé la majeure partie de sa permission à l’attendre à Bloomsbury, fidèlement, plein d’espoir, sursautant à chaque bruit. À présent, il était triste.
De retour à l’appartement, il trouva Faron, qui s’agitait, à moitié nu. Au bout d’un moment, celui-ci vint trouver Pal dans le salon.
Читать дальше