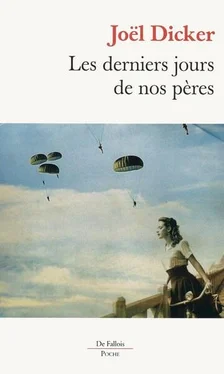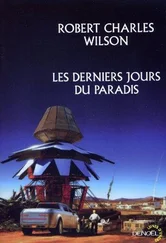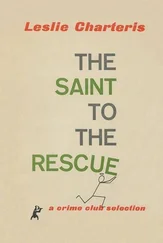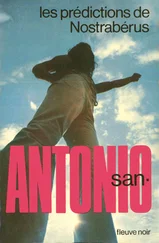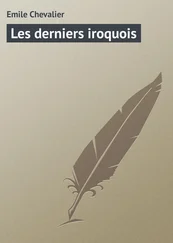S’ensuivit l’apprentissage du sabotage ferroviaire, qui permettait de ralentir les mouvements des troupes allemandes à travers la France. La compagnie ferroviaire West Highland Line, sur demande du gouvernement britannique, avait installé des rails et un train entier à Arisaig House, afin que les agents du SOE puissent être formés en conditions réelles. Les stagiaires apprirent à tordre les voies, à faire dérailler des wagons, à disposer des charges sur des rails, sous un pont, sur le train, de jour, de nuit, à choisir entre actionner eux-mêmes la charge au passage du convoi depuis les abords directs du lieu de l’attentat, ou utiliser, pour saboter voies ou dépôts, l’une des meilleures créations des stations expérimentales : The Clam , une bombe prête à l’emploi, fixée sur un aimant pour adhérer aux rails et dont la minuterie déclenchait l’explosion trente minutes après l’armement. Il existait une production variée d’objets piégés, tels que des pompes à vélo explosant au moment de leur utilisation ou des cigarettes remplies d’explosif, développés principalement par la station expérimentale XV, The Thatched Barn , située dans le Hertfordshire, mais leur efficacité laissait parfois à désirer. Sur le train d’entraînement, les stagiaires suivirent même un cours rudimentaire de pilotage de locomotive.
Décembre égrena ses journées, tourmentées et violentes. Il faisait de plus en plus sombre, comme si, bientôt, la nuit n’allait plus cesser. Les stagiaires continuaient à s’entraîner, et leurs progrès étaient fulgurants : il fallait les voir, avec leurs grenades et leurs explosifs ; il fallait les voir sur les parcours d’obstacles ; il fallait les voir, réparant les pannes sur leurs mitraillettes Sten. Il fallait voir Claude, qui demandait pardon à Dieu en changeant ses chargeurs ; Grenouille, qui, pour se donner du courage en franchissant des marais de boue glaciale, hurlait des flots d’injures ; Faron, colossal, qui pouvait battre à mains nues n’importe qui, s’il ne décidait pas plutôt de lui loger une balle exactement entre les deux yeux ; Frank, sec et vif, rapide comme la tempête. Il fallait voir Stanislas, Laura, Jos, Denis, les étrangers ; Aimé, Gros et Key, toujours prêts à plaisanter, même en plein exercice de commando. Lesquels d’entre eux, en quittant la France, auraient pu imaginer qu’ils se sentiraient si vite aptes à la guerre ? Car il faut le dire : ils se sentaient forts et capables, terriblement capables, de venir à bout de régiments entiers, et il leur sembla même qu’ils pourraient vaincre les Allemands. C’était insensé. Hier encore, ils étaient des enfants de France, assaillis et meurtris, et aujourd’hui déjà ils étaient un peuple nouveau, un peuple de combattants, dont l’avenir était entre leurs mains. Certes, ils avaient laissé derrière eux ce qu’ils avaient de plus cher, mais ils ne subissaient plus, ils feraient subir. Et, tout autour d’eux, la guerre prenait une ampleur démesurée, déchaînée et indomptable : en Europe, la Wehrmacht était aux portes de Moscou et, dans le Pacifique, Hong Kong était la cible d’une violente bataille déclenchée par les Japonais. Le 20 décembre, Denis lut à ses petits camarades un article racontant comment les Anglais, aidés des Canadiens, des Indiens et des forces volontaires de la défense de Victoria-Hong Kong, résistaient héroïquement depuis plusieurs jours à l’assaut des forces nippones.
*
Le 25 décembre, il y avait plus de trois semaines qu’ils étaient en Écosse. Slaz-le-porc, épuisé et malade de fatigue, fut écarté de la sélection : ils n’étaient plus que douze stagiaires au sein du groupe. L’épuisement, lentement, avait eu raison de leur moral ; les mines étaient mauvaises, lasses, préoccupées : à mesure que les jours d’entraînement défilaient, la guerre inexorablement se rapprochait. Lorsque Pal songeait à la France, il était envahi à la fois par un sentiment de confiance et de peur ; il savait ce dont son groupe était capable, ils avaient appris à tuer avec leurs mains, à égorger en silence, à mitrailler, à fusiller, à poser des bombes et à faire exploser des bâtiments, des trains, des convois de soldats. Mais à trop regarder ses camarades il se perdait dans leurs visages, doux, trop doux malgré les écorchures des combats, et il ne pouvait s’empêcher de penser qu’une grande partie d’entre eux allait mourir sur le terrain, ne serait-ce que pour donner raison au docteur Calland. Et Pal ne pouvait concevoir que Gros, entiché de ses filles, Claude le gentil pieux, Grenouille le faible, Stanislas et ses échecs, Key le grand charmeur, Laura l’Anglaise merveilleuse, et tous les autres n’auraient peut-être pas d’autre avenir que l’horizon de cette guerre. Cette seule pensée l’anéantissait : ils étaient prêts à donner leur vie, sous les balles ou la torture, pour que les Hommes restent des Hommes, et il ne savait plus si c’était un acte d’amour altruiste ou la plus grande imbécillité qui leur soit jamais venue à l’esprit ; savaient-ils seulement où ils allaient ?
Noël accentua leur désarroi.
Dans le mess, Gros récitait des menus imaginaires : « rôti de marcassin et coulis de groseille, perdreaux farcis, fromages et énormes gâteaux pour le dessert ». Mais personne ne voulait l’écouter.
— On s’en fout de tes menus, le houspilla Frank.
— On pourrait retourner pêcher, rétorqua Gros. Ce serait : darnes de saumon et sauce au vin.
— Il fait nuit, il fait froid. Arrête, merde !
Gros s’isola pour réciter ses menus tout seul. Si personne ne voulait bouffer, il boufferait dans sa tête, et il boufferait bien. Il se faufila dans son dortoir et, fouillant dans son lit, il en sortit un petit morceau de plastic qu’il avait volé. Il le huma, il aimait cette odeur d’amande ; il pensa à son rôti de marcassin, huma encore, et, salivant, les yeux clos, il lécha l’explosif.
Les stagiaires étaient irritables. Aimé, Denis, Jos et Laura jouaient aux cartes.
— Merde et merde, répétait Aimé en abattant des as.
— Pourquoi tu dis merde si t’as des as ? demanda Jos.
— Je dis merde si je veux. On peut donc rien faire ici ? Pas faire Noël, dire merde, rien de rien !
Dans les coins, les solitaires regardaient dans le vague en se passant la dernière des bouteilles d’alcool volées aux Polonais. Grenouille et Stanislas, eux, jouaient aux échecs et Grenouille laissait Stanislas gagner.
Key, assis dans une alcôve, surveillait discrètement le mess et les conversations, craignant que les esprits ne s’échauffent. Sans être le plus vieux du groupe, il était le plus charismatique et on le considérait tacitement comme le chef. S’il disait de la fermer, les stagiaires la fermaient.
— Les autres vont mal, chuchota Key à Pal, installé à ses côtés comme souvent.
Key et Pal s’appréciaient beaucoup.
— On pourrait aller trouver les Norvégiennes, proposa le fils.
Key eut une moue.
— J’en sais trop rien. Je crois pas que ça aidera. Ils vont encore se sentir obligés de faire les cons pour épater la galerie. Tu les connais…
Pal esquissa un sourire.
— Surtout Gros…
Key sourit à son tour.
— Où est-il celui-là, d’ailleurs ? demanda-t-il.
— À l’étage, répondit Pal, il boude. À cause de ses menus de Noël. Tu savais qu’il bouffait du plastic ? Il dit que c’est comme du chocolat.
Key leva les yeux au ciel, et les deux camarades pouffèrent.
À minuit, Claude fit une procession solitaire dans le manoir, tenant le grand crucifix qu’il avait emporté dans ses bagages. Il chanta une chanson d’espoir et défila parmi les malheureux. « Joyeux Noël ! » lança-t-il à la cantonade. Lorsqu’il passa à côté de Faron, celui-ci lui arracha le crucifix des mains et le brisa en deux, hurlant : « Mort à Dieu ! Mort à Dieu ! » Claude resta impassible et ramassa les deux morceaux sacrés. Key était prêt à bondir sur Faron.
Читать дальше