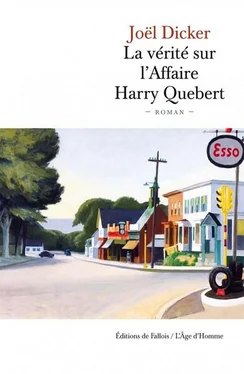— Qu’est-ce qui vous a pris, Marcus ?
— Je ne sais pas quoi vous dire, Harry.
— Ne dites rien. Regardez ce que vous avez fait. Pas besoin de mots.
— Harry, Je…
Il remarqua l’inscription sur le capot de ma Range Rover.
— Votre voiture n’a rien ?
— Non.
— Tant mieux. Parce que vous allez monter dedans et foutre le camp d’ici.
— Harry…
— Elle m’aimait, Marcus ! Elle m’aimait ! Et je l’aimais comme je n’ai plus jamais aimé ensuite. Pourquoi êtes-vous allé écrire ces horreurs, hein ? Vous savez quel est votre problème ? Vous n’avez jamais été aimé ! Jamais ! Vous voulez écrire des romans d’amour, mais l’amour vous n’y connaissez rien ! Je veux que vous partiez, maintenant. Au revoir.
— Je n’ai jamais décrit ni même imaginé Nola telle que la presse l’affirme. Ils ont volé le sens de mes mots, Harry !
— Mais qu’est-ce qui vous a pris de laisser Barnaski envoyer ce torchon à toute la presse nationale ?
— C’était un vol !
Il éclata d’un rire cynique.
— Un vol ? Ne me dites pas que vous êtes suffisamment naïf pour croire aux salades que Barnaski vous sert ! Je puis vous assurer qu’il a lui-même copié et envoyé vos foutues pages à travers tout le pays.
— Quoi ? Mais…
Il me coupa la parole.
— Marcus : je crois que j’aurais préféré ne jamais vous rencontrer. Partez maintenant. Vous êtes sur ma propriété et vous n’y êtes plus le bienvenu.
Il y eut un long silence. Les pompiers et les policiers nous regardaient. J’attrapai mon sac, je montai dans ma voiture et je partis. Je téléphonai immédiatement à Barnaski.
— Heureux de vous entendre, Goldman, me dit-il. Je viens d’apprendre pour la maison de Quebert. C’est sur toutes les chaînes info. Content de savoir que vous n’avez pas de mal. Je ne peux pas vous parler longtemps, j’ai un rendez-vous avec des dirigeants de la Warner Bros : des scénaristes sont déjà sur les rangs pour écrire un film sur l’Affaire à partir de vos premières pages. Ils sont enchantés. Je pense qu’on pourra leur vendre les droits pour une petite fortune.
Je l’interrompis :
— Il n’y aura pas de bouquin, Roy.
— Qu’est-ce que vous me racontez ?
— C’est vous, hein ? C’est vous qui avez envoyé mes feuillets à la presse ! Vous avez tout foutu en l’air !
— Vous faites la girouette, Goldman. Pire : vous faites la diva et ça ne me plaît pas du tout ! Vous faites votre grand spectacle de détective et soudain, pris d’une lubie, vous arrêtez tout. Vous savez quoi, je vais mettre ça sur le compte de votre nuit éprouvante et oublier ce coup de téléphone. Pas de livre, non mais… Pour qui vous prenez-vous, Goldman ?
— Pour un véritable écrivain. Écrire c’est être libre.
Il se força à rire.
— Qui vous a mis ces sornettes en tête ? Vous êtes esclave de votre carrière, de vos idées, de vos succès. Vous êtes esclave de votre condition. Écrire, c’est être dépendant. De ceux qui vous lisent, ou ne vous lisent pas. La liberté, c’est de la foutue connerie ! Personne n’est libre. J’ai une partie de votre liberté dans les mains, de même que les actionnaires de la compagnie ont une partie de la mienne dans les leurs. Ainsi est faite la vie, Goldman. Personne n’est libre. Si les gens étaient libres, ils seraient heureux. Connaissez-vous beaucoup de gens véritablement heureux ? (Comme je ne répondis rien, il poursuivit.) Vous savez, la liberté est un concept intéressant. J’ai connu un type qui était trader à Wall Street, le genre de golden boy plein aux as et à qui tout sourit. Un jour, il a voulu devenir un homme libre. Il a vu un reportage à la télévision sur l’Alaska et ça lui a fait une espèce de choc. Il a décidé qu’il serait désormais un chasseur, libre et heureux, et qu’il vivrait du bon air. Il a tout plaqué et il est parti dans le sud de l’Alaska, vers le Wrangler. Eh bien, figurez-vous que ce type, qui avait toujours tout réussi dans la vie, a également réussi ce pari-là : c’est devenu véritablement un homme libre. Pas d’attache, pas de famille, pas de maison : juste quelques chiens et une tente. C’était le seul homme vraiment libre que j’aie connu.
— C’était ?
— C’était. Le bougre a été très libre pendant trois mois, de juin à octobre. Et puis il a fini par mourir de froid l’hiver venu, après avoir bouffé tous ses chiens par désespoir. Personne n’est libre, Goldman, pas même les chasseurs d’Alaska. Et surtout pas en Amérique, où les bons Américains dépendent du système, les Inuits dépendent de l’aide du gouvernement et de l’alcool, et les Indiens sont libres mais parqués dans des zoos pour humains qu’on appelle réserves où ils sont condamnés à répéter leur pitoyable et sempiternelle danse de la pluie devant un parterre de touristes. Personne n’est libre, mon garçon. Nous sommes prisonniers des autres et de nous-mêmes.
Tandis que Barnaksi parlait, j’entendis soudain une sirène derrière moi : je venais d’être pris en chasse par un véhicule de police banalisé. Je raccrochai et me garai sur le bas-côté, pensant être arrêté pour utilisation d’un téléphone portable au volant. Mais de la voiture de police sortit le sergent Gahalowood. Il s’approcha de ma fenêtre et me dit :
— Ne me dites pas que vous rentrez à New York, l’écrivain.
— Qu’est-ce qui vous faire croire ça ?
— Disons que vous en prenez la route.
— J’ai roulé sans réfléchir.
— Hum. Instinct de survie ?
— Vous ne croyez pas si bien dire. Comment m’avez-vous trouvé ?
— Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, il y a votre nom inscrit en rouge sur le capot de votre voiture. Ce n’est pas le moment de rentrer chez vous, l’écrivain.
— La maison de Harry a brûlé.
— Je sais. C’est pour ça que je suis là. Vous ne pouvez pas rentrer à New York.
— Pourquoi ?
— Parce que vous êtes un type courageux. Que, de toute ma carrière, j’ai rarement vu pareille ténacité.
— Ils ont saccagé mon livre.
— Mais vous ne l’avez pas encore écrit ce bouquin : votre destin est entre vos mains ! Vous pouvez encore tout faire ! Vous avez le don de créer ! Alors mettez-vous au boulot et écrivez un chef-d’œuvre ! Vous êtes un battant, l’écrivain. Vous êtes un battant et vous avez un livre à écrire. Vous avez des choses à dire ! Et puis, si je peux me permettre, vous m’avez aussi mis dans la merde jusqu’au cou. Le procureur est sur la sellette, et moi avec. C’est moi qui lui ai dit qu’il fallait arrêter Harry rapidement. Je pensais que trente-trois ans après les faits, une arrestation surprise aurait raison de son aplomb. Je me suis planté comme un débutant. Et puis vous avez débarqué, avec vos chaussures vernies qui valent un mois de mon salaire. Je ne vais pas vous faire une scène d’amour ici sur le bord de la route, mais… Ne partez pas. Il faut qu’on boucle cette enquête.
— Je n’ai plus d’endroit où dormir. La maison a brûlé…
— Vous venez de vous mettre un million de dollars dans la poche. C’est écrit dans le journal. Allez vous prendre une suite dans un hôtel de Concord. Je mettrai mes déjeuners sur votre note. Je meurs de faim. En route, l’écrivain. Nous avons du pain sur la planche.
*
Durant toute la semaine qui suivit, je ne remis plus les pieds à Aurora. Je m’étais installé dans une suite du Regent’s, au centre de Concord, dans laquelle je passai mes journées à me pencher à la fois sur l’enquête et sur mon livre. Je n’eus de nouvelles de Harry que par l’intermédiaire de Roth, qui m’apprit qu’il s’était installé dans la chambre 8 du Sea Side Motel. Roth me dit que Harry ne souhaitait plus me voir parce que j’avais sali le nom de Nola. Puis il ajouta :
Читать дальше