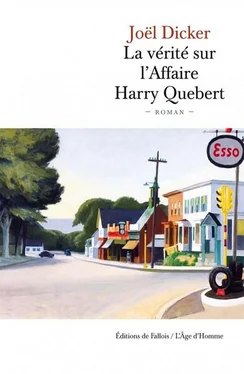Elle essuya ses joues. Stern dévisagea ce bout de femme plein de douceur qu’il forçait à poser nue. Il aurait voulu la prendre dans ses bras pour la réconforter, mais il ne devait pas laisser ses sentiments prendre le pas.
— C’est mon prix, dit-il sèchement. Tu poses nue, et Quebert garde la maison.
Elle acquiesça.
— Je le ferai, Monsieur Stern. Je ferai tout ce que vous voulez. Désormais, je suis à vous.
*
Trente-trois ans après cette scène, hanté par le remords et comme s’il demandait l’expiation, Stern avait emmené Gahalowood sur la terrasse de sa maison, là même où il avait exigé de Nola qu’elle se mette nue à la demande de son chauffeur, si elle voulait que l’amour de sa vie puisse rester en ville.
— Voilà, avait-il dit, voilà comment Nola est entrée dans ma vie. Le lendemain de sa venue, j’ai essayé de contacter Quebert pour lui dire qu’il pouvait rester à Goose Cove, mais impossible de le joindre. Pendant une semaine, il a été introuvable. J’ai même envoyé Luther faire le pied de grue devant chez lui. Il a finalement réussi à le rattraper alors qu’il s’apprêtait à quitter Aurora.
Gahalowood avait ensuite demandé :
— Mais cette requête de Nola ne vous a pas semblé étrange ? Ni le fait que cette gamine de quinze ans vive une relation avec un homme de plus de trente ans et vienne vous demander une faveur pour lui ?
— Vous savez, sergent, elle parlait si bien de l’amour… Si bien que moi-même je ne pourrais jamais utiliser ses mots. Et puis, moi, j’aimais les hommes. Vous savez comment on percevait l’homosexualité à l’époque ? Encore maintenant d’ailleurs… La preuve, je m’en cache toujours. Au point que lorsque ce Goldman raconte que je suis un vieux sadique et sous-entend que j’ai abusé de Nola, je n’ose rien dire. J’envoie mes avocats au front, j’intente des procès, j’essaie de faire interdire le livre. Il suffirait que je dise à l’Amérique que je suis de l’autre bord. Mais nos concitoyens sont encore très prudes et j’ai une réputation à protéger.
Gahalowood avait recentré la conversation.
— Votre arrangement avec Nola, comment cela se passait ?
— Luther s’occupait d’aller la chercher à Aurora. Je disais que je ne voulais rien savoir de tout ça. J’exigeais qu’il prenne sa voiture personnelle, une Mustang bleue, et non pas la Lincoln noire de service. Aussitôt que je le voyais partir pour Aurora, je renvoyais tous les employés de maison. Je voulais que personne ne soit là. J’avais trop honte. De même que je ne voulais pas que cela se passe dans la véranda qui servait d’atelier à Luther habituellement : j’avais trop peur que quelqu’un le surprenne. Alors il installait Nola dans un petit salon jouxtant mon bureau. Je venais la saluer à son arrivée et lorsqu’elle repartait. C’était ma condition pour Luther : je voulais m’assurer que tout se passait bien. Ou disons pas trop mal. Je me souviens que la première fois, elle était sur un canapé recouvert d’un drap blanc. Elle était déjà nue, tremblante, mal à l’aise, effrayée. Je lui avais serré la main et elle était glacée. Je ne restais jamais dans la pièce, mais j’étais toujours à proximité, pour m’assurer qu’il ne lui faisait aucun mal. J’ai même, par la suite, caché un interphone dans la pièce. Je le mettais en marche, et je pouvais ainsi écouter ce qui se passait.
— Et ?
— Rien. Luther ne prononçait pas un mot. C’était un taiseux de nature, à cause de ses mâchoires brisées. Il la peignait. C’est tout.
— Il ne l’a pas touchée, alors ?
— Jamais ! Je vous le dis, je ne l’aurais pas toléré.
— Combien de fois Nola est-elle venue ?
— Je ne sais pas. Une dizaine peut-être.
— Et combien de tableaux a-t-il peint ?
— Un seul.
— Celui que nous avons saisi ?
— Oui.
C’était donc uniquement grâce à Nola que Harry avait pu rester à Aurora. Mais pourquoi Luther Caleb avait-il ressenti le besoin de la peindre ? Et pourquoi Stern, qui, d’après ce qu’il disait, était prêt à laisser Harry disposer de la maison sans contrepartie, avait-il soudain accédé à la requête de Caleb et contraint Nola à poser nue ? C’étaient des questions auxquelles Gahalowood n’avait pas de réponse.
— Je lui ai demandé, m’expliqua-t-il. Je lui ai dit : « Monsieur Stern, il y a un détail que je ne saisis toujours pas : pourquoi Luther voulait-il peindre Nola ? Vous disiez tout à l’heure que cela lui permettait de prendre son pied : vous voulez dire que cela lui procurait du plaisir sexuel ? Vous avez fait mention d’une Eleanore également, s’agit-il de son ancienne petite amie ? » Mais il a clos le sujet. Il a dit que c’était une histoire compliquée et que je savais ce que j’avais besoin de savoir, que le reste appartenait au passé. Et il a levé l’entretien. J’étais là officieusement, je ne pouvais pas l’obliger à répondre.
— Jenny nous a raconté que Luther voulait la peindre, elle aussi, rappelai-je à Gahalowood.
— Alors ce serait quoi ? Une espèce de maniaque au pinceau ?
— Je n’en sais rien, sergent. Vous pensez que Stern a accédé à la requête de Caleb parce qu’il était attiré par lui ?
— L’hypothèse m’a traversé l’esprit et j’ai posé la question à Stern. Je lui ai demandé si entre lui et Caleb il y avait quelque chose. Il a répondu très calmement que pas du tout. « Je suis le très fidèle compagnon de Monsieur Sylford depuis le début des années 1970, m’a-t-il dit. Je n’ai jamais rien ressenti pour Luther Caleb si ce n’est de la pitié, raison pour laquelle je l’ai engagé. C’était un pauvre zonard de Portland, il avait été gravement défiguré et handicapé après un violent passage à tabac. Une vie foutue sans raison. Il s’y connaissait en mécanique et j’avais justement besoin de quelqu’un pour s’occuper de mon parc de voitures et me servir de chauffeur. Rapidement, nous avons tissé des liens amicaux. C’était un chouette type, vous savez. Je peux dire que nous avons été amis. » Vous voyez, l’écrivain, ce qui me taraude, c’est justement ces liens dont il parle et qu’il décrit comme amicaux. Mais j’ai l’impression qu’il y a plus que ça. Et ce n’est pas sexuel non plus : je suis certain que Stern ne nous ment pas lorsqu’il dit qu’il n’avait pas d’attirance pour Caleb. Non, ce seraient des liens plus… malsains. C’est l’impression que j’ai eue lorsque Stern m’a décrit la scène où il accède à la requête de Caleb et demande à Nola de poser nue. Ça lui donnait envie de vomir, et pourtant il le fait quand même, comme si Caleb avait une espèce de pouvoir sur lui. D’ailleurs, ça n’a pas échappé à Sylford non plus. Il n’avait pas pipé mot jusque-là, il s’était contenté d’écouter, mais lorsque Stern a raconté l’épisode de la petite, terrifiée et toute nue, qu’il venait saluer avant les séances de peinture, il a fini par dire : « Mais Eli’, comment ? Comment ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Pourquoi tu ne m’as jamais rien dit ? »
— Et à propos de la disparition de Luther ? demandai-je. En avez-vous parlé à Stern ?
— Du calme, l’écrivain, j’ai gardé le meilleur pour la fin. Sylford, sans le vouloir, lui a mis la pression. Il était chamboulé et il en a perdu ses réflexes d’avocat. Il s’est mis à beugler : « Mais Eli’, enfin, explique-toi ! Pourquoi ne m’as-tu jamais rien dit ? Pourquoi as-tu gardé le silence pendant toutes ces années ? » Le Eli’ en question n’en menait pas large, comme vous pouvez vous en douter, et il a rétorqué : « J’ai gardé le silence, j’ai gardé le silence mais je n’ai pas oublié ! J’ai conservé ce tableau pendant trente-trois ans ! Tous les jours, j’allais dans l’atelier, je m’asseyais sur le canapé et je la regardais. Je devais soutenir son regard, sa présence. Elle me fixait, avec ce regard de fantôme ! C’était ma punition ! »
Читать дальше