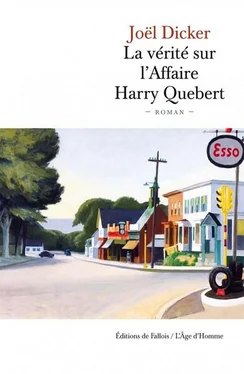Je crois que Douglas subissait beaucoup de pression de la part de Barnaski et qu’il essayait de m’en protéger : Barnaski craignait que je ne parvienne pas à tenir les délais sans aide extérieure. Il m’avait déjà téléphoné à plusieurs reprises pour me le dire de vive voix.
— Il faut que vous preniez des écrivains fantômes pour rédiger ce bouquin, m’avait-il dit, vous n’y arriverez jamais sinon. J’ai des équipes qui sont là pour ça, vous donnez les grandes lignes et ils écrivent à votre place.
— Jamais de la vie, avais-je répondu. C’est ma responsabilité d’écrire ce livre. Personne ne le fera à ma place.
— Oh, Goldman, vous êtes insupportable avec votre morale et vos bons sentiments. Tout le monde fait écrire ses livres par quelqu’un d’autre aujourd’hui. Untel, par exemple, il ne refuse jamais mes équipes.
— Untel n’écrit pas lui-même ses livres ?
Il avait eu ce stupide ricanement caractéristique.
— Mais bien sûr que non ! Comment diable voulez-vous qu’il puisse tenir le rythme ? Les lecteurs ne veulent pas savoir comment Untel écrit ses livres, ou même qui les écrit. Tout ce qu’ils veulent, c’est avoir, chaque année, au début de l’été, un nouveau livre d’ Untel pour leurs vacances. Et nous le leur donnons. Ça s’appelle avoir le sens du commerce.
— Ça s’appelle tromper le public, dis-je.
— Tromper le public… Tsss, Goldman, vous êtes décidément un grand tragédien.
Je lui avais fait comprendre qu’il était hors de question que quelqu’un d’autre que moi écrive ce livre : il avait perdu patience et il était devenu grossier.
— Goldman, il me semble que je vous ai versé un million de dollars pour ce foutu bouquin : j’aimerais donc que vous vous montriez un plus coopératif. Si je pense que vous avez besoin de mes écrivains, alors on va les utiliser, bordel de merde !
— Du calme, Roy, vous aurez le livre dans les délais. À condition que vous cessiez de m’interrompre dans mon travail en me téléphonant sans cesse.
Barnaski était alors devenu épouvantablement grossier :
— Goldman, sacré nom de Dieu, j’espère que vous êtes conscient qu’avec ce livre, j’ai mes couilles sur la table. Mes couilles ! Sur la table ! J’ai investi énormément de pognon et je joue la crédibilité d’une des plus grosses maisons d’édition du pays. Alors si ça se passe mal, s’il n’y a pas de bouquin à cause de vos caprices ou de je ne sais quelle autre merde et que je devais couler à pic, sachez que je vous entraînerais avec moi ! Et bien profond !
— J’en prends note, Roy. J’en prends bonne note.
Barnaski, en dehors de ses travers humains, avait un talent inné pour le marketing : mon livre était d’ores et déjà le livre de l’année alors que sa promotion, à coups de publicités géantes sur les murs de New York, ne faisait que débuter. Peu après l’incendie de la maison de Goose Cove, il avait fait une déclaration retentissante. Il avait dit : « Il y a, quelque part, caché en Amérique, un écrivain qui s’efforce de rétablir la vérité à propos de ce qui s’est passé en 1975, à Aurora. Et parce que la vérité dérange, il y a quelqu’un qui est prêt à tout pour le faire taire. » Le lendemain, un article du New York Times titrait : Qui veut la peau de Marcus Goldman ? Ma mère l’avait évidemment lu et m’avait aussitôt téléphoné :
— Pour l’amour du Ciel, Markie, où te trouves-tu ?
— À Concord, au Regent’s. Suite 208.
— Mais tais-toi ! s’était-elle écriée. Je ne veux pas le savoir !
— Enfin, Maman. C’est toi qui…
— Si tu me le dis, je ne pourrai pas m’empêcher de le dire au boucher, qui le dira à son commis, qui le répétera à sa mère, qui n’est autre que la cousine du concierge du lycée de Felton et qui ne pourra pas s’empêcher de le lui dire, et ce diable ira le raconter au proviseur qui en parlera dans la salle des maîtres, et bientôt tout Newark saura que mon fils est dans la suite 208, au Regent’s de Concord, et celui-qui-veut-ta-peau viendra t’égorger dans ton sommeil. Pourquoi une suite d’ailleurs ? As-tu une petite amie ? Vas-tu te marier ?
Elle avait alors appelé mon père, je l’avais entendue crier : « Nelson, Viens écouter le téléphone ! Markie va se marier ! »
— Maman, je ne vais pas me marier. Je suis tout seul dans ma suite.
Gahalowood, qui était dans ma chambre où il venait de se faire servir un copieux petit déjeuner, n’avait rien trouvé de mieux à faire que de s’écrier : « Hé ! Moi je suis là ! »
— Qui est-ce ? avait aussitôt demandé ma mère.
— Personne.
— Ne dis pas personne ! J’ai entendu une voix d’homme. Marcus, je vais te poser une question médicale extrêmement importante, et il faudra que tu sois honnête avec celle qui t’a porté dans son ventre pendant neuf mois : y a-t-il un homme homosexuel secrètement caché dans ta chambre ?
— Non, Maman. Il y a le sergent Gahalowood, qui est policier. Il enquête avec moi et il se charge également de faire exploser ma note de service d’étage.
— Est-il nu ?
— Quoi ? Mais bien sûr que non ! C’est un policier, Maman ! Nous travaillons ensemble.
— Un policier… Tu sais, je ne suis pas née de la dernière pluie : il y a cette chose musicale, des hommes qui chantent ensemble, il y a un motard tout en cuir, un plombier, un Indien et un policier…
— Maman, lui, c’est un véritable officier de police.
— Markie, au nom de nos ancêtres qui ont fui les pogroms et si tu aimes ta gentille Mama, chasse cet homme nu de ta chambre.
— Je ne vais chasser personne, Maman.
— Oh, Markie, pourquoi me téléphones-tu, si c’est pour me faire de la peine ?
— C’est toi qui m’appelles, Maman.
— C’est parce que ton père et moi nous avons peur de ce criminel fou qui te poursuit.
— Personne ne me poursuit. La presse exagère.
— Je regarde tous les matins et tous les soirs dans la boîte aux lettres.
— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Pourquoi ? Il me demande pourquoi ? Mais à cause d’une bombe !
— Je ne pense pas que quelqu’un va mettre une bombe chez vous, Maman.
— Nous mourrons d’une bombe ! Et sans jamais avoir connu la joie d’être grands-parents. Voilà, es-tu content de toi ? Figure-toi que l’autre jour, ton père a été suivi par une grosse voiture noire jusque devant la maison. Papa s’est précipité à l’intérieur et la voiture est allée se garer dans la rue, juste à côté.
— Avez-vous appelé la police ?
— Évidemment. Deux voitures sont arrivées, sirènes hurlantes.
— Et ?
— C’était les voisins. Ces diables ont acheté une nouvelle voiture ! Sans même nous prévenir. Une nouvelle voiture, tsss ! Alors que tout le monde dit qu’il va y avoir une immense crise économique, eux, ils achètent une nouvelle voiture ! C’est pas suspect, ça ? Je pense que le mari trempe dans le trafic de drogue ou quelque chose comme ça.
— Maman, qu’est-ce que tu racontes comme idioties ?
— Je sais ce que je dis ! Et ne parle pas comme ça à ta pauvre mère qui risque de mourir d’une minute à l’autre d’un attentat à la bombe ! Où en est ton livre ?
— Il avance très bien. Je dois l’avoir terminé dans quatre semaines.
— Et comment finit-il ? C’est peut-être celui qui a tué la petite qui veut te tuer.
— C’est mon seul problème : je ne sais toujours pas comment le livre se termine.
L’après-midi du lundi 21 juillet, Gahalowood débarqua dans ma suite alors que j’étais en train d’écrire le chapitre où Nola et Harry décident de partir ensemble pour le Canada. Il était dans un état d’excitation avancé, et commença par se servir une bière dans le mini-bar.
Читать дальше