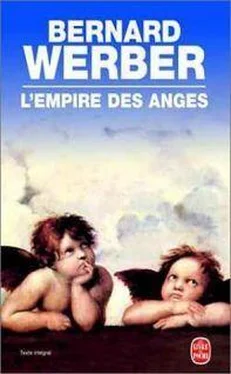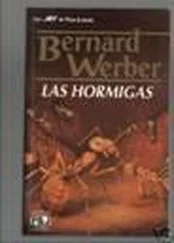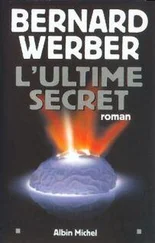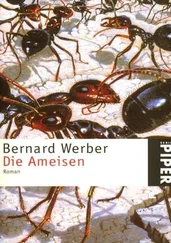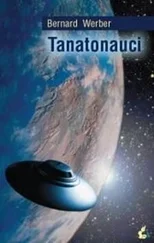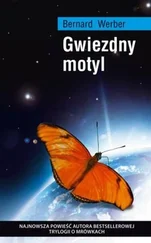SOLLICITATION PARADOXALE: Alors qu'il avait sept ans, le petit Ericsson regardait son père qui essayait de faire rentrer un veau dans une étable. Le père tirait fort sur la corde, mais le veau se cabrait et refusait d'avancer. Le petit Ericsson éclata de rire et se moqua de son père. Le père lui dit: «Fais mieux, si tu te crois si malin.»
Alors le petit Ericsson eut l'idée, au lieu de tirer sur la corde, de faire le tour du veau et de tirer sur sa queue. Aussitôt, par réaction, le veau poussa en avant et entra dans l'étable. Quarante ans plus tard, cet enfant inventait l'«hypnose ericssonnien-ne», une manière d'utiliser la sollicitation douce, et la sollicitation paradoxale pour amener les patients à mieux se porter. De même, on peut vérifier quand on est parent que si son enfant tient sa chambre désordonnée et qu'on lui demande de la ranger, il refusera. Par contre, si on augmente le désordre en apportant plus de jouets et de vêtements et si on les jette n'importe où, au bout d'un moment l'enfant dira: «Arrête papa, ce n'est plus supportable, il faut ranger.»
Tirer dans la mauvaise direction s'avère par moments plus efficace que tirer dans la bonne car cela déclenche un sursaut de conscience.
Si on regarde l'histoire, «la sollicitation paradoxale» est utilisée consciemment ou inconsciemment en permanence.
Il a fallu les deux guerres mondiales et des millions de morts pour inventer la SDN puis l'ONU. Il a fallu les excès des tyrans pour inventer les Droits de l'homme. Il a fallu Tchernobyl pour prendre conscience des dangers des centrales atomiques mal sécurisées.
Edmond Wells, Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu , tome IV.
153. JACQUES. 22 ANS ET DEMI
Le grand jour est arrivé. Le livre Les Rats est sorti de l'imprimerie. Demain les gens pourront le trouver en librairie. Tout est donc accompli. Je tiens l'objet dans mes mains. Je le caresse. Je le flaire. C'est donc pour ça que je me suis battu si longtemps. Quel choc! Il est là. Comme un enfant né d'une gestation de plusieurs années.
Les Rats .
La première euphorie passée, je ressens une angoisse intense. Ce livre en moi me remplissait et maintenant, je suis vidé. J'ai réalisé ce pour quoi j'étais venu sur terre. Tout est fini. Partir au moment culminant de la réussite et avant la redescente inévitable, c'est ce qu'il y aurait de mieux.
Ma vie n'a plus de sens. Je n'ai plus qu'à mourir. Il faut que je me tue maintenant et ma vie n'aura été que pur bonheur. Me suicider, donc. Mais comment s'y prend-on? Comme d'habitude, je suis dépassé par les problèmes pratiques.
Comment se procurer le revolver pour me tirer une balle? Je n'ai pas envie de sauter dans un fleuve pour m'y noyer, l'eau me semble glacée. Je n'ose pas sauter du haut d'un immeuble, ça me donne le vertige. Prendre des médicaments? Lesquels d'abord? Et je suis sûr qu'avec ma veine, je les vomirais tous. Reste le métro, mais je n'ai pas le courage de me jeter sous une rame.
En plus, j'ai lu ça quelque part, quatre suicides sur cinq sont manques. Ceux qui se tirent une balle dans la bouche s'arrachent simplement la mâchoire inférieure et finissent défigurés. Ceux qui sautent du sixième étage se brisent la colonne vertébrale et finissent estropiés dans un fauteuil roulant. Ceux qui absorbent des médicaments s'abîment le système digestif et finissent avec des brûlures stomacales incurables.
Je décide de me pendre. C'est ce qui me fait à la fois le plus peur et m'attire pour des raisons inconscientes. Je sais que je suis fait pour mourir comme ça.
Je verrouille la porte, je tire les rideaux, je confie le chat (pas du tout agité) à la voisine, je m'enferme dans les toilettes et j'accroche une cravate à la lampe.
C'est dans les W-C que, toute ma vie, je me suis senti le mieux. Il me semble normal que j'y meure. Je grimpe sur un tabouret, compte jusqu'à trois et le renverse. Me voilà suspendu au-dessus du sol.
Le nœud serre plus fort. J'étouffe. Ce n'est pas le moment d'être douillet, mais je suis pourtant obligé de constater que cela m'agace d'être pendu comme ça dans un inconfort total à attendre la mort.
Une araignée, dissimulée depuis longtemps dans l'encoignure supérieure droite des W-C, m'escalade. Elle a l'air contente de disposer de ce nouveau promontoire formé par mon corps suspendu. Elle entreprend de tisser une toile entre mon oreille et un bout de lambris. Chaque fois qu'elle repasse près de mon lobe, ça me chatouille.
C'est plus long que je ne croyais. J'aurais dû sauter d'un coup pour provoquer un choc brusque dans mes vertèbres cervicales.
L'air se raréfie. J'ai la tête qui bourdonne. J'essaie vainement de tousser pour dégager la pression sur ma gorge. Ça serre vraiment trop fort. Je repense à ma vie. Le livre, les rats, les chats, Gwendoline, Martine, Mlle Van Lysebeth, mon éditeur Charbonnier… C'était quand même plutôt un bon film.
En ai-je réellement connu tous les épisodes? Zut, j'ai peut-être d'autres femmes à aimer, d'autres livres à écrire et d'autres chats à caresser sur cette planète. L'araignée me le confirme en s'installant dans mon oreille pour y générer un bourdonnement très désagréable.
C'est sûrement mon indécision congénitale, mais je n'ai plus du tout envie de mourir. Je me contorsionne et tente de défaire le nœud. Je m'y prends un peu tard, et pourtant, coup de chance, en bricoleur maladroit, j'avais mal fixé la lampe. La vis lâche. Je tombe. La lampe suit, s'abat sur le coin de mon crâne et une bosse enfle.
Aïe.
Voilà, je suis toujours vivant. Cette expérience me vaccine définitivement contre le suicide. D'abord, ça fait très mal. Ensuite, je me dis que se suicider constitue la pire des ingratitudes. Se suicider, c'est se reconnaître incapable d'assumer le cadeau de la vie.
Et puis, je me sens responsable par rapport à mon livre. Il est publié, il faut le défendre, le présenter, l'expliquer.
A ma première interview, un journaliste me prend pour un spécialiste en rats qui a rédigé un ouvrage de vulgarisation. Je suis invité à de rares émissions de radio ou de télévision où mes interlocuteurs sont rarement allés plus loin dans la lecture que la quatrième de couverture. On me demande de résumer mon histoire. On me reproche la facture du dessin sur la jaquette. Comme si c'était moi qui avais choisi… Les quelques articles qui parlent réellement de mon livre ne paraissent pas en rubrique littéraire mais dans la section «animaux» ou «science». Un journaliste n'hésite pas écrire que je suis un vieux scientifique américain.
Aucun chroniqueur ne perçoit mon intention première: je parle d'humains à travers le comportement d'animaux en société. Je suis exaspéré. Les rares fois où l'on me donne la parole, les questions ne me permettent pas de m'expliquer. On me demande: «Quelle est l'espérance de vie d'un rat?» «Combien de petits dans une portée?» Ou encore: «Comment s'en débarrasser avec efficacité?»
J'aurais tant aimé débattre au moins une fois avec des philosophes, des sociologues, des politiciens, parler des grilles de rôles préétablis, des difficultés à sortir des rapports exploiteurs-exploités-autonomes-souffre-douleur. Mais le seul interlocuteur qu'une radio me propose pour une discussion est un spécialiste en «rati-cides» qui énumère, complaisant, tout l'arsenal de produits chimiques dont l'homme dispose pour les éliminer! Difficile d'élever le débat. Il n'y a plus qu'à espérer dans les miracles du bouche-à-oreille. Je ne peux plus rien faire pour ce livre. Ma tâche est finie. Il me faut me vider la tête. Comment? La télé! Les informations.
Читать дальше