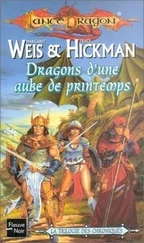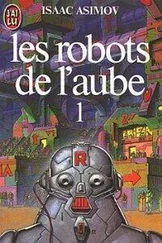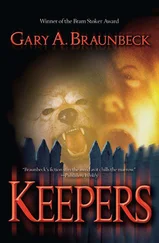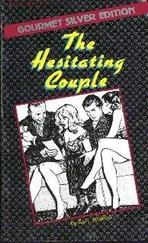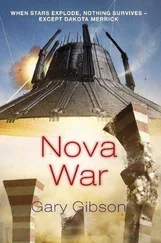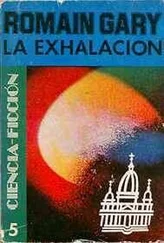Mais la plus vieille civilisation du monde, avec sa compréhension souriante de la nature humaine et de ses faillibilités, avec son sens du compromis et des arrangements, vint à mon secours. La Méditerranée vivait depuis trop longtemps avec le soleil pour le traiter en ennemi et elle pencha sur moi son visage aux mille pardons.
Le lycée de Nice n'était pas le seul établissement éducatif qui s'élevât alors entre la place Masséna et l'esplanade du Paillon. Mes camarades et moi trouvâmes, rue Saint-Michel, un accueil simple et amical, tout au moins, lorsque l'escadre américaine ne faisait pas escale à Villefranche, jours néfastes entre tous, où la consternation régnait dans les classes, et où le tableau noir devenait un véritable drapeau de notre mélancolie.
Mais avec deux ou trois francs d'argent de poche par jour, il est difficile de fréquenter, comme on dit dans le Midi.
Des choses étranges commencèrent donc à se produire à la maison. Un tapis disparut, puis un autre et, un jour, en revenant du casino municipal où l'on donnait Madame Butterfly, ma mère fut stupéfaite de constater que le petit trumeau qu'elle avait acquis la veille chez un brocanteur, dans l'intention de le revendre à profit, s'était littéralement évanoui dans les airs, toutes portes et fenêtres fermées. Un étonnement sans borne se dessina sur sa figure. Elle soumit l'appartement à un examen détaillé pour voir si rien d'autre ne manquait. Il se trouvait que si: mon appareil photographique, ma raquette de tennis, ma montre, mon pardessus d'hiver, ma collection de timbres-poste et les œuvres de Balzac que je venais de recevoir pour mon premier prix de français, avaient suivi le même chemin. J'avais même réussi à vendre le fameux samovar, que j'avais placé chez un antiquaire du vieux Nice, pour une somme sans doute dérisoire, mais qui m'avait tout de même tiré momentanément d'embarras. Ma mère réfléchit un moment, puis s'assit dans un fauteuil et me regarda. Elle me regarda longuement, avec attention et puis, à ma très grande surprise, au lieu de la scène dramatique que j'attendais, je vis une expression de triomphe presque solennel et de fierté se répandre sur son visage. Elle renifla bruyamment, avec une immense satisfaction, et me regarda encore une fois avec gratitude, admiration et attendrissement: j'étais enfin devenu un homme. Elle n'avait pas lutté en vain.
Ce soir-là, elle écrivit une longue lettre de sa grande écriture nerveuse, toujours avec le même air de triomphe et de satisfaction, comme si elle eût hâte d'annoncer que j'avais été un bon fils. Un mandat personnel de cinquante francs me parvint peu après et j'en reçus plusieurs autres, au cours de l'année. J'étais provisoirement sauvé. Par contre, je fus invité à me rendre chez un vieux docteur de la rue de France, lequel, après avoir longuement tourné autour du pot, m'expliqua que la vie d'un jeune homme était pleine d'embûches, que notre vulnérabilité était grande, que les flèches empoisonnées sifflaient à nos oreilles, et que nos ancêtres les Gaulois eux-mêmes n'allaient jamais au combat sans leurs boucliers. Après quoi, il me remit un petit paquet. J'écoutai poliment, comme il se doit avec un ancien. Mais la visite au Panopticum de Wilno m'avait éclairé à cet égard définitivement et j'étais depuis longtemps résolu à conserver mon nez intact. J'aurais pu lui dire aussi qu'il sous-estimait gravement l'honorabilité et les scrupules des braves âmes que nous fréquentions. La plupart d'entre elles étaient elles-mêmes des mères dévouées et jamais, au grand jamais, il ne nous était permis de nous risquer dans le sillage de toutes les marines du monde sans être initiés aux règles de prudence nécessaires à tout navigateur respectueux des éléments.
Chère Méditerranée! Que ta sagesse latine, si douce à la vie, me fut donc clémente et amicale, et avec quelle indulgence ton vieux regard amusé s'est posé sur mon front d'adolescent! Je reviens toujours à ton bord, avec les barques qui ramènent le couchant dans leurs filets. J'ai été heureux sur ces galets.
Notre vie prenait tournure. Je me souviens même qu'un certain mois d'août ma mère partit se reposer trois jours à la montagne. Je l'accompagnai à l'autocar, un bouquet à la main. Les adieux furent déchirants. C'était la première fois que nous nous séparions, et ma mère pleurait, pressentant nos séparations futures. Le chauffeur de l'autocar, après avoir observé longuement la scène des adieux, finit par me demander, avec cet accent niçois qui va si bien avec l'émotion:
– C'est pour longteing?
– Pour trois jours, répondis-je. Il parut très impressionné et nous contempla, ma mère et moi, avec estime. Puis il dit:
– Eh bieng, on peut dire que vous avez du seintimeing!
Ma mère revint de ses vacances débordant de projets et d'énergie. Les affaires reprenaient, à Nice, et cette fois, c'est en compagnie d'un authentique Grand-Duc russe qu'elle allait présenter ses «bijoux de famille» aux honorables étrangers. Le Grand-Duc était un débutant dans le métier et ma mère perdait beaucoup de temps à lui remonter le moral. Nice comptait alors encore près de dix mille familles russes, un noble assortiment de généraux, de cosaques, d'atamans ukrainiens, de colonels de la garde impériale, princes, comtes, barons baltes et ci-devant de tout poil- ils réussissaient à recréer au bord de la Méditerranée une atmosphère à la Dostoïevski, le génie en moins. Pendant la guerre, ils se scindèrent en deux, une partie fut favorable aux Allemands et servit dans la Gestapo, l'autre prenant une part active à la Résistance. Les premiers furent liquidés à la Libération, les autres s'assimilèrent complètement et disparurent à tout jamais dans la masse fraternelle des quatre-chevaux Renault, des congés payés, des cafés-crème et de l'abstention aux élections.
Ma mère traitait le Grand-Duc et sa petite barbiche blanche avec une condescendance ironique, mais elle était secrètement flattée par cette association et ne manquait jamais de lui donner, en russe, du «prince sérénissime», tout en lui tendant la valise à porter. Le «prince sérénissime» devant les acheteurs éventuels, devenait si gêné, si malheureux et se taisait d'un air si coupable, lorsque ma mère leur décrivait longuement son degré exact de parenté avec le Tsar, le nombre de palais qu'il avait en Russie et les liens étroits qui l'unissaient à la Cour d'Angleterre, que les clients avaient tous le sentiment de faire une belle affaire et d'exploiter un être sans défense et ils concluaient presque toujours le marché. C'était, pour ma mère, un excellent élément, et elle en prenait grand soin. Il souffrait d'une maladie de cœur et ma mère, avant chaque expédition, lui donnait vingt gouttes de son médicament dans un verre d'eau. On pouvait les voir, tous les deux, à la terrasse du café de la Buffa, faisant des projets d'avenir, ma mère, exposant ses idées sur mon rôle d'ambassadeur de France, et le Prince Sérénissime, le genre de vie qu'il entendait mener après la chute du régime communiste et le retour des Romanoff sur le trône de Russie.
– J'entends vivre tranquillement sur mes terres, loin de la Cour et des affaires publiques, disait le Grand-Duc.
– Mon fils se destine à la Carrière, disait ma mère, en buvant son thé.
Je ne sais ce qu'est devenue Son Altesse Sérénissime. Il y a bien un Grand-Duc russe enterré au cimetière de Roquebrune-village, non loin de ma propriété, mais j'ignore si c'est le même; je crois, du reste, que sans sa barbiche blanche, je ne le reconnaîtrais pas.
Ce fut à cette époque que ma mère fit sa meilleure affaire, la vente d'un immeuble de sept étages dans l'ancien boulevard Carlonne, aujourd'hui boulevard Grosso. Il y avait déjà plusieurs mois qu'elle parcourait inlassablement la ville à la recherche d'un acheteur, sachant bien qu'il y avait là un tournant décisif et que si la vente était conclue, ma première année d'études à l'Université d'Aix-en-Provence allait être assurée. Ce fut tout à fait par hasard que l'acheteur se présenta. Un jour, une Rolls-Royce s'arrêta devant notre maison, le chauffeur ouvrit la portière, un petit monsieur rond en descendit, suivant une belle jeune dame deux fois sa taille et moitié son âge. Il s'agissait d'une ancienne cliente du salon de couture de ma mère à Wilno et de son mari, récemment acquis, un homme très riche et qui le devenait chaque jour davantage. Ils venaient, nous le découvrîmes, directement du ciel. Non seulement le petit M. Jedwabnikas acheta l'immeuble, mais encore, frappé, comme tant d'autres avant lui, par l'esprit d'entreprise et l'énergie de ma mère, il lui en confia la gérance, acceptant séance tenante la suggestion de transformer une partie de l'immeuble en hôtel-restaurant. Ce fut ainsi que l'Hôtel-Pension Mermonts – «Mer» comme mer, et «Monts» comme montagnes – sa façade repeinte et ses assises assurées, ouvrit ses portes à «la grande clientèle internationale, dans une atmosphère de tranquillité, de confort et de bon goût» – je cite le premier prospectus textuellement: j'en suis l'auteur. Ma mère ignorait tout de l'hôtellerie, mais elle fut immédiatement à la hauteur des circonstances. J'ai passé depuis ma vie dans les hôtels du monde entier, et à la lumière de cette expérience, je puis dire qu'avec des moyens matériels très limités, ma mère avait réalisé un véritable tour de force. Trente-six chambres, deux étages d'appartements et un restaurant – avec deux femmes de chambre, un garçon, un chef et un plongeur, l'affaire marcha tambour battant dès le début. Quant à moi, je fus préposé aux fonctions de réceptionniste, de guide en autocar, de maître d'hôtel et, en général, chargé de faire bonne impression aux clients. J'avais déjà seize ans, mais c'était la première fois que je me trouvais exposé à des contacts humains à doses si massives. Notre clientèle venait de tous les côtés du monde, avec une forte prédominance d'Anglais. Ils débarquaient, en général, par groupes, envoyés par des agences et, dilués ainsi dans la démocratie du nombre fondaient de gratitude à la moindre marque d'attention. C'étaient alors les débuts du «petit tourisme», qui devait devenir la règle générale peu avant la guerre et depuis. A quelques exceptions près, c'était une clientèle douce, soumise, peu sûre d'elle-même et facile à satisfaire. Les femmes prédominaient.
Читать дальше