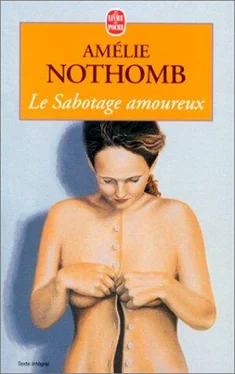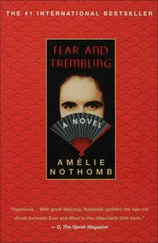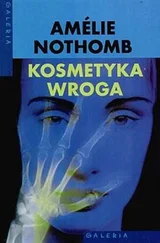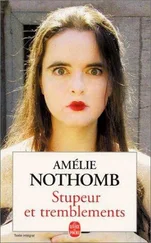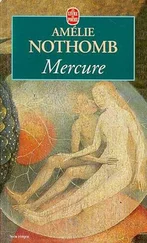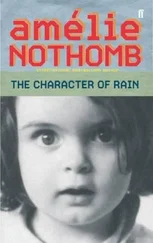Nous ne désirions pas particulièrement qu'il y ait des morts. Mais s'il devait y en avoir pour que la guerre continue, il y en aurait.
De toute façon, ce genre de considérations secondaires ne nous obsédait pas.
De minimis non curat praetor. Il était normal que les adultes, ces enfants déchus, perdent, à se soucier de ces questions, un temps dont ils n'avaient pas d'usage sérieux.
Nous, nous avions un sens si aigu des valeurs humaines que nous ne parlions quasi jamais des plus de quinze ans. Ils appartenaient à un monde parallèle, avec lequel nous vivions en bonne intelligence puisque nous ne nous croisions pas.
Nous n'abordions pas non plus l'inepte question de notre avenir. Peut-être parce qu'instinctivement nous avions tous trouvé la seule vraie réponse: «Quand je serai grand, je penserai à quand j'étais petit.»
Il allait de soi que l'âge adulte était voué à l'enfance. Les parents et leurs complices étaient sur terre pour que leurs rejetons n'aient pas à se soucier de questions ancillaires comme la nourriture et le gîte – pour qu'ils puissent assumer à fond leur rôle essentiel, être enfants, c'est-à-dire être.
Ces gosses qui dissertent de leur futur m'ont toujours intriguée. Lorsqu'on ine posait la fameuse question: «Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande?», je répondais invariablement que je «ferais» Prix Nobel de médecine ou martyre, ou les deux à la fois. Et je répondais très vite, non pour impressionner, au contraire: cette réponse prémâchée me servait à évacuer au plus pressé ce sujet absurde.
Plus abstrait qu'absurde: en mon for intérieur, j'étais persuadée que je ne deviendrais jamais adulte. Le temps durait trop longtemps pour que cette chose puisse arriver. J'avais sept ans: ces quatre-vingt-quatre mois m'avaient paru interminables. Ma vie était d'une longueur! La simple idée que je pusse encore vivre un nombre égal d'années me donnait le vertige. Sept ans supplémentaires! Non. Ce serait trop. Je m'arrêterais sans doute à dix ou onze ans, au comble de la saturation. Je me sentais déjà presque saturée, d'ailleurs: il m'était arrivé tant de choses!
Ainsi, quand je parlais de mon Nobel de médecine ou du martyre, ce n'était pas vanité: c'était une réponse abstraite à une question abstraite. Et puis, je ne voyais rien de si grandiose à ces professions. Le seul métier qui m'inspirât un respect véritable était celui de soldat, et en particulier celui d'éclaireur. Le sommet de ma carrière, je le vivais au présent. Après – s'il y avait un après – il faudrait bien déchoir et se contenter du Nobel. Mais au fond de moi je ne croyais pas en cet après.
Cette incrédulité en accompagnait une autre: quand les adultes parlaient de leur enfance, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils mentaient. Ils n'avaient pas été enfants. Ils étaient adultes de toute éternité. La déchéance n'existait pas, car les enfants restaient des enfants, comme les adultes restaient des adultes.
Cette conviction informulée, je la gardais en moi. Je me rendais bien compte que je ne pourrais pas la défendre: j'y croyais d'autant plus fort.
Elena ne raconta à personne que mon vélo était un cheval, ou inversement.
De sa part, ce ne fut pas le signe d'une bonté particulière: c'était parce que je n'avais aucune importance. Elle ne parlait pas des quantités négligeables.
D'ailleurs, elle parlait peu. Et elle ne prenait jamais la parole elle-même: elle se contentait de répondre aux questions qui ne lui paraissaient pas indignes d'elle.
– Tu feras quoi quand tu seras grande? demandai-je, par simple goût de l'expérimentation scientifique.
Pas de réponse.
A posteriori, son attitude confirme mes vues. Les enfants qui trouvent une réponse à pareille question sont soit de faux enfants (il y en a beaucoup), soit des enfants qui ont le goût de l'abstraction et de la spéculation pure (c'était mon cas).
Elena était un vrai enfant qui n'avait pas une tournure d'esprit spéculative. Pour elle, répondre à une question aussi bête eût été s'abaisser. Car cette interrogation stupide équivaudrait à demander à un funambule ce qu'il ferait s'il était comptable.
– D'où elle vient, ta robe?
Là, elle daignait répondre. C'était le plus souvent:
– Maman l'a faite. Elle coud très bien.
Ou alors:
– Maman me l'a achetée à Turin.
C'était la ville d'où elle venait. Bagdad ne me paraissait pas plus extraordinaire.
Elle portait surtout des vêtements blancs. Cette couleur lui allait à ravir.
Ses cheveux lisses étaient tellement longs que, même nattés, ils lui descendaient jusqu'aux fesses. Sa mère n'eût jamais autorisé une Chinoise à les toucher: c'était elle qui, lentement, passionnément, entretenait le trésor de sa fille.
Je préférais n'avoir qu'une natte, mais Trê m'en faisait le plus souvent deux, comme à elle-même. Les jours où j'obtenais la natte unique, je me sentais très élégante. J'avais le plus grand respect pour mes cheveux jusqu'à ce que je découvre ceux d'Elena: dès lors, les miens me parurent triviaux. Cette vérité m'apparaissait surtout quand, par hasard, nous étions coiffées de manière identique: ma natte était longue et sombre, la sienne n'en finissait pas et étincelait de noirceur.
Elena avait un an de moins que moi et je mesurais bien cinq centimètres de plus qu'elle, mais elle m'était supérieure en tout, elle me dépassait comme elle dépassait le monde entier. Elle avait si peu besoin des autres qu'elle me semblait plus âgée que moi.
Elle pouvait passer des journées à arpenter l'espace exigu du ghetto, à petits pas très lents. Elle regardait juste assez pour voir qu'elle était regardée.
Je me demande s'il y avait des enfants qui ne la regardaient pas. Elle inspirait l'admiration, le respect, le ravissement et la peur, parce qu'elle était la plus belle et parce qu'elle était toujours sereine, parce qu'elle ne faisait jamais les premiers pas dans les contacts humains, parce qu'il fallait venir au-devant d'elle pour entrer dans son monde, et parce que en fin de compte personne n'entrait dans son monde, qui devait être luxe hautain, calme hautain et volupté hautaine, et où, d'elle-même et d'elle seule, elle semblait se complaire à la perfection.
Personne ne la regardait autant que moi.
Depuis 1974, nombreux ont été les êtres que j'ai regardés longuement, avidement – au point de les déranger.
Mais Elena fut la première.
Et cela ne la dérangeait pas le moins du monde.
C'est elle qui m'a appris à regarder les gens. Parce qu'elle était belle, et parce qu'elle paraissait exiger d'être regardée très fort. Exigence à laquelle je satisfaisais avec un zèle rare.
A cause d'elle, mon efficacité militaire se mit à décliner. L'éclaireur éclairait moins. Avant elle, je passais tout mon temps libre à cheval, à repérer l'ennemi. A présent, il fallait aussi que nombre d'heures fussent consacrées à regarder Elena. Cette activité pouvait être pratiquée en selle ou à pied, mais toujours à distance respectueuse.
Qu'une telle attitude pût être maladroite ne me fût pas venu à l'esprit. Quand je la voyais, j'oubliais que j'existais. Cette amnésie autorisait les comportements les plus étranges.
C'était la nuit, au lit, que je me rappelais ma présence. Et là, je souffrais; j'aimais Elena et je sentais que cet amour appelait quelque chose. Je n'avais aucune idée de la nature de ce quelque chose. Je savais qu'il eût au moins fallu que la belle se souciât un peu de moi: c'était la première étape, indispensable. Mais je sentais qu'après il devrait y avoir un échange obscur et indéfinissable. Je me racontais des histoires – que d'aucuns qualifieraient de métaphores – pour approcher ce mystère: dans ces récits expérimentaux, la bien-aimée avait toujours horriblement froid. Le plus souvent, elle apparaissait couchée sur de la neige. Elle était très peu vêtue, voire nue, et elle pleurait de froid. La neige jouait un rôle considérable.
Читать дальше