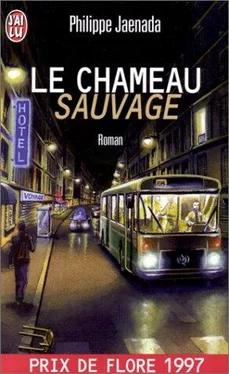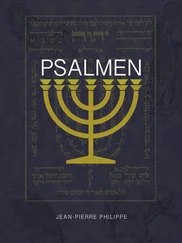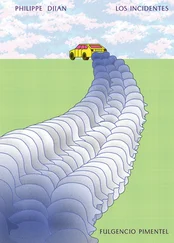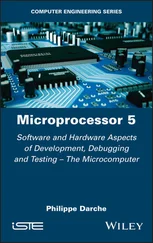Nous nous sommes embrassés pendant cinq ou six heures à l'intersection des couloirs – comme tous les amoureux de l'histoire de la planète «je n'arrivais pas à la quitter» – et c'est elle qui s'est éloignée la première, vers son quai. Je suis resté immobile à la regarder partir (ses cheveux, ses épaules) pour augmenter la tension mélodramatique.
Sur les quais, nous nous sommes retrouvés face à face, séparés par les voies électrifiées. C'était relativement gênant, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas la moindre envie de continuer la conversation en criant devant les deux cents personnes présentes (j'avais déjà vu des couples ou des amis ne pas se gêner pour le faire et me demandais toujours si ces gens avaient ou non une vague idée de ce que peut être la pudeur (le pire, c'est lorsque l'un des deux, normal, semble affreusement embarrassé que l'autre déballe toute leur vie devant ce public forcément attentif, puisqu'il n'a rien d'autre a faire qu'écouter)), je ne me voyais pas non plus lui parler par gestes (je n'aurais pas su quoi lui mimer), ni la regarder droit dans les yeux sans bouger, ni me promener sur mon quai en sifflotant comme si elle n'existait plus. Heureusement, son métro est vite arrivé. Avant qu'il ne la cache, elle m'a fait un signe de la main, un geste de petite fille (en inclinant la tête sur le côté) à faire tomber une statue de l'île de Pâques, elle est montée dans le wagon, et à partir du moment où elle s'est assise, elle n'a plus prêté attention à moi. Elle regardait droit devant elle, comme si elle était seule. Quand les portes se sont refermées, elle a ouvert son sac bleu pour y chercher quelque chose. Comme le matin, lorsque je l'avais aperçue dans le café, je prenais plaisir à la voir ainsi au milieu des autres, dans cette sorte d'intimité particulière que crée la solitude dans une foule – et que l'on peut facilement surprendre, juste en regardant autour de soi. Elle n'était sans doute pas naturelle, puisqu'elle sentait mon regard sur elle, mais elle se prêtait à ce jeu, c'était le principal, elle acceptait de m'offrir une image d'elle sans moi. Quand le métro a démarré et que je l'ai vue partir, seule, sérieuse et déjà lointaine, j'ai ressenti la même émotion indicible que le matin. Pour rester encore une fois sobre et pondéré, disons que j'ai eu envie de me lancer dans la sculpture, la poésie, la peinture, la musique, l'art floral, le théâtre et l'architecture pour être capable de lui exprimer mon amour de toutes les manières possibles (même la danse, allez: je m'imaginais fort bien exécuter la danse de l'amour devant elle, gracieux et lascif, bouleversant). (J'ai également pensé à l'état dans lequel je me serais trouvé si cette scène avait eu lieu dix jours plus tôt, si je l'avais aperçue au dernier moment dans un métro qui s'éloignait: ainsi se serait passée, brève, notre seconde rencontre promise par la nature – alors je me suis rendu compte de ma chance.) Ma rame est arrivée un instant plus tard.
Ce n'est qu'à Saint-François-Xavier que j'ai réalisé que nous avions pris chacun la mauvaise direction. J'étais parti vers le sud, elle vers le nord. Si je raconte ça à quelqu'un, on ne me croira pas – j'essaierai, à tout hasard. J'ai commencé à monter l'escalier pour changer de quai et repartir dans l'autre sens. Décidément, on ne se refait pas. Quelle tête de linotte. Quel nigaud. Cela prouvait que Pollux me déboussolait réellement, que je n'étais pas en train de me monter la tête pour le plaisir – artificiel – de vivre une grande histoire merveilleuse.
Soudain, je me suis pétrifié sur une marche. C'est elle qui est descendue la première sur son quai. Je n'ai fait que suivre – ou plutôt le contraire. C'est elle qui est montée la première dans le mauvais métro. Or, Pollux Lesiak est peut-être une tête de linotte, je n'en sais rien encore, mais certainement pas une nigaude: c'est donc qu'elle est tout aussi déboussolée que moi.
JE LA TROUBLE.
Incroyable et grisante découverte. Elle m'aime jusqu'à l'égarement. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Le métro, le fer et la vitesse, qui n'ont a priori rien à voir avec les vibrations subtiles de l'amour, m'ont permis d'obtenir la réponse que mille questions précises à l'intéressée ne m'auraient pas fournie. (Elle était peut-être si pressée de s'enfuir après cette journée cauchemardesque avec le Roi des Nigauds qu'elle s'était engouffrée dans le premier couloir venu, comme une antilope qui fuit le feu, mais ça ne m'est pas venu à l'esprit.) Plein d'une foi nouvelle et, par conséquent, d'un courage nouveau, j'ai redescendu l'escalier sur lequel je m'étais engagé et je l'ai attendue au milieu du quai. Un premier train est arrivé, j'ai regardé passer les trois premiers wagons avec l'œil aiguisé de je ne sais plus quel héros bionique et j'ai trottiné le long des quatre derniers de ma foulée la plus aérienne. Personne.
Elle était dans le deuxième train, cinquième wagon, baignoire du fond, assise à côté d'un gros Chinois qui portait un bandage à la tête. Elle s'est levée, s'est avancée en souriant jusqu'à la porte ouverte et m'a dit:
– J'ai de la paella surgelée, si tu veux.
Elle habitait un grand studio, sans doute un ancien deux-pièces, au cinquième étage d'un immeuble étroit de la rue Vavin. Des murs blancs, fissurés, un parquet non verni, deux grandes fenêtres sans rideaux, sur la gauche. Le lit, par terre dans un coin au fond de la pièce, était recouvert d'une couette bleue délavée. Contre un mur, des étagères métalliques croulaient sous des livres de poche rangés un peu n'importe comment – le premier que j'ai vu: Le Bel Été. Non loin du lit, un vieux divan de cuir râpé et deux chaises probablement volées dans un square entouraient une table basse de fabrication maison (une plaque de verre vert posée sur quatre piles de vieux annuaires), sur laquelle étaient entassés des journaux, des papiers, des lettres. Un ordinateur était installé sur une table à tréteaux entre les fenêtres. Sur une troisième table, en bois, flanquée de deux chaises pliantes, se trouvaient un bol de faïence, un verre à pied au fond duquel restait un peu de jus d'orange, un couteau dont la lame était enduite de beurre et un cendrier d'étain contenant trois mégots. Son petit déjeuner de la veille. Il y avait encore une grande armoire de style normand, une chaîne hi-fi et une trentaine de CD en vrac – le premier que j'ai vu: No Comprendo, des Rita Mitsouko -, une télé et un magnétoscope posés à même le parquet, près desquels s'élevaient deux grandes piles de cassettes vidéo dont le contenu était inscrit au marqueur noir sur la tranche – la première que j'ai vue: «wanda». Aux murs étaient accrochées des reproductions décolorées représentant des dessins de temples romains en ruine, le portrait d'un homme brun au regard saisissant, peint sur un grand carré de bois, une photo noir et blanc de Chet Baker épuisé et songeur sur une chaise, une de Mr. Spock, le personnage de Star Trek et au-dessus de son ordinateur une feuille machine sur laquelle était imprimé: «POLLUX, TU DOIS TRAVAILLER». Au fond, près du lit, une porte entrouverte donnait sur la salle de bains. En face des fenêtres, après les étagères à livres, le mur s'ouvrait sur ce qu'on appelle une «cuisine américaine», séparée de la pièce principale par un petit comptoir.
Assis sur le divan, j'ai compté les lampes qu'elle avait allumées en entrant: six. De vieilles lampes. Elle a posé une bouteille de whisky et deux verres sur la table basse, puis est allée vérifier dans le compartiment congélateur de son frigo qu'elle avait bien de la paella. Pendant que je nous servais, elle préparait quelque chose dans la cuisine. Je regardais attentivement autour de moi, je m'imbibais de son décor comme un morceau de coton dans un verre d'eau, j'avais le sentiment d'être admis dans sa vie, autorisé à visiter ses intérieurs. J'aurais aimé pouvoir disposer d'une journée entière, seul dans son appartement, pour en étudier les moindres détails, comme Sherlock Holmes devait le faire en quelques secondes lorsqu'il pénétrait chez une dame (je suis plus laborieux, mais je m'applique). Parmi les papiers entassés sur la table basse, j'ai vu dépasser une lettre signée «Thomas», une facture de téléphone de 1651 francs, une carte postale de Manhattan, une disquette étiquetée «Mathilde». Le cendrier posé sur la table de l'ordinateur était plein à ras bord. Sur son lit, il y avait un tee-shirt blanc en boule, et près de la lampe de chevet, les Contes d'Odessa d Issaak Babel. Plusieurs objets étaient «exposés» sur les étagères à livres, dont une 4L Majorette rouge, un flacon d'eau de toilette pour homme, deux dés noirs, un appareil photo jetable, quelques boîtes d'allumettes apparemment orientales, un petit zèbre en bois peint qui s'écroule quand on appuie sur le fond de son socle avec le pouce et se redresse quand on relâche, une paire de lunettes rondes, une photographie encadrée d'un bel homme à l'air argentin, un vieux rasoir à main en argent et une petite boîte de concentré de tomates. Dans le pli du divan, j'ai trouvé une bague d'enfant comme il y en a dans les pochettes-surprises. Le téléphone, posé par terre près du lit, avait été peint en jaune. Le répondeur semblait être l'un des premiers prototypes construits dans les années soixante. Sur le côté du poste de télé était scotchée une photo d'elle, les cheveux plus courts, entre deux garçons, plutôt jeunes et séduisants: elle les tenait serrés contre elle, ils souriaient, elle se donnait un air grave et autoritaire, sourcils froncés. Ce qui me fascinait et me troublait le plus, c'était sans doute de m'apercevoir qu'elle avait vécu avant de me connaître.
Читать дальше