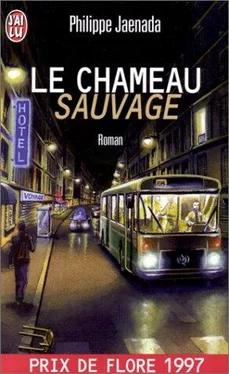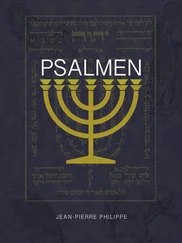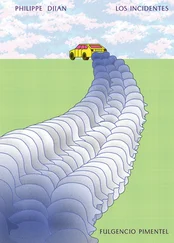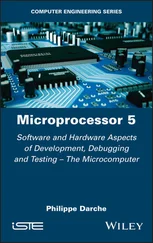En mars, j'ai pris le câble. En mai, j'ai cassé deux assiettes le même jour. En juin, je me suis acheté une paire de jumelles et j'ai essayé d'arrêter de fumer – j'ai tenu trente et une heures. En juillet, Caracas m'a fait une sorte de crise de foie. Fin juillet, je suis allé trois soirs de suite au cinéma. En août, je suis parti passer deux semaines chez mes grands-parents à la montagne. Début septembre, je suis allé voir un match de foot au Parc des Princes. Fin septembre, je me suis fait dévitaliser deux molaires. En octobre, j'ai donné le quinte dans l'ordre. En novembre, j'étais comme mort.
J'avais rencontré Pollux Lesiak un an plus tôt, j'avais décidé de changer après l'avoir perdue, et en un an, je m'étais transformé en un lamentable automate. C'était réussi, ma fuite. Un triomphe. Splendide. Je ne m'intéresse plus à personne et je n'intéresse plus personne. Un bilan remarquable.
La Cravache faisait peine à voir
Le soir de l'anniversaire de notre rencontre, je ressassais ces pensées sinistres, assis devant la télé avec une tablette de chocolat, lorsqu'une image hideuse m'est apparue. Je me voyais. Je m'élevais au-dessus de mon corps, comme tous ceux qui vont mourir, paraît-il, et je me voyais. Consternant. Je ressemblais à mon ancienne voisine, la folle du premier. Je vaporisais du Wizard Spécial Toilettes de tous les côtés, je changeais d'appartement, pschitt, je changeais de métier, pschitt, je me mettais à écouter du jazz et à me faire appeler Pedro, pschitt pschitt, alors que l'odeur de tristesse venait de l’intérieur. Le Charles Bronson de l'apparence et de l’accessoire, c'était moi. Et je chérissais Pollux Lesiak, posée comme un basset sur une petite table au fond de moi, le crâne fracassé, deux gros trous à la place des yeux.
Au début du mois de décembre, quelques jours avant mon anniversaire, Marthe m'a invité à une soirée qu'organisait la maison d'édition pour le lancement d'une nouvelle collection. Génie de la vie, elle avait deviné je ne sais comment, par télépathie ou au son de ma voix sur mon répondeur («Vous êtes bien chez Halvard Sanz, mais pas moi»), que j'agonisais au fond du trou que j'avais creusé moi-même au fond du gouffre. Revoir d'anciens collègues, boire un peu de champagne et danser sur des rythmes endiablés, en secouant bien la tête et en lançant les bras de toutes parts, me changeraient les idées.
Je me suis habillé grand chic, car la Cravache, même incognito, se devait dorénavant de faire bonne figure – je portais un simple costume, mais c'est ce que je considère comme le grand chic (avec mon sac matelot en bandoulière, je faisais un peu couillon de la lune, mais il n'est jamais inutile de laisser l'entourage nous sous-estimer si ça l'amuse (à ma connaissance, je ne suis pas un couillon de la lune)) – et j'ai sauté dans un taxi. (En réalité, j'ai attendu un bon quart d'heure dans le froid au bord de l'avenue de Clichy, sous la pluie, mais dès qu'un Chinois charitable a accepté de me prendre et que je me suis retrouvé confortablement installé sur la banquette de skaï défoncée de son véhicule à moteur, j'ai préféré imaginer que j'avais posé un pied sur le trottoir, levé machinalement la main en disant hep, la berline de luxe s'arrête aussitôt dans un crissement de pneus, je m'éloigne à grands pas de la corniche qui me protégeait de la pluie, m'engouffre à l'intérieur de la voiture, cocon de cuir souple et chaud, suite de Bach et parfum de vanille, je referme la portière (claquement feutré) et me passe une main dans les cheveux avant d'annoncer ma direction au chauffeur d'une voix un peu lasse: il fallait que je me donne le moral, que je parte en conquérant décontracté, sinon j'allais passer la soirée sur une chaise à ruminer ma vacuité – ce qui ballonne.) Au son du rock chinois, sans doute très entraînant pour les Chinois, et portés par un entêtant parfum de beignet de crevettes, nous sommes arrivés tant bien que mal à Bastille, après trois erreurs de parcours et deux drames de la circulation évités de justesse. J'ai laissé un bon pourboire à mon sympathique pilote: je tenais à lui montrer que, même si j'étais plutôt coutumier des trajets en limousine, je n'avais aucun mépris pour les artisans étrangers qui commencent petit et qui, à force de travail, de courage et de persévérance, réussiront à se faire une place au soleil.
Maintenant, va dans le monde, la Cravache, et tiens-toi droit.
La soirée se déroulait dans une grande salle louée pour l'occasion, rue du Faubourg-Saint-Antoine. Lorsque je suis arrivé, la plupart des invités bourdonnaient déjà à l'intérieur. J'ai eu l'impression curieuse d'entrer dans un vaste laboratoire qui fabriquerait des attitudes et des paroles en grand nombre, dont les deux ou trois cents employés bien habillés produiraient en permanence de la voix calme et du petit mouvement destinés à l'exportation – ou simplement pour étude -, dans des conditions de travail très agréables. Tous ces gens plus ou moins semblables, debout dans une salle, qui parlaient par groupes de trois ou quatre, faisaient des gestes tranquilles avec leurs mains, de légères inclinaisons de la tête, de la gymnastique de bouche, des clins d'oeil, de discrets changements de jambe pour ne pas s'ankyloser, fumaient une cigarette ou portaient un verre à leurs lèvres, tournaient les yeux à droite ou à gauche, échangeaient quelques mots avec un collègue d'un autre groupe de travail, serraient une main, touchaient une épaule, embrassaient une joue, souriaient, toussotaient, fronçaient les sourcils – tous ces gens enveloppés dans le brouhaha de la machine semblaient faire équipe, tous engagés dans la même entreprise, l'industrie humaine. Je peux me joindre à vous?
J'ai mis longtemps à retrouver Marthe. Elle semblait très occupée, l'importance de son poste au sein de la maison l'obligeait à papillonner partout. Elle faisait de son mieux pour passer dans tous les groupes, consacrer quelques instants à chacun, féliciter Untel pour sa dernière traduction ou présenter Truc à Truque, dont elle lui avait souvent parlé. Elle m'a rapidement présenté Robert Nono, Cédric et Laure, dont elle m'avait souvent parlé, puis je suis allé me servir un whisky au bar. Comme les rares personnes que je connaissais étaient toutes occupées dans des groupes, et que je n'avais pas le courage et la persévérance nécessaires pour me faire une place au soleil, j'ai repéré une chaise le long d'un mur et je m'y suis assis.
Bien sûr, cette position me singularisait de manière fâcheuse (je devais avoir l'air du fainéant, du rebelle, de celui qui joue au Game Boy dans son coin pendant que les autres travaillent – ou bien (qui sait?) du pauvre type qui n'a pas d'amis), mais je pensais que rester debout au milieu, seul, sans parler, un verre à la main et l'autre bras le long du corps, serait encore plus préjudiciable à mon image.
J'étais le conquérant décontracté, inutile de revenir là-dessus, mais je me demandais comment j'allais m'y prendre pour conquérir tous ces gens qui discutaient entre eux sans prêter attention à moi. Je ne savais pas par quel côté les approcher. Car je me trouvais apparemment à l'écart, là. Eh oui. Personne ne me regardait. Nous étions pourtant un très grand nombre d'invités. Statistiquement, il n'était pas impossible que quelqu'un se tourne vers moi, engage peut-être la conversation et me pistonne ensuite pour entrer dans l'entreprise avec les autres. Eh non, pourtant. Sans doute était-ce la distance que j'avais involontairement mise entre eux et moi, qui les rebutait. Ce gars-là est un solitaire, un ermite comme on n'en voit plus beaucoup de nos jours, laissons-le à ses ruminations, il nous en voudrait de le déranger. Si seulement ils avaient su que j’étais la Cravache! J'aurais pu les conquérir sans mal. (Ils ne devaient pas être plus de deux ou trois à avoir déjà ouvert un journal de tiercé – certainement ceux qui avaient réussi à s'incruster discrètement ici pour boire un coup – mais j'essayais de ne pas y penser (je devais également éviter de me souvenir que les pronostiqueurs hippiques ne sont pas les véritables stars de notre société)). Us ne savaient pas qui j'étais. D'ailleurs, ça ne présentait pas que des inconvénients. Ainsi, ils ne voyaient que ma surface, ils ne pouvaient pas deviner que j’étais désespéré. Même s'ils m'avaient regardé, ils ne se seraient pas aperçus que j'étais un moins que rien qui n'a plus d'âme. C'est l'avantage de l'anonymat.
Читать дальше