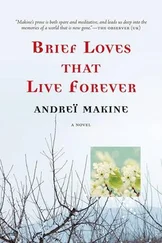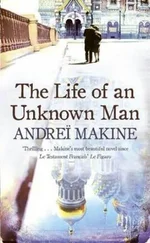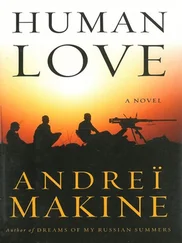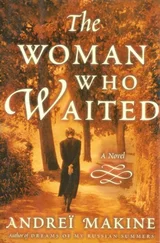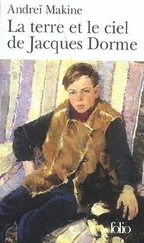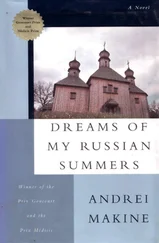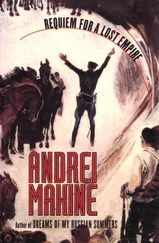«Il y a dix ans ou plus peut-être je pensais exactement comme toi: toutes ces guerres pour replâtrer une doctrine fissurée? Tous ces efforts pour faire plaisir aux gérontes du Kremlin? Un jour, n'en pouvant plus, je l'ai dit à Chakh. Comme toi: pour la gloire de quelle cause? Vers quels abîmes ensoleillés? Il m'a écoutée et… il a parlé de Sorge. J'étais folle de rage. Je me disais: ça y est, il va me faire un cours de propagande: "Richard Sorge, le héros de notre temps, le superman de notre renseignement qui a communiqué la date de l'invasion hitlérienne, a été trahi par les bureaucrates de Moscou", etc., etc. Vieille histoire. Mais Chakh m'a raconté juste la dernière minute de Sorge. Je savais seulement, comme tout le monde, que les Japonais l'avaient exécuté en 44, après trois années de détention, c'est tout. Or, dans cette dernière minute, monté sur l'échafaud, Sorge lança d'une voix forte et calme: "Vive l'Armée rouge! Vive l'Internationale communiste! Vive le parti communiste soviétique!" Tout à fait démodé, n'est-ce pas? Grotesque? Je l'ai dit à Chakh, en termes plus nuancés, il est vrai. Et lui m'a encore une fois étonnée. "Tu crois, m'a-t-il dit, que Sorge ne savait pas ce que valaient Staline et sa clique? Si, et comment! Mais c'est en mourant ainsi qu'il a montré ce que ces salauds valaient."»
Je sentais que cet homme sur l'échafaud était ton dernier argument. Je n'essayai pas de relativiser sa parole de condamné. Une minute avant la mort, elle avait droit à l'absolu. Je te regardais parler et notais douloureusement toutes les marques que le sourire ne parvenait plus à effacer: cette coulée argentée qui s'élargissait dans tes cheveux, cette veine qui imprimait dans la tempe un fin tracé bleu… Tu interrompis ce regard, sans doute trop insistant, en tirant de ton sac un journal: «Lis ça…»
C'était une étroite colonne qui annonçait la mort d'un certain Grinberg, opposant soviétique, qui avait passé plusieurs années dans les camps, avait été expulsé en Occident, avait animé une station de radio dissidente. Le journaliste précisait que Grinberg était mort à Munich dans un minuscule appartement, oublié de tous, avec sur sa table de nuit un fatras de feuilles: ses écrits, qui n'intéressaient plus personne, des factures qu'il ne pouvait plus régler, des lettres…
«Tu devines de qui il s'agit?»
Je mis quelques secondes à fouiller dans mes souvenirs, entre la Russie et l'Occident. Grinberg… Non, ce nom ne me disait rien. «L'homme qui a lancé la toupie, dans cette galerie d'art à Berlin, tu te rappelles? Il y a… presque dix ans. Tu vois, lui aussi a perdu sa bataille.»
Nous restâmes un moment sans parler. Puis tu te levas et, en abandonnant le journal sur la table voisine, tu murmuras:
«Je ne vais pas jouer les bohémiennes et prédire ton destin, mais si tu ne veux pas servir les "nouveaux maîtres", il est temps pour toi de partir. Oui, partir, te retirer du jeu, te faire oublier, disparaître. Après tout, ce ne sera qu'un changement d'identité de plus.»
La nuit, tu pleurerais en te retenant, en essayant de ne pas me réveiller. Je ne dormais pas mais restais immobile, sachant que dans tes pensées, et dans ces larmes, je vivais déjà sous cette autre identité, dans cette lointaine vie sans toi.

J'avais usé trop de vies pour considérer celle que je commençais sans toi, en Occident, comme un arrachement au passé. Du reste, cet Occident nous était trop familier pour prétendre au nom grave et dur d'exil. Tu avais raison, ce n'était, du moins les premiers temps, qu'une identité de plus. Et je savais déjà que pour mieux l'adopter, pour s'adapter plus rapidement à un pays il fallait imiter. L'intégration ne signifie, au fond, rien d'autre que l'imitation. Certains la réussissent si bien qu'ils finissent par exprimer le caractère du pays mieux que les autochtones, justement à la manière de ces comédiens imitateurs qui flanquent tel ou tel homme connu d'une copie plus vraie que nature, condensé de tous ses tics gestuels, concentré de ses petites manies verbales… Pourtant, c'est au moment de réussir qu'un étranger découvre le but inavoué de ce jeu d'imitation: se faire pareil pour rester autre, vivre comme on vit ici pour protéger son lointain ailleurs, imiter jusqu'au dédoublement et, en laissant son double parler, gesticuler, rire à sa place, s'enfuir, en pensée, vers ceux qu'on n'aurait jamais dû quitter.
Au début, la certitude de te revoir dans un délai très proche était toute naturelle. J'imitais la vie et la survie matérielle en gagnant le droit à cette attente, à des voyages dans les villes d'Europe où te rencontrer me paraissait probable. Je me disais qu'il ne s'agirait même pas de retrouvailles, mais tout simplement de ta voix tranquille, un soir, au téléphone, ou de ta silhouette surgissant du flux de visages et de manteaux sur un quai… Je ne me souviens pas après combien de mois cette confiance commença à ternir. A ce même instant peut-être, je m'aperçus que je n'avais pas cessé de te parler, de te dire et redire les années passées avec toi, de me justifier, en fait, dans une désespérante tentative de vérité.
Il me vint alors l'idée de préciser les dates, les lieux, de me remémorer les noms, de baliser le passé que nous avions partagé. J'eus la sensation de me retrouver au royaume des morts. Plusieurs pays, à commencer par le nôtre, avaient, entretemps, disparu, changé de nom et de frontières. Parmi les gens que nous avions côtoyés, combattus ou aidés, certains vivaient sous une autre identité, d'autres étaient morts, d'autres encore s'étaient installés dans ce temps actuel où je me sentais souvent un fantôme, le revenant d'une époque de plus en plus archaïque. Mais surtout cet effort de précision m'écartait de ce que nous avions véritablement vécu. J'essayais d'inventorier les forces politiques, les raisons des conflits, les figures des chefs d'Etat… Mes notes ressemblaient à un étrange reportage qui parvenait d'un monde inexistant, d'un néant. Je comprenais qu'au lieu de cet inventaire de faits avec sa prétention d'objectivité historique, il fallait raconter la trame toute simple, souvent invisible, souterraine, de la vie. Je me souvenais de toi, assise sur le seuil d'une maison, les yeux abandonnés dans la lumière du couchant. Je revoyais le bras de ce jeune soldat, ce poignet avec un bracelet de cuir, dans la carcasse d'un blindé éventré. La beauté d'une enfant qui, à quelques mètres des combats et à mille lieux de leur folie, construisait une petite pyramide avec les douilles encore tièdes. En serrant les paupières, je retournais dans la maison au bord d'un lac gelé, dans le sommeil de cette maison dont tu m'avais quelquefois parlé… Il m'arrivait, de plus en plus souvent, de m'avouer que c'est dans ces éclats du passé que se condensait l'essentiel.
Un jour, en répondant au téléphone, je crus entendre ta voix, presque inaudible dans le chuintement d'un appel qui semblait venir du bout du monde. Je criai plusieurs fois ton nom, le mien aussi, les derniers que nous avions portés. Après un grésillement sourd, la communication se fit, impeccable, et j'entendis, trop près même de mon oreille, un rapide débit chantant, dans une langue asiatique (vietnamienne ou chinoise…), une voix féminine, très aiguë et insistante et qui ne laissait pas comprendre s'il s'agissait de petits rires ininterrompus ou de sanglots. Je gardai pendant plusieurs jours, en moi, la tonalité de ce bref chuchotement infiniment lointain, cet impossible sosie de ta voix, vite effacé par les criaillements de la Chinoise.
Ce chuchotement dans lequel j'avais cru reconnaître ta voix me rappela une soirée lointaine, dans cette ville qui brûlait derrière notre fenêtre avec sa moustiquaire déchirée. Je me, souvenais que ce soir-là, la proximité de la mort. notre complicité face à cette mort m'avaient donné le courage de te raconter ce que je n'avais encore jamais avoué à personne: l'enfant et la femme cachés au milieu des montagnes, des paroles chantées dans une langue inconnue…
Читать дальше