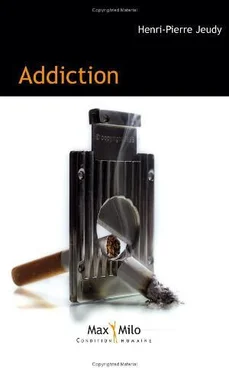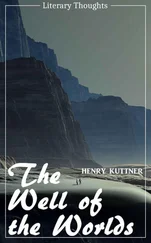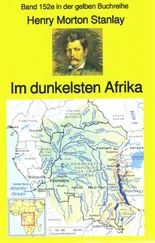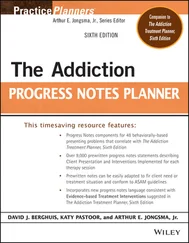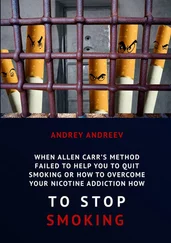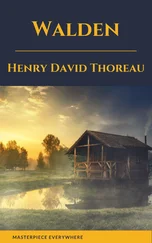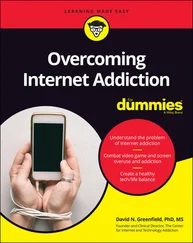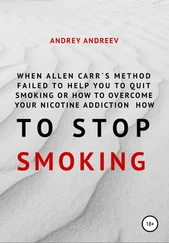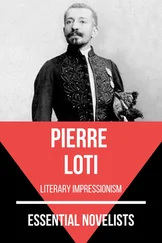Il est difficile d'admettre en contrepartie que nous substituons des modes de destruction les uns aux autres, et qu'en ce sens, la peur de la mort peut nous rendre morbides. C'est là une question d'économie corporelle dont la finalité première demeure la représentation de la longévité. La peur nous permettrait de développer des mécanismes de protection qui nous garantiraient une plus longue durée de vie. La santé, dit-on, est le bien le plus précieux, mais les économies de survie ne sont guère radieuses, elles impliquent une gestion mortifère des besoins et des désirs par l'accroissement des interdits. Objet de tous les soins, le corps devient objet de toutes les mortifications.
On connaît le vieux principe du Nirvana : la volonté de réduire à zéro toute excitation est le destin même des pulsions de mort. Il faudrait s'approcher au plus près d'un état de mort pour se donner les chances de survivre le plus longtemps possible. L'équilibre obtenu grâce à une juste mesure entre l'excès et le défaut apparaît comme le souvenir d'une philosophie surannée, l'impératif de la survie se fonde désormais sur la lutte contre la virtualité même de l'excès.
Imaginer l'horreur, est-ce le meilleur moyen de se convaincre d'arrêter de fumer ? Je peux me construire une vision de l'état interne de mon corps, je peux me représenter la noirceur de ma gorge et de mes poumons provoquée par la fumée du tabac, je peux regarder mes dents jaunir, je peux même me figurer une avancée progressive, sournoise, des métastases, de ces cellules destructrices que les substances nocives excitent, je ne sais pas pourquoi la peur de ma mort ne m'effraie pas au point d'avoir la volonté d'en retarder la venue. Dois-je en déduire que je reste inconscient du malheur qui ne manquera pas de se produire ? Ou dois-je croire que je me fais complice de ma propre dégradation ? Bien que je ne supporte pas, comme tant d'autres, les manières discriminatoires avec lesquelles on tente de nous convaincre de cesser de fumer, je ne peux ignorer l'évidence de cette déchéance qui s'accomplit à l'intérieur de mon corps. L'un de mes amis qui ne fume plus depuis deux années me dit souvent qu'il est préférable de ne point s'arrêter, et pourtant il l'a fait. Il ne manifeste pas la moindre tentation de recommencer, il dit qu'il a trop souffert durant de longs mois au cours desquels il était persuadé d'avoir perdu la raison. Etait-ce le manque de nicotine qui le rendait fou ? Fallait-il qu'il subisse l'épreuve d'une telle déchéance mentale pour redécouvrir sa puissance intellectuelle sans le moindre recours à une drogue ? Maintenant, il a l'air d'être sauvé, il ne fait pas le fanfaron, il apprécie que les autres fument autour de lui. Nous, les autres, nous pourrions le prendre mal, puisqu'il semble nous dire qu'il est tiré d'affaire, qu'il ne reviendra jamais sur sa décision, parce qu'il ne veut pas revivre cette terrible période où il a bien cru qu'il ne serait plus lui-même.
Ce temps de la grande rupture, tel que mon ami l'a vécu, est peut-être une expérience fascinante. Un véritable changement d'existence. La consommation régulière des cigarettes soutient l'enchaînement des gestes quotidiens, la succession des activités, et sans doute la concaténation du langage. Imaginons que cette habitude de la continuité s'effondre, le sens de ce que nous sommes en train de faire va perdre lui aussi son pouvoir de nouer le présent au futur immédiat. Il faudra que j'accepte le désarroi dans lequel je serai plongé, que je l'apprécie même comme une possible qualité de la vie. Etre là, commencer de faire quelque chose, oublier ce qu'on avait entrepris, s'asseoir, attendre, réfléchir à ce qu'on devrait envisager de faire, se lever, regarder autour de soi, découvrir l'inertie, la voir s'installer dans notre corps, la voir créer ses propres effets de pesanteur, consentir à l'abandon sans le moindre objectif. Une expérience initiatique. Une autre manière d'être au monde. Et surtout ne plus songer un instant qu'il s'agit d'une affaire de volonté. C'est une autre vie qui commence, et pour qu'elle puisse prendre forme, il lui faut passer par cette période préalable durant laquelle le regard porté sur le monde n'est plus le même. Celui qui a cessé de fumer au nom de la survie ignore cette singulière expérience. Il a trop besoin des artifices de la morale et de la science pour se justifier.
Il faut que l'acte souverain d'allumer une cigarette soit préservé dans la manière de cesser de fumer. Il faut que l'acte de fumer devienne une pure abstraction sans jamais disparaître. Voilà ce que je me suis dit pour me préparer aux premiers jours, à ces fameux jours où tout basculera.
Le fumeur doit se représenter qu'il cherche à provoquer la mort des autres. Il doit accepter leur intolérance radicale comme l'expression d'un salut communautaire alors qu'il est a priori exclu de tout partage commun de l'espace. Et si par mégarde il sourit en allumant une cigarette, il semble manifester son plaisir sournois de faire le malheur des autres. Sa possibilité d'être courtois lui est retirée puisqu'il n'est plus en mesure d'apprécier les convenances. Il est sommé de se replier, de s'isoler, afin de reconnaître qu'il n'est plus un être social. Il lui faut comprendre que s'il veut revenir à la vie sociale, il doit d'abord passer par l'épreuve d'une terrible humiliation au moment même où il est en train de fumer. Ainsi doit-il s'enfermer dans des espaces réservés aux fumeurs, si exigus qu'il tousse avec ses compagnons de misère qui, eux aussi, crachent leurs poumons en pompant la fumée des cigarettes comme des locomotives qui ont fait leur temps. Ces espaces-là, qu'on découvre dans certains aéroports, sont vitrés de sorte que l'on peut voir les condamnés s'agiter dans une épaisse fumée comme s'ils étaient déjà asphyxiés. Il est vrai qu'ils ont encore la chance de pouvoir en sortir, et qu'ils sont libres de ne point y aller. On leur fournit seulement une expérience salutaire qui préfigure ce que pourrait être leur sort définitif.
La manière de répandre la fumée de sa cigarette autour de soi est devenue un viol de l'espace public. Le fumeur est un criminel, mais il est aussi un violeur parce qu'il s'approprie un territoire qui ne lui appartient pas. Il impose sa loi en simulant quelque attention à l'égard d'autrui pour jouer les séducteurs. Comble du vice : on a toujours l'impression qu'il lui faut un espace vierge pour jouir de sa cigarette comme si c'était la première. Il n'ose plus envoyer sa fumée dans les yeux des femmes, ce n'est plus le signe intempestif d'une déclaration d'amour. Il l'envoie de côté, il envahit l'espace par les alentours, et ses petits nuages de fumée tentent d'en rejoindre d'autres pour former des anneaux de complicité.
Désormais l'espace public a été conquis par les non-fumeurs, les fumeurs n'ont qu'à bien se tenir, ils sont sous haute surveillance. Les signes de tolérance se font rares. Dans un restaurant, le tenancier a fabriqué des pancartes en carton qu'il accroche au mur, au-dessus de la tête des clients. Sur le recto, il est écrit : Espace fumeur, sur le verso : Espace non-fumeur. Lorsque les clients fument, il utilise le recto ; lorsqu'ils ne fument pas, il retourne la pancarte.
Hélas, aux subtilités du civisme s'est substituée la rigueur du moralisme. On aurait pu imaginer une société dans laquelle la prévenance eût été l'arme de la bonne entente, mais la discrimination exacerbée semble demeurer la règle essentielle du maintien de la communauté.
Qui a vraiment le pouvoir ? Les fumeurs ou les non-fumeurs ? Vous l'avez toujours eu, disent les non-fumeurs, c'est à notre tour de l'avoir ! Vous nous avez pollué la vie pendant des décennies, c'est à notre tour de vous pourchasser. Nous ne sommes pas intolérants, nous sommes assurés d'avoir raison. Les arguments que vous osez encore nous donner, vous les fumeurs, nous les tenons pour nuls et non avenus, les nôtres sont légitimes et bienvenus. Donc, c'est la guerre.
Читать дальше