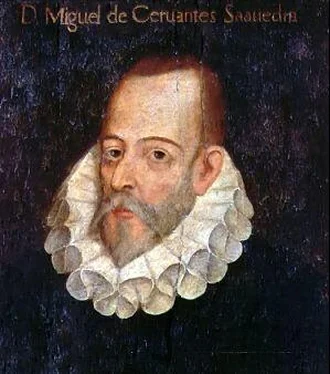Ce petit discours fut adressé tout d’une haleine par cette charmante fille aux trois amis, avec une voix si douce et tant d’aisance de langage, que la grâce de son esprit ne leur causa pas moins de surprise que sa beauté. Ils répétèrent leurs offres de service, et lui firent de nouvelles instances pour qu’elle remplît ses promesses; elle alors, sans se faire prier davantage, après avoir décemment remis sa chaussure et relevé ses cheveux, prit pour siège une grosse pierre, autour de laquelle s’assirent les trois auditeurs, puis, se faisant violence pour retenir quelques larmes qui lui venaient aux yeux, d’une voix sonore et posée, elle commença ainsi l’histoire de sa vie:
«Dans cette Andalousie qui nous avoisine, est une petite ville dont un duc prend son titre, et qui le met au rang de ceux qu’on appelle grands d’Espagne [176]. Ce duc a deux fils: l’aîné, héritier de ses États, l’est aussi, selon toute apparence, de ses belles qualités; quant au cadet, je ne sais de quoi il est héritier, si ce n’est des ruses de Ganelon ou des trahisons de Vellido [177]. De ce seigneur mes parents sont vassaux, humbles de naissance, mais tellement pourvus de richesses que, si les biens de la nature eussent égalé pour eux ceux de la fortune, ils n’auraient pu rien désirer davantage, et moi, je n’aurais pas eu non plus à craindre de tomber dans la détresse où je me vois réduite, car tout mon malheur naît peut-être de ce qu’ils n’ont pas eu le bonheur de naître illustres. Il est vrai qu’ils ne sont pas d’extraction si basse qu’ils aient à rougir de leur condition; mais elle n’est pas si haute non plus qu’on ne puisse m’ôter de la pensée que de leur humble naissance viennent toutes mes infortunes. Ils sont laboureurs enfin, mais de sang pur, sans aucun mélange de race malsonnante, et, comme on dit, vieux chrétiens de la vieille roche, et si vieux, en effet, que leurs richesses et leur somptueux train de vie leur acquièrent peu à peu le nom d’hidalgos et même de gentilshommes. Cependant la plus grande richesse et la plus grande noblesse dont ils se fissent gloire, c’était de m’avoir pour fille. Aussi, comme ils n’ont pas d’autres enfants pour hériter d’eux, et qu’ils m’ont toujours tendrement chérie, j’étais bien une des filles les plus doucement choyées que jamais choyèrent de bons parents. J’étais le miroir où ils se miraient, le bâton où s’appuyait leur vieillesse, le but unique où tendaient tous leurs désirs, qu’ils mesuraient sur la volonté du ciel, et dont les miens, en retour de leur bonté, ne s’écartaient sur aucun point. Et de la même manière que j’étais maîtresse de leurs cœurs, je l’étais aussi de leurs biens. C’est moi qui admettais ou congédiais les domestiques, et le compte de tout ce qui était semé ou récolté passait par mes mains. Les moulins d’huile, les pressoirs de vin, les troupeaux de grand et de petit bétail, les ruches d’abeilles, finalement tout ce que peut avoir un riche laboureur comme mon père, était remis à mes soins. J’étais le majordome et la dame, et j’en remplissais les fonctions avec tant de sollicitude et tant à leur satisfaction, que je ne saurais parvenir à vous l’exprimer. Les moments de la journée qui me restaient, après avoir donné les ordres aux contremaîtres, aux valets de ferme et aux journaliers, je les employais aux exercices permis et commandés à mon sexe, l’aiguille, le tambour à broder, et le rouet bien souvent. Si, pour me récréer, je laissais ces travaux, je me donnais le divertissement de lire quelque bon livre, ou de jouer de la harpe, car l’expérience m’a fait voir que la musique repose les esprits fatigués et soulage du travail de l’intelligence. Voilà quelle était la vie que je menais dans la maison paternelle; et si je vous l’ai contée avec tant de détails, ce n’est point par ostentation, pour vous faire entendre que je suis riche, mais pour que vous jugiez combien c’est sans ma faute que je suis tombée de cette heureuse situation au triste état où je me trouve à présent réduite. En vain je passais ma vie au milieu de tant d’occupations, et dans une retraite si sévère qu’elle pourrait se comparer à celle d’un couvent, n’étant vue de personne, à ce que j’imaginais, si ce n’est des gens de la maison, car les jours que j’allais à la messe, c’était de si grand matin, accompagnée de ma mère et de mes femmes, si bien voilée d’ailleurs et si timide, qu’à peine mes yeux voyaient plus de terre que n’en foulaient mes pieds. Et néanmoins les yeux de l’amour, ou de l’oisiveté, pour mieux dire, plus perçants que ceux du lynx, me livrèrent aux poursuites de don Fernand. C’est le nom du second fils de ce duc dont je vous ai parlé.»
À peine ce nom de don Fernand fut-il sorti de la bouche de celle qui racontait son histoire, que Cardénio changea de visage et se mit à frémir de tout son corps avec une si visible altération, que le curé et le barbier, ayant jeté les yeux sur lui, craignirent qu’il ne fût pris de ces accès de folies dont ils avaient ouï dire qu’il était de temps en temps attaqué. Mais Cardénio, pourtant, ne fit pas autre chose que de suer et de trembler, sans bouger de place, et d’attacher fixement ses regards sur la belle paysanne, imaginant bien qui elle était. Celle-ci, sans prendre garde aux mouvements convulsifs de Cardénio, continua de la sorte son récit:
«Ses yeux ne m’eurent pas plutôt aperçue, qu’il se sentit, comme il le dit ensuite, enflammé de ce violent amour dont il donna bientôt des preuves. Mais, pour arriver plus vite au terme de l’histoire de mes malheurs, je veux passer sous silence les démarches que fit don Fernand pour me déclarer ses désirs. Il suborna tous les gens de ma maison, il fit mille cadeaux et offrit mille faveurs à mes parents; les jours étaient de perpétuelles fêtes dans la rue que j’habitais, et, pendant la nuit, les sérénades ne laissaient dormir personne; les billets en nombre infini qui, sans que je susse comment, parvenaient en mes mains, étaient remplis d’amoureux propos, et contenaient moins de syllabes que de promesses et de serments. Tout cela, cependant, loin de m’attendrir, m’endurcissait, comme s’il eût été mon plus mortel ennemi, et que tous les efforts qu’il faisait pour me séduire, il les eût faits pour m’irriter. Ce n’est pas que je ne reconnusse tout le mérite personnel de don Fernand, et que je tinsse à outrage les soins qu’il me rendait; j’éprouvais, au contraire, je ne sais quel contentement à me voir estimée et chérie par un si noble cavalier, et je n’avais nul déplaisir à lire mes louanges dans ses lettres: car il me semble qu’à nous autres femmes, quelque laides que nous soyons, il est toujours doux de nous entendre appeler jolies. Mais ce qui m’empêchait de fléchir, c’était le soin de mon honneur, c’étaient les continuels conseils que me donnaient mes parents, lesquels avaient bien facilement découvert l’intention de don Fernand, qui ne se mettait d’ailleurs point en peine que tout le monde la connût. Ils me disaient qu’en ma vertu seule reposaient leur honneur et leur considération; que je n’avais qu’à mesurer la distance qui me séparait de don Fernand, pour reconnaître que ses vues, bien qu’il dît le contraire, se dirigeaient plutôt vers son plaisir que vers mon intérêt; ils ajoutaient que si je voulais y mettre un obstacle et l’obliger à cesser ses offensantes poursuites, ils étaient prêts à me marier sur-le-champ avec qui je voudrais choisir non-seulement dans notre ville, mais dans celles des environs, puisqu’on pouvait tout espérer de leur grande fortune et de ma bonne renommée. Ces promesses et leurs avis, dont je sentais la justesse, fortifiaient si bien ma résolution, que jamais je ne voulus répondre à don Fernand un mot qui pût lui montrer, même au loin, l’espérance de voir ses prétentions satisfaites. Toutes ces précautions de ma vigilance, qu’il prenait sans doute pour des dédains, durent enflammer davantage ses coupables désirs; c’est le seul nom que je puisse donner à l’amour qu’il me témoignait, car, s’il eût été ce qu’il devait être, je n’aurais pas eu l’occasion de vous en parler à cette heure. Finalement, don Fernand apprit que mes parents cherchaient à m’établir, afin de lui ôter l’espoir de me posséder, ou du moins que j’eusse plus de gardiens pour me défendre. Cette nouvelle ou ce soupçon suffit pour lui faire entreprendre ce que je vais vous raconter.
Читать дальше