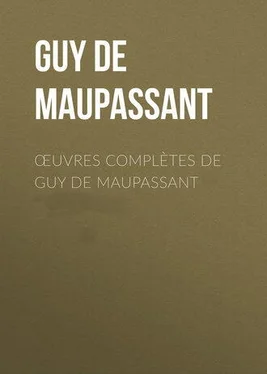C’était un grand garçon à moustaches rousses, un peu chauve déjà, taillé en officier, avec des allures anglaises de sportsman. On sentait, à le voir, un de ces hommes dont tous les membres sont plus exercés que la tête, et qui n’ont d’amour que pour les choses où se développent la force et l’activité physiques. Il était instruit pourtant, car il avait appris et il apprenait encore chaque jour, avec une grande tension d’esprit, tout ce qu’il lui serait utile de savoir plus tard : l’histoire, en s’acharnant sur les dates et en se méprenant sur les enseignements des faits, et les notions élémentaires d’économie politique nécessaires à un député, l’ABC de la sociologie à l’usage des classes dirigeantes.
Musadieu l’estimait, disant : « Ce sera un homme de valeur. » Bertin appréciait son adresse et sa vigueur. Ils allaient à la même salle d’armes, chassaient ensemble souvent, et se rencontraient à cheval dans les allées du bois. Entre eux était née une sympathie de goûts communs, cette franc-maçonnerie instinctive que crée entre deux hommes un sujet de conversation tout trouvé, agréable à l’un comme à l’autre.
Quand on présenta le marquis à Annette de Guilleroy, il eut brusquement le soupçon des combinaisons de sa tante, et, après s’être incliné, il la parcourut d’un regard rapide d’amateur.
Il la jugea gentille, et surtout pleine de promesses, car il avait tant conduit de cotillons qu’il s’y connaissait en jeunes filles et pouvait prédire presque à coup sûr l’avenir de leur beauté, comme un expert qui goûte un vin trop vert.
Il échangea seulement avec elle quelques phrases insignifiantes, puis s’assit auprès de la baronne de Corbelle, afin de potiner à mi-voix.
On se retira de bonne heure, et quand tout le monde fut parti, l’enfant couchée, les lampes éteintes, les domestiques remontés en leurs chambres, le comte de Guilleroy, marchant à travers le salon, éclairé seulement par deux bougies, retint longtemps la comtesse ensommeillée sur un fauteuil, pour développer ses espérances, détailler l’attitude à garder, prévoir toutes les combinaisons, les chances et les précautions à prendre.
Il était tard quand il se retira, ravi d’ailleurs de sa soirée, et murmurant :
« Je crois bien que c’est une affaire faite… »
Quand viendrez-vous, mon ami ? Je ne vous ai pas aperçu depuis trois jours, et cela me semble long. Ma fille m’occupe beaucoup, mais vous savez que je ne peux plus me passer de vous.
Le peintre, qui crayonnait des esquisses, cherchant toujours un sujet nouveau, relut le billet de la comtesse, puis ouvrant le tiroir d’un secrétaire, il l’y déposa sur un amas d’autres lettres entassées là depuis le début de leur liaison.
Ils s’étaient accoutumés, grâce aux facilités de la vie mondaine, à se voir presque chaque jour. De temps en temps, elle venait chez lui, et le laissant travailler, s’asseyait pendant une heure ou deux dans le fauteuil où elle avait posé jadis. Mais comme elle craignait un peu les remarques des domestiques, elle préférait pour ces rencontres quotidiennes, pour cette petite monnaie de l’amour, le recevoir chez elle, ou le retrouver dans un salon.
On arrêtait un peu d’avance ces combinaisons, qui semblaient toujours naturelles à M. de Guilleroy.
Deux fois par semaine au moins le peintre dînait chez la comtesse avec quelques amis ; le lundi, il la saluait régulièrement dans sa loge à l’Opéra ; puis ils se donnaient rendez-vous dans telle ou telle maison, où le hasard les amenait à la même heure. Il savait les soirs où elle ne sortait pas, et il entrait alors prendre une tasse de thé chez elle, se sentant chez lui près de sa robe, si tendrement et si sûrement logé dans cette affection mûrie, si capturé par l’habitude de la trouver quelque part, de passer à côté d’elle quelques instants, d’échanger quelques paroles, de mêler quelques pensées, qu’il éprouvait, bien que la flamme vive de sa tendresse fût depuis longtemps apaisée, un besoin incessant de la voir.
Le désir de la famille, d’une maison animée, habitée, du repas en commun, des soirées où l’on cause sans fatigue avec des gens depuis longtemps connus, ce désir du contact, du coudoiement, de l’intimité qui sommeille en tout cœur humain, et que tout vieux garçon promène, de porte en porte, chez ses amis où il installe un peu de lui, ajoutait une force d’égoïsme à ses sentiments d’affection. Dans cette maison où il était aimé, gâté, où il trouvait tout, il pouvait encore reposer et dorloter sa solitude.
Depuis trois jours il n’avait pas revu ses amis, que le retour de leur fille devait agiter beaucoup, et il s’ennuyait déjà, un peu fâché même qu’ils ne l’eussent point appelé plus tôt, et mettant une certaine discrétion à ne les point solliciter le premier.
La lettre de la comtesse le souleva comme un coup de fouet. Il était trois heures de l’après-midi. Il se décida immédiatement à se rendre chez elle pour la trouver avant qu’elle sortît.
Le valet de chambre parut, appelé par un coup de sonnette.
« Quel temps, Joseph ?
— Très beau, Monsieur.
— Chaud ?
— Oui, Monsieur.
— Gilet blanc, jaquette bleue, chapeau gris. »
Il avait toujours une tenue très élégante ; mais bien qu’il fût habillé par un tailleur au style correct, la façon seule dont il portait ses vêtements, dont il marchait, le ventre sanglé dans un gilet blanc, le chapeau de feutre gris, haut de forme, un peu rejeté en arrière, semblait révéler tout de suite qu’il était artiste et célibataire.
Quand il arriva chez la comtesse, on lui dit qu’elle se préparait à faire une promenade au bois. Il fut mécontent et attendit.
Selon son habitude, il se mit à marcher à travers le salon, allant d’un siège à l’autre ou des fenêtres aux murs, dans la grande pièce assombrie par les rideaux. Sur les tables légères, aux pieds dorés, des bibelots de toutes sortes, inutiles, jolis et coûteux, traînaient dans un désordre cherché. C’étaient de petites boîtes anciennes en or travaillé, des tabatières à miniatures, des statuettes d’ivoire, puis des objets en argent mat tout à fait modernes, d’une drôlerie sévère, où apparaissait le goût anglais : un minuscule poêle de cuisine, et dessus, un chat buvant dans une casserole, un étui à cigarettes, simulant un gros pain, une cafetière pour mettre des allumettes, et puis dans un écrin toute une parure de poupée, colliers, bracelets, bagues, broches, boucles d’oreilles avec des brillants, des saphirs, des rubis, des émeraudes, microscopique fantaisie qui semblait exécutée par des bijoutiers de Lilliput.
De temps en temps, il touchait un objet, donné par lui, à quelque anniversaire, le prenait, le maniait, l’examinait avec une indifférence rêvassante, puis le remettait à sa place.
Dans un coin, quelques livres rarement ouverts, reliés avec luxe, s’offraient à la main sur un guéridon porté par un seul pied, devant un petit canapé de forme ronde. On voyait aussi sur ce meuble La Revue des Deux Mondes, un peu fripée, fatiguée, avec des pages cornées, comme si on l’avait lue et relue, puis d’autres publications non coupées, Les Arts modernes, qu’on doit recevoir uniquement à cause du prix, l’abonnement coûtant quatre cents francs par an, et La Feuille libre, mince plaquette à couverture bleue, où se répandent les poètes les plus récents qu’on appelle les « Énervés ».
Entre les fenêtres, le bureau de la comtesse, meuble coquet du dernier siècle, sur lequel elle écrivait les réponses aux questions pressées apportées pendant les réceptions. Quelques ouvrages encore sur ce bureau les livres familiers, enseigne de l’esprit et du cœur dé la femme : Musset, Manon Lescaut, Werther ; et pour montrer qu’on n’était pas étranger aux sensations compliquées et aux mystères de la psychologie, Les Fleurs du mal, Le Rouge et le Noir, La Femme au XVIIIe siècle, Adolphe.
Читать дальше