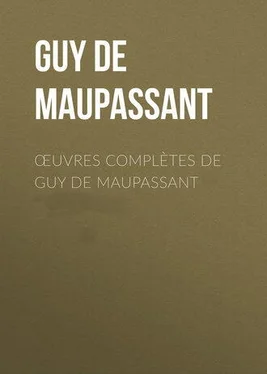Mais Nanette ne se montra pas encore enthousiaste.
« Oh ! fit-elle, elle n’est plus bien fraîche. »
Bertin qui d’ordinaire dans les discussions quotidiennement revenues sur ces deux rivales, ne soutenait point la comtesse, se fâcha soudain de cette intolérance de gamine.
« Bigre, dit-il, qu’on l’aime plus ou moins, elle est charmante, et je te souhaite de devenir aussi jolie qu’elle.
— Laissez donc, reprit la duchesse, vous remarquez seulement les femmes quand elles ont passé trente ans. Elle a raison, cette enfant, vous ne les vantez que défraîchies. »
Il s’écria :
« Permettez, une femme n’est vraiment belle que tard, lorsque toute son expression est sortie. »
Et développant cette idée que la première fraîcheur n’est que le vernis de la beauté qui mûrit, il prouva que les hommes du monde ne se trompent pas en faisant peu d’attention aux jeunes femmes dans tout leur éclat, et qu’ils ont raison de ne les proclamer « belles » qu’à la dernière période de leur épanouissement.
La comtesse flattée, murmurait :
« Il est dans le vrai, il juge en artiste. C’est très gentil, un jeune visage, mais toujours un peu banal. »
Et le peintre insista, indiquant à quel moment une figure, perdant peu à peu la grâce indécise de la jeunesse, prend sa forme définitive, son caractère, sa physionomie.
Et, à chaque parole, la comtesse faisait « oui » d’un petit balancement de tête convaincu ; et plus il affirmait, avec une chaleur d’avocat qui plaide, avec une animation de suspect qui soutient sa cause, plus elle l’approuvait du regard et du geste, comme s’ils se fussent alliés pour se soutenir contre un danger, pour se défendre contre une opinion menaçante et fausse. Annette ne les écoutait guère, tout occupée à regarder. Sa figure souvent rieuse était devenue grave, et elle ne disait plus rien, étourdie de joie dans ce mouvement. Ce soleil, ces feuilles, ces voitures, cette belle vie riche et gaie, tout cela c’était pour elle.
Tous les jours, elle pourrait venir ainsi, connue à son tour, saluée, enviée ; et des hommes, en la montrant, diraient peut-être qu’elle était belle. Elle cherchait ceux et celles qui lui paraissaient les plus élégants, et demandait toujours leurs noms, sans s’occuper d’autre chose que de ces syllabes assemblées qui, parfois, éveillaient en elle un écho de respect et d’admiration, quand elle les avait lues souvent dans les journaux ou dans l’histoire. Elle ne s’accoutumait pas à ce défilé de célébrités, et ne pouvait même croire tout à fait qu’elles fussent vraies, comme si elle eût assisté à quelque représentation. Les fiacres lui inspiraient un mépris mêlé de dégoût, la gênaient et l’irritaient, et elle dit soudain :
« Je trouve qu’on ne devrait laisser venir ici que les voitures de maître. »
Bertin répondit :
« Eh bien ! Mademoiselle, que fait-on de l’égalité, de la liberté et de la fraternité ? »
Elle eut une moue qui signifiait « à d’autres » et reprit :
« Il y aurait un bois pour les fiacres, celui de Vincennes, par exemple.
— Tu retardes, petite, et tu ne sais pas encore que nous nageons en pleine démocratie. D’ailleurs, si tu veux voir le bois pur de tout mélange, viens le matin, tu n’y trouveras que la fleur, la fine fleur de la société. »
Et il fit un tableau, un de ceux qu’il peignait si bien, du bois matinal avec ses cavaliers et ses amazones, de ce club des plus choisis où tout le monde se connaît par ses noms, petits noms, parentés, titres, qualités et vices, comme si tous vivaient dans le même quartier ou dans la même petite ville.
« Y venez-vous souvent ? dit-elle.
— Très souvent ; c’est vraiment ce qu’il y a de plus charmant à Paris.
— Vous montez à cheval, le matin !
— Mais oui.
— Et puis, l’après-midi, vous faites des visites ?
— Oui.
— Alors, quand est-ce que vous travaillez ?
— Mais je travaille… quelquefois, et puis j’ai choisi une spécialité suivant mes goûts ! Comme je suis peintre de belles dames, il faut bien que je les voie et que je les suive un peu partout. »
Elle murmura, toujours sans rire :
« À pied et à cheval ? »
Il jeta vers elle un regard oblique et satisfait, qui semblait dire : Tiens, tiens, déjà de l’esprit, tu seras très bien, toi.
Un souffle d’air froid passa, venu de très loin, de la grande campagne à peine éveillée encore ; et le bois entier frémit, ce bois coquet, frileux et mondain.
Pendant quelques secondes ce frisson fit trembler les maigres feuilles sur les arbres et les étoffes sur les épaules. Toutes les femmes, d’un mouvement presque pareil, ramenèrent sur leurs bras et sur leur gorge le vêtement tombé derrière elles, et les chevaux se mirent à trotter d’un bout à l’autre de l’allée, comme si la brise aigre, qui accourait, les eût fouettés en les touchant.
On rentra vite au milieu d’un bruit argentin de gourmettes secouées, sous une ondée oblique et rouge du soleil couchant.
« Est-ce que vous retournez chez vous ? » dit la comtesse au peintre, dont elle savait toutes les habitudes.
« Non, je vais au Cercle.
— Alors, nous vous déposons en passant ?
— Ça me va, merci bien.
— Et quand nous invitez-vous à déjeuner avec la duchesse ?
— Dites votre jour ? »
Ce peintre attitré des Parisiennes, que ses admirateurs avaient baptisé « un Watteau réaliste » et que ses détracteurs appelaient « photographe de robes et manteaux », recevait souvent, soit à déjeuner, soit à dîner, les belles personnes dont il avait reproduit les traits, et d’autres encore, toutes les célèbres, toutes les connues, qu’amusaient beaucoup ces petites fêtes dans un hôtel de garçon.
« Après-demain ! Ça vous va-t-il, après-demain, ma chère duchesse ? demanda Mme de Guilleroy.
— Mais oui, vous êtes charmante ! M. Bertin ne pense jamais à moi, pour ces parties-là. On voit bien que je ne suis plus jeune. »
La comtesse, habituée à considérer la maison de l’artiste un peu comme la sienne, reprit :
« Rien que nous quatre, les quatre du landau, la duchesse, Annette, moi et vous, n’est-ce pas, grand artiste ?
— Rien que nous, dit-il en descendant, et je vous ferai faire des écrevisses à l’alsacienne.
— Oh ! Vous allez donner des passions à la petite. »
Il saluait, debout à la portière, puis il entra vivement dans le vestibule de la grande porte du Cercle, jeta son pardessus et sa canne à la compagnie de valets de pied qui s’étaient levés comme des soldats au passage d’un officier, puis il monta le large escalier, passa devant une autre brigade de domestiques en culottes courtes, poussa une porte et se sentit soudain alerte comme un jeune homme en entendant, au bout du couloir, un bruit continu de fleurets heurtés, d’appels de pied, d’exclamations lancées par des voix fortes : « Touché. – À moi. – Passé. – J’en ai. – Touché. – À vous. »
Dans la salle d’armes, les tireurs, vêtus de toile grise, avec leur veste de peau, leurs pantalons serrés aux chevilles, une sorte de tablier tombant sur le ventre, un bras en l’air, la main repliée, et dans l’autre main rendue énorme par le gant, le mince et souple fleuret, s’allongeaient et se redressaient avec une brusque souplesse de pantins mécaniques.
D’autres se reposaient, causaient, encore essoufflés, rouges, en sueur, un mouchoir à la main pour éponger leur front et leur cou ; d’autres, assis sur le divan carré qui faisait le tour de la grande salle, regardaient les assauts. Liverdy contre Landa, et le maître du Cercle, Taillade, contre le grand Rocdiane.
Bertin, souriant, chez lui, serrait les mains.
Читать дальше