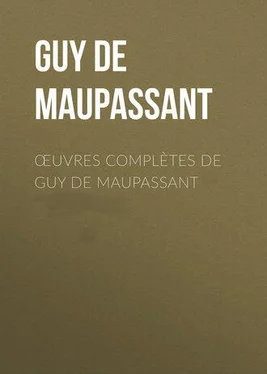Guy de Maupassant - L'Angélus (1895)
Здесь есть возможность читать онлайн «Guy de Maupassant - L'Angélus (1895)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:L'Angélus (1895)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
L'Angélus (1895): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «L'Angélus (1895)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
L'Angélus (1895) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «L'Angélus (1895)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Des pas pesants montèrent bientôt l'escalier, ceux de plusieurs hommes, et, de nouveau, on heurta sa porte.
Elle demanda :
— Qui est là ?
Une voix étrangère prononça :
— Un officier prussien.
— Entrez, dit-elle.
Un jeune homme de grande taille se présente, salua, et, en bon français, presque sans accent :
— Je vous prie de m'excuser, Madame, si j'exécute l'ordre de mon supérieur, qui m'a chargé de vous amener près de lui. Voulez-vous descendre de bonne grâce ? C'est ce que vous avez de mieux à faire, et pour vous, et pour nous.
Elle hésita une seconde, puis :
— Oui, Monsieur, je vous suis.
Et, appelant son domestique debout derrière l'officier :
— Prenez le petit dans vos bras et suivez-moi. Je ne veux pas nous séparer.
L'homme obéit et la suivit, portant son fils. Alors elle passa devant le Prussien et descendit à pas lents, gênée par sa taille, se soutenant à la rampe, et Annette demeura seule dans la chambre, trop paralysée de terreur pour faire le moindre mouvement.
En arrivant à l'entrée du salon elle aperçut sept ou huit officiers, installés déjà comme chez eux, la troupe étant au village. Ils fumaient, allongés dans les fauteuils, les sabres jetés sur la table, sur les livres, sur les poètes, tandis que deux plantons gardaient la porte.
Du premier coup d'œil elle distingua le chef, le dos au feu, une semelle levée à la flamme. Il avait gardé sa casquette d'uniforme, et dans sa figure poilue de barbe rousse semblaient luire la joie de la victoire et le plaisir d'avoir chaud.
En la voyant entrer il fit de la main un léger salut militaire sans se découvrir, impertinent et bref, puis il dit avec cette prononciation allemande qui parait grasse de choucroute et de saucisse :
— Fous êtes la tame de ce château ?
Elle était debout devant lui, sans avoir rendu son insolent salut, et elle répondit un "oui" si sec que tous les yeux allèrent de la femme au soldat.
Il ne s'émut pas et reprit :
— Gompien êtes-fous de bersonnes ici ?
— J'ai deux vieux domestiques, trois bonnes et trois valets de ferme.
— Fotre mari, qu'est-ce qu'il fait ? où est-il ?
Elle répondit hardiment :
— Il est soldat, comme vous ; et il se bat.
L'officier répliqua avec insolence :
— Eh pien ! Il est battu alors.
Et il rit d'un gros rire barbu. Puis, quand il eut ri, deux ou trois rirent, aussi lourdement, avec des timbres différents, qui donnaient la note des gaietés teutonnes. Les autres se taisaient en examinant avec attention cette Française courageuse.
Alors elle dit, bravant le chef d'un regard intrépide :
— Monsieur, vous n'êtes pas un gentilhomme, pour venir insulter une femme chez elle, comme vous faites.
— Un grand silence suivit, assez long, terrible. Le soldat germain demeurait impassible, riant toujours, en maître qui peut tout vouloir à son gré.
— Mais non, dit-il, fous n'êtes pas chez fous ; fous êtes chez nous. Il n'y a plus bersonne chez lui en France. Et il rit encore, avec la certitude ravie d'affirmer là une vérité incontestable et stupéfiante.
Elle répondit exaspérée :
— La violence n'est pas un droit. C'est un forfait. Vous n'êtes pas plus chez vous qu'un voleur dans la maison dévalisée.
Une colère s'alluma dans les yeux du Prussien.
— Che fas fous proufer que c'est fous qui n'êtes pas chez fous. Car je fous ordonne de quitter cette maison, ou pien je fous en fais chasser.
Au bruit de cette voix méchante, dure et forte, le petit Henri, plus surpris jusque-là qu'effrayé par ces hommes, se mit à pousser des cris perçants.
En entendant pleurer l'enfant, la comtesse perdit la tête et l'idée des brutalités auxquelles cette soldatesque se pouvait livrer, des dangers que son cher petit pouvait courir, lui mit au cœur subitement l'envie folle, irrésistible, de s'en aller, de fuir n'importe où, dans une chaumière du village. On la jetait dehors. Tant mieux !
Chapitre I
(Portrait du Docteur Paturel fils)
Sa figure rappelait un peu le masque maigre de Voltaire et de Bonaparte. Il avait le nez coupant, courbé, aigu, pointu, la mâchoire forte, aux os saillants sous les oreilles, et le menton effilé ; un œil gris pâle, avec la tache noire de la pupille au milieu, et un tel air d'autorité dans sa parole et dans ses démonstrations professionnelles qu'il inspirait à tout le monde une grande confiance. Il rétablit des gens réputés depuis longtemps inguérissables, des rhumatisants, des ankylosés des champs, les infirmes de l'humidité, par des méthodes d'hygiène, de nourriture et d'exercice, et des poudres qui leur redonnaient faim ; il guérit les plaies anciennes avec les antiseptiques nouveaux, et persécuta le microbe selon les procédés les plus récents. Puis, quand il avait soigné un malade, il semblait laisser derrière lui de la propreté dans la maison. Il prospéra, on l'appelait de très loin, et l'argent vint, car il y tenait, réglant le prix des visites selon les distances et les fortunes.
(Dialogue du Docteur Paturel fils, de l'abbé Marvaux et d'André, second fils infirme de Mme de Brémontal)
— Vous êtes le premier médecin du département... la fortune, tout.
— Mais j'habite ici, dit-il, j'y ronge, j'y perds ma vie ; tout ce que j'aime et tout ce que je souhaite, je ne l'ai pas. Ah ! Paris, Paris !... Est-ce que je peux travailler pour moi, ici, travailler pour la science ? Ai-je les laboratoires, les hôpitaux, les sujets rares, toutes les maladies inconnues et connues du monde entier sous les yeux ? Puis-je faire des expériences, des rapports, devenir membre de l'Académie de médecine ? Ici, je n'ai rien, ni avenir, ni distractions, ni plaisir, ni femme à épouser ou à aimer, ni gloire à cueillir, rien, rien que la gloire d'arrondissement. Je guéris, oui, je guéris du peuple, des bourgeois avares qui paient en argent, parfois en or, et jamais en billets. Je guéris la petite misère du commun des hommes, mais jamais les princes, les ambassadeurs, les ministres, les grands artistes, dont la cure retentissante est répétée jusqu'aux cours étrangères. Je soigne et je guéris, en un mot, au fond d'une province, le rebut de l'humanité.
Le prêtre l'écoutait d'un air un peu crispé, un peu fâché. Il murmura :
— C'est peut-être plus noble et plus grand, et plus beau.
Mais le médecin, rageur, reprit :
— Je ne vis pas pour les autres, je vis pour moi, Monsieur le curé.
L'abbé sentit tressaillir son âme d'apôtre. Il ajouta :
— Le Christ est mort pour les petits.
Et le médecin grogna :
— Mais je ne suis pas le Christ, nom d'un chien ! Je suis le Docteur Paturel, agrégé de la Faculté de médecine de Paris.
L'abbé, calmé, répondis ayant passé en quelques secondes par un cycle d'idées, touchant presque aux limites de la pensée humaine, car il aperçut toutes les grandeurs et toutes les petitesses de l'idéal. Et il conclut :
— Vous avez peut-être raison. A votre point de vue, vous êtes dans le vrai. Et pour vous, c'est le seul bon.
— Parbleu ! jeta le médecin d'une voix claire, qui sonna dans l'air sec.
Puis le prêtre ajouta :
— Vous êtes pourtant un grand cœur, car vous restez ici pour votre mère.
Le docteur tressaillit ; on avait touché sa plaie, sa peine, sa tendresse intimes.
— Oui, je ne la quitterai jamais.
Leurs yeux tombèrent ensemble sur l'infirme qui les écoutait de toutes ses oreilles et les comprenait très bien.
Et les regards des deux hommes s'étant rencontrés ensuite se dirent des choses mystérieuses sur la destinée et l'avenir de cet enfant, en les comparant aux leurs. C'était lui le misérable.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «L'Angélus (1895)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «L'Angélus (1895)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «L'Angélus (1895)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.