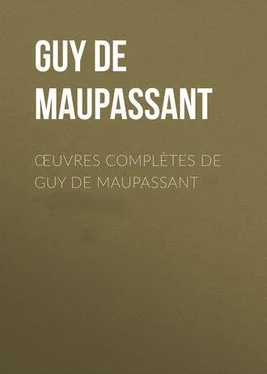Soudain, elle se rappela le grenier, où on pouvait monter du dehors par une échelle. Assurément, il s’était caché là pour la surprendre. Il avait dû, gardé par des sauvages sur quelque côte, ne pouvoir s’échapper plus tôt, et il était revenu, plus méchant que jamais. Elle n’en pouvait douter, rien qu’au timbre de sa voix.
Elle demanda, la tête levée vers le plafond :
— T’es-ti là-haut, Patin ?
Patin ne répondit pas.
Alors elle sortit et, avec une peur affreuse qui lui secouait le cœur, elle monta l’échelle, ouvrit la lucarne, regarda, ne vit rien, entra, chercha et ne trouva pas.
Assise sur une botte de paille, elle se mit à pleurer ; mais, pendant qu’elle sanglotait, traversée d’une terreur poignante et surnaturelle, elle entendit, dans sa chambre, au-dessous d’elle, Patin qui racontait des choses. Il semblait moins en colère, plus tranquille, et il disait :
— Sale temps ! – Gros vent ! – Sale temps ! – J’ai pas déjeuné, nom d’un nom !
Elle cria à travers le plafond :
— Me v’là, Patin ; j’vas te faire la soupe. Te fâche pas, j’arrive.
Et elle redescendit en courant.
Il n’y avait personne chez elle.
Elle se sentit défaillir comme si la Mort la touchait, et elle allait se sauver pour demander secours aux voisins, quand la voix, tout près de son oreille, cria :
— J’ai pas déjeuné, nom d’un nom !
Et le perroquet, dans sa cage, la regardait de son œil rond, sournois et mauvais.
Elle aussi, le regarda, éperdue, murmurant :
— Ah ! c’est toi !
Il reprit, en remuant sa tête :
— Attends, attends, attends, je vas t’apprendre à fainéanter !
Que se passa-t-il en elle ? Elle sentit, elle comprit que c’était bien lui, le mort, qui revenait, qui s’était caché dans les plumes de cette bête pour recommencer à la tourmenter, qu’il allait jurer, comme autrefois, tout le jour, et la mordre, et crier des injures pour ameuter les voisins et les faire rire. Alors elle se rua, ouvrit la cage, saisit l’oiseau qui, se défendant, lui arrachait la peau avec son bec et avec ses griffes. Mais elle le tenait de toute sa force, à deux mains, et, se jetant par terre, elle se roula dessus avec une frénésie de possédée, l’écrasa, en fit une loque de chair, une petite chose molle, verte, qui ne remuait plus, qui ne parlait plus, et qui pendait ; puis, l’ayant enveloppée d’un torchon comme d’un linceul, elle sortit, en chemise, nu-pieds, traversa le quai, que la mer battait de courtes vagues, et, secouant le linge, elle laissa tomber dans l’eau cette petite chose morte qui ressemblait à un peu d’herbe ; puis elle rentra, se jeta à genoux devant la cage vide, et, bouleversée de ce qu’elle avait fait, demanda pardon au bon Dieu, en sanglotant, comme si elle venait de commettre un horrible crime.
Un bon ménage, le ménage Bondel, bien qu’un peu guerroyant. On se querellait souvent, pour des causes futiles, puis on se réconciliait.
Ancien commerçant retiré des affaires après avoir amassé de quoi vivre selon ses goûts simples, Bondel avait loué à Saint-Germain un petit pavillon et s’était gîté là, avec sa femme.
C’était un homme calme, dont les idées, bien assises, se levaient difficilement. Il avait de l’instruction, lisait des journaux graves et appréciait cependant l’esprit gaulois. Doué de raison, de logique, de ce bon sens pratique qui est la qualité maîtresse de l’industrieux bourgeois français, il pensait peu, mais sûrement, et ne se décidait aux résolutions qu’après des considérations que son instinct lui révélait infaillibles.
C’était un homme de taille moyenne, grisonnant, à la physionomie distinguée.
Sa femme, pleine de qualités sérieuses, avait aussi quelques défauts. D’un caractère emporté, d’une franchise d’allures qui touchait à la violence, et d’un entêtement invincible, elle gardait contre les gens des rancunes inapaisables. Jolie autrefois, puis devenue trop grosse, trop rouge, elle passait encore, dans leur quartier, à Saint-Germain, pour une très belle femme, qui représentait la santé avec un air pas commode.
Leurs dissentiments, presque toujours, commençaient au déjeuner, au cours de quelque discussion sans importance, puis jusqu’au soir, souvent jusqu’au lendemain ils demeuraient fâchés. Leur vie si simple, si bornée, donnait de la gravité à leurs préoccupations les plus légères, et tout sujet de conversation devenait un sujet de dispute. Il n’en était pas ainsi jadis, lorsqu’ils avaient des affaires qui les occupaient, qui mariaient leurs soucis, serraient leurs cœurs, les enfermant et les retenant pris ensemble dans le filet de l’association et de l’intérêt commun.
Mais à Saint-Germain on voyait moins de monde. Il avait fallu refaire des connaissances, se créer, au milieu d’étrangers, une existence nouvelle toute vide d’occupations. Alors, la monotonie des heures pareilles les avait un peu aigris l’un et l’autre ; et le bonheur tranquille, espéré, attendu avec l’aisance, n’apparaissait pas.
Ils venaient de se mettre à table, par un matin du mois de juin, quand Bondel demanda :
— Est-ce que tu connais les gens qui demeurent dans ce petit pavillon rouge au bout de la rue du Berceau ?
Mme Bondel devait être mal levée. Elle répondit :
— Oui et non, je les connais, mais je ne tiens pas à les connaître.
— Pourquoi donc ? Ils ont l’air très gentils.
— Parce que…
— J’ai rencontré le mari ce matin sur la terrasse et nous avons fait deux tours ensemble.
Comprenant qu’il y avait du danger dans l’air, Bondel ajouta :
— C’est lui qui m’a abordé et parlé le premier.
La femme le regardait avec mécontentement. Elle reprit :
— Tu aurais aussi bien fait de l’éviter.
— Mais pourquoi donc ?
— Parce qu’il y a des potins sur eux.
— Quels potins ?
— Quels potins ! Mon Dieu, des potins comme on en fait souvent.
M. Bondel eut le tort d’être un peu vif.
— Ma chère amie, tu sais que j’ai horreur des potins. Il me suffit qu’on en fasse pour me rendre les gens sympathiques. Quant à ces personnes, je les trouve fort bien, moi.
Elle demanda, rageuse :
— La femme aussi, peut-être ?
— Mon Dieu, oui, la femme aussi, quoique je l’aie à peine aperçue.
Et la discussion continua, s’envenimant lentement, acharnée sur le même sujet, par pénurie d’autres motifs.
Mme Bondel s’obstinait à ne pas dire quels potins couraient sur ces voisins, laissant entendre de vilaines choses, sans préciser. Bondel haussait les épaules, ricanait, exaspérait sa femme. Elle finit par crier :
— Eh bien ! Ce monsieur est cornard, voilà !
Le mari répondit sans s’émouvoir :
— Je ne vois pas en quoi cela atteint l’honorabilité d’un homme ?
Elle parut stupéfaite.
— Comment, tu ne vois pas ?… tu ne vois pas ?… elle est trop forte, en vérité… tu ne vois pas ? Mais c’est un scandale public ; il est taré à force d’être cornard !
Il répondit :
— Ah ! Mais non ! Un homme serait taré parce qu’on le trompe, taré parce qu’on le trahit, taré parce qu’on le vole ?… Ah ! Mais non. Je te l’accorde pour la femme, mais pas pour lui.
Elle devenait furieuse.
— Pour lui comme pour elle. Ils sont tarés, c’est une honte publique.
Bondel, très calme, demanda :
— D’abord, est-ce vrai ? Qui peut affirmer une chose pareille tant qu’il n’y a pas flagrant délit.
Mme Bondel s’agitait sur son siège.
— Comment ? Qui peut affirmer ? Mais tout le monde ! Tout le monde ! Ça se voit comme les yeux dans le visage, une chose pareille. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il n’y a pas à douter. C’est notoire comme une grande fête.
Читать дальше