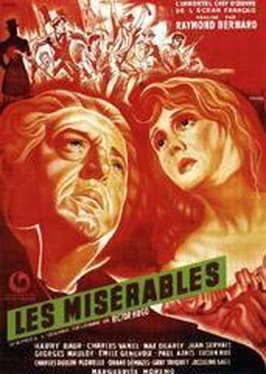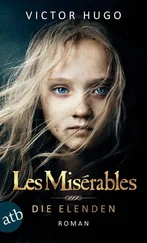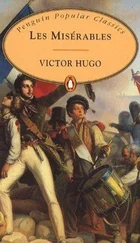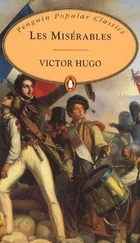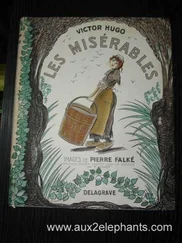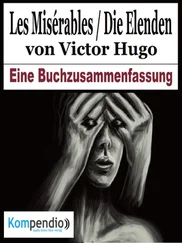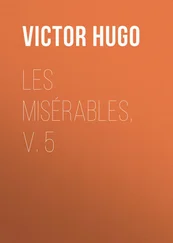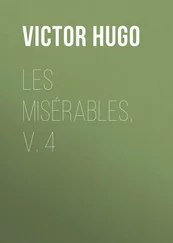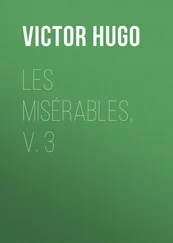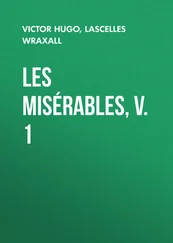Nous disons fentes étroites, et nous ne pouvons pas donner une plus juste idée de ces ruelles obscures, resserrées, anguleuses, bordées de masures à huit étages. Ces masures étaient si décrépites que, dans les rues de la Chanvrerie et de la Petite-Truanderie, les façades s’étayaient de poutres allant d’une maison à l’autre. La rue était étroite et le ruisseau large, le passant y cheminait sur le pavé toujours mouillé, côtoyant des boutiques pareilles à des caves, de grosses bornes cerclées de fer, des tas d’ordures excessifs, des portes d’allées armées d’énormes grilles séculaires. La rue Rambuteau a dévasté tout cela.
Le nom Mondétour peint à merveille les sinuosités de toute cette voirie. Un peu plus loin, on les trouvait encore mieux exprimées par la rue Pirouette qui se jetait dans la rue Mondétour.
Le passant qui s’engageait de la rue Saint-Denis dans la rue de la Chanvrerie la voyait peu à peu se rétrécir devant lui, comme s’il fût entré dans un entonnoir allongé. Au bout de la rue, qui était fort courte, il trouvait le passage barré du côté des halles par une haute rangée de maisons, et il se fût cru dans un cul-de-sac, s’il n’eût aperçu à droite et à gauche deux tranchées noires par où il pouvait s’échapper. C’était la rue Mondétour, laquelle allait rejoindre d’un côté la rue des Prêcheurs, de l’autre la rue du Cygne et la Petite-Truanderie. Au fond de cette espèce de cul-de-sac, à l’angle de la tranchée de droite, on remarquait une maison moins élevée que les autres et formant une sorte de cap sur la rue.
C’est dans cette maison, de deux étages seulement, qu’était allégrement installé depuis trois cents ans un cabaret illustre. Ce cabaret faisait un bruit de joie au lieu même que le vieux Théophile a signalé dans ces deux vers:
Là branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit [167] .
L’endroit étant bon, les cabaretiers s’y succédaient de père en fils.
Du temps de Mathurin Régnier, ce cabaret s’appelait le Pot-aux-Roses , et comme la mode était aux rébus, il avait pour enseigne un poteau peint en rose. Au siècle dernier, le digne Natoire, l’un des maîtres fantasques aujourd’hui dédaignés par l’école roide, s’étant grisé plusieurs fois dans ce cabaret à la table même où s’était soûlé Régnier, avait peint par reconnaissance une grappe de raisin de Corinthe sur le poteau rose. Le cabaretier, de joie, en avait changé son enseigne et avait fait dorer au-dessous de la grappe ces mots: au Raisin de Corinthe . De là ce nom, Corinthe . Rien n’est plus naturel aux ivrognes que les ellipses. L’ellipse est le zigzag de la phrase. Corinthe avait peu à peu détrôné le Pot-aux-Roses. Le dernier cabaretier de la dynastie, le père Hucheloup, ne sachant même plus la tradition, avait fait peindre le poteau en bleu.
Une salle en bas où était le comptoir, une salle au premier où était le billard, un escalier de bois en spirale perçant le plafond, le vin sur les tables, la fumée sur les murs, des chandelles en plein jour, voilà quel était le cabaret. Un escalier à trappe dans la salle d’en bas conduisait à la cave. Au second était le logis des Hucheloup. On y montait par un escalier, échelle plutôt qu’escalier, n’ayant pour entrée qu’une porte dérobée dans la grande salle du premier. Sous le toit, deux greniers mansardes, nids de servantes. La cuisine partageait le rez-de-chaussée avec la salle du comptoir.
Le père Hucheloup était peut-être né chimiste, le fait est qu’il fut cuisinier; on ne buvait pas seulement dans son cabaret, on y mangeait. Hucheloup avait inventé une chose excellente qu’on ne mangeait que chez lui, c’étaient des carpes farcies qu’il appelait carpes au gras . On mangeait cela à la lueur d’une chandelle de suif ou d’un quinquet du temps de Louis XVI sur des tables où était clouée une toile cirée en guise de nappe. On y venait de loin. Hucheloup avait, un beau matin, avait jugé à propos d’avertir les passants de sa «spécialité»; il avait trempé un pinceau dans un pot de noir, et comme il avait une orthographe à lui, de même qu’une cuisine à lui, il avait improvisé sur son mur cette inscription remarquable:
CARPES HO GRAS
Un hiver, les averses et les giboulées avaient eu la fantaisie d’effacer l’S qui terminait le premier mot et le G qui commençait le troisième; et il était resté ceci:
CARPE HO RAS [168]
Le temps et la pluie aidant, une humble annonce gastronomique était devenue un conseil profond.
De la sorte il s’était trouvé que, ne sachant pas le français, le père Hucheloup avait su le latin, qu’il avait fait sortir de la cuisine la philosophie, et que, voulant simplement effacer Carême, il avait égalé Horace. Et ce qui était frappant, c’est que cela aussi voulait dire: entrez dans mon cabaret.
Rien de tout cela n’existe aujourd’hui. Le dédale Mondétour était éventré et largement ouvert dès 1847, et probablement n’est plus à l’heure qu’il est. La rue de la Chanvrerie et Corinthe ont disparu sous le pavé de la rue Rambuteau.
Comme nous l’avons dit, Corinthe était un des lieux de réunion, sinon de ralliement, de Courfeyrac et de ses amis. C’est Grantaire qui avait découvert Corinthe. Il y était entré à cause de Carpe Horas et y était retourné à cause des Carpes au Gras . On y buvait, on y mangeait, on y criait; on y payait peu, on y payait mal, on n’y payait pas, on était toujours bienvenu. Le père Hucheloup était un bonhomme.
Hucheloup, bonhomme, nous venons de le dire, était un gargotier à moustaches; variété amusante. Il avait toujours la mine de mauvaise humeur, semblait vouloir intimider ses pratiques, bougonnait les gens qui entraient chez lui, et avait l’air plus disposé à leur chercher querelle qu’à leur servir la soupe. Et pourtant, nous maintenons le mot, on était toujours bienvenu. Cette bizarrerie avait achalandé sa boutique, et lui amenait des jeunes gens se disant: Viens donc voir maronner le père Hucheloup. Il avait été maître d’armes. Tout à coup il éclatait de rire. Grosse voix, bon diable. C’était un fond comique avec une apparence tragique; il ne demandait pas mieux que de vous faire peur; à peu près comme ces tabatières qui ont la forme d’un pistolet. La détonation éternue.
Il avait pour femme la mère Hucheloup, un être barbu, fort laid.
Vers 1830, le père Hucheloup mourut. Avec lui disparut le secret des carpes au gras. Sa veuve, peu consolable, continua le cabaret. Mais la cuisine dégénéra et devint exécrable, le vin, qui avait toujours été mauvais, fut affreux. Courfeyrac et ses amis continuèrent pourtant d’aller à Corinthe, – par piété, disait Bossuet.
La veuve Hucheloup était essoufflée et difforme avec des souvenirs champêtres. Elle leur ôtait la fadeur par la prononciation. Elle avait une façon à elle de dire les choses qui assaisonnait ses réminiscences villageoises et printanières. Ç’avait été jadis son bonheur, affirmait-elle, d’entendre «les loups-de-gorge chanter dans les ogrépines».
La salle du premier, où était le «restaurant» était une grande longue pièce encombrée de tabourets, d’escabeaux, de chaises, de bancs et de tables, et d’un vieux billard boiteux. On y arrivait par l’escalier en spirale qui aboutissait dans l’angle de la salle à un trou carré pareil à une écoutille de navire.
Cette salle, éclairée d’une seule fenêtre étroite et d’un quinquet toujours allumé, avait un air de galetas. Tous les meubles à quatre pieds se comportaient comme s’ils en avaient trois. Les murs blanchis à la chaux n’avaient pour tout ornement que ce quatrain en l’honneur de mame Hucheloup:
Читать дальше