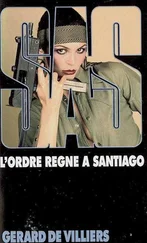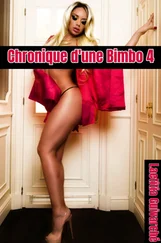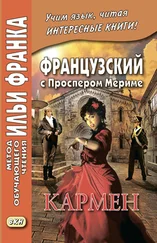– Que faites-vous, bon Dieu! disait Marguerite; tuer un homme! et un homme qui passe pour bon catholique encore, quoiqu’il n’en soit rien, comme il paraît assez!
– Je suppose, dit le jeune moine à son confrère, que des affaires pressantes vous appellent, ainsi que moi, à Beaugency. Voici le bateau. Hâtons-nous.
– Vous avez raison, et je vous suis.
Il essuya son poignard et le remit sous sa robe. Alors, les deux vaillants moines, ayant payé leur écot, s’acheminèrent de compagnie vers la Loire, laissant Bois-Dauphin entre les mains de Marguerite, qui commença par se payer en fouillant dans ses poches; puis elle s’occupa d’ôter les morceaux de verre dont sa figure était hérissée, afin de le panser suivant toutes les règles usitées par les commères en cas semblables.
– Je me trompe fort, ou je vous ai vu quelque part, dit le jeune homme au vieux cordelier.
– Le diable m’emporte si votre figure m’est inconnue! Mais…
– Quand je vous ai vu pour la première fois, il me semble que vous ne portiez pas cette robe.
– Et vous-même?
– Vous êtes le capitaine…
– Dietrich Hornstein, pour vous servir; et vous êtes le jeune gentilhomme avec qui j’ai dîné près d’Étampes.
– Lui-même.
– Vous vous nommez Mergy?
– Oui; mais ce n’est pas mon nom maintenant. Je suis le frère Ambroise.
– Et moi, le frère Antoine d’Alsace.
– Bien. Et vous allez?
– À la Rochelle, si je puis.
– Et moi de même.
– Je suis charmé de vous rencontrer… Mais, diable! vous m’avez furieusement embarrassé avec votre bénédicité. C’est que je n’en savais pas un mot; et moi, je vous prenais d’abord pour un moine, s’il en fut.
– Je vous en présente autant.
– D’où vous êtes-vous échappé?
– De Paris. Et vous?
– D’Orléans. J’ai été contraint de me cacher pendant plus de huit jours. Mes pauvres reîtres… mon cornette… sont dans la Loire.
– Et Mila?
– Elle s’est faite catholique.
– Et mon cheval, capitaine?
– Ah! votre cheval? J’ai fait passer par les verges le coquin de trompette qui vous l’avait dérobé… Mais, ne sachant où vous demeuriez, je n’ai pu vous le faire rendre… Et je le gardais en attendant l’honneur de vous rencontrer. Maintenant il appartient sans doute à quelque coquin de papiste.
– Chut! ne prononcez pas ce mot si haut. Allons, capitaine, unissons nos fortunes, et entr’aidons-nous comme nous venons de faire tout à l’heure.
– Je le veux; et, tant que Dietrich Hornstein aura une goutte de sang dans les veines, il sera prêt à jouer des couteaux à vos côtés.
Ils se serrèrent la main avec joie.
– Ah çà! dites-moi donc quelle diable d’histoire me sont-ils venus conter avec leurs poules et leur Carpam , Percham ? Il faut convenir que ces papaux sont une bien sotte espèce.
– Chut! encore une fois: voici le bateau.
En devisant de la sorte, ils arrivèrent au bateau où ils s’embarquèrent. Ils parvinrent à Beaugency sans autre accident que celui de rencontrer plusieurs cadavres de leurs coreligionnaires flottant sur la Loire.
Un batelier remarqua que la plupart étaient couchés sur le dos.
– Ils demandent vengeance au ciel, dit tout bas Mergy au capitaine des reîtres.
Dietrich lui serra la main sans répondre.
XXIV – LE SIÈGE DE LA ROCHELLE
La Rochelle, dont presque tous les habitants professaient la religion réformée, était alors comme la capitale des provinces du Midi, et le plus ferme boulevard du parti protestant. Un commerce étendu avec l’Angleterre et l’Espagne y avait introduit des richesses considérables, et cet esprit d’indépendance qu’elles font naître et qu’elles soutiennent. Les bourgeois, pêcheurs ou matelots, souvent corsaires, familiarisés de bonne heure avec les dangers d’une vie aventureuse, possédaient une énergie qui leur tenait lieu de discipline et d’habitude de la guerre.
Aussi, à la nouvelle du massacre du 24 août, loin de s’abandonner à cette résignation stupide qui s’était emparée de la plupart des protestants et les avait fait désespérer de leur cause, les Rochelois furent animés de ce courage actif et redoutable que donne quelquefois le désespoir. D’un commun accord, ils résolurent de subir les dernières extrémités, plutôt que d’ouvrir leurs portes à un ennemi qui venait de leur donner une preuve si éclatante de sa mauvaise foi et de sa barbarie. Tandis que les ministres entretenaient ce zèle par leurs discours fanatiques, femmes, enfants, vieillards, travaillaient à l’envi à réparer les anciennes fortifications, à en élever de nouvelles. On ramassait des vivres et des armes, on équipait des barques et des navires; enfin, on ne perdait pas un moment pour organiser et préparer tous les moyens de défense dont la ville était susceptible. Plusieurs gentilshommes échappés au massacre se joignirent aux Rochelois, et, par le tableau qu’ils faisaient des crimes de la Saint-Barthélémy, donnaient du courage aux plus timides. Pour des hommes sauvés d’une mort qui semblait certaine, la guerre et ses hasards étaient comme un vent léger pour des matelots qui viennent d’échapper à une tempête. Mergy et son compagnon furent du nombre de ces réfugiés qui vinrent grossir les rangs des défenseurs de La Rochelle.
La cour de Paris, alarmée de ces préparatifs, se repentit de ne pas les avoir prévenus. Le maréchal de Biron s’approcha de la Rochelle, porteur des propositions d’accommodement. Le roi avait quelques raisons d’espérer que le choix de Biron serait agréable aux Rochelois; car ce maréchal, loin de prendre part aux massacres de la Saint-Barthélémy, avait sauvé plusieurs protestants de marque, et même avait pointé les canons de l’Arsenal, qu’il commandait, contre les assassins qui portaient les enseignes royales. Il ne demandait que d’être reçu dans la ville et reconnu en qualité de gouverneur pour le roi, promettant de respecter les privilèges et les franchises des habitants, et de leur laisser le libre exercice de leur religion. Mais, après l’assassinat de soixante mille protestants, pouvait-on croire encore aux promesses de Charles IX? D’ailleurs, pendant le cours même des négociations, les massacres continuaient à Bordeaux, les soldats de Biron pillaient le territoire de la Rochelle, et une flotte royale arrêtait les bâtiments marchands et bloquait le port.
Les Rochelois refusèrent de recevoir Biron, et répondirent qu’ils ne pourraient traiter avec le roi tant qu’il serait captif des Guises, soit qu’ils crussent ces derniers les seuls auteurs des maux que souffrait le calvinisme, soit que par cette fiction, depuis souvent répétée, ils voulussent rassurer la conscience de ceux qui auraient cru que la fidélité à leur roi devait l’emporter sur les intérêts de leur religion. Dès lors il n’y eut plus moyen de s’entendre. Le roi s’avisa d’un autre négociateur, et ce fut La Noue qu’il envoya. La Noue, surnommé Bras de Fer , à cause d’un bras postiche par lequel il avait remplacé celui qu’il avait perdu dans un combat, était un calviniste zélé, qui, dans les dernières guerres civiles, avait fait preuve d’un grand courage et de talents militaires.
L’Amiral, dont il était l’ami, n’avait pas eu de lieutenant plus habile ni plus dévoué. Au moment de la Saint-Barthélémy, il était dans les Pays-Bas, dirigeant les bandes sans discipline des Flamands insurgés contre la puissance espagnole. Trahi par la fortune, il avait été contraint de se rendre au duc d’Albe, qui l’avait assez bien traité. Depuis, et lorsque tant de sang versé eut excité quelques remords, Charles IX le réclama, et, contre toute attente, le reçut avec la plus grande affabilité. Ce prince, extrême en tout, accablait de caresses un protestant, et venait d’en faire égorger cent mille.
Читать дальше