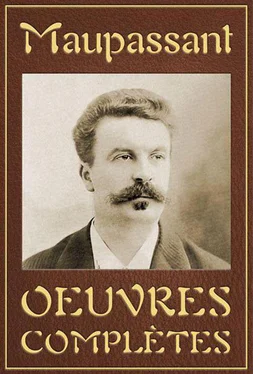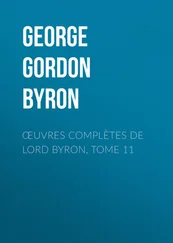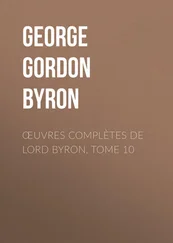Une femme apparaît, un autre enfant la suit, péniblement. Elle rejoint l’homme qui lui dit quelques mots rapides, un ordre sans doute ; puis il désaltère à son tour le second gamin, le prend, le couche, l’enveloppe et le case à côté du premier.
Le petit se laisse manier comme son frère, sans résistance, accoutumé à cet empaquetage, muet et docile dans les mains du père qui relève ensuite la bête à coups de pied et la met en marche en la poussant.
Et l’on ne se douterait guère, si l’on n’avait pas vu cela, que cette bosse de chameau emporte et balance, de son tranquille mouvement de vague, dans ces deux morceaux de toile rousse, deux petits êtres humains.
La femme s’est assise ; elle se repose et regarde partir sa famille. Elle a le visage nu, ce qui n’est pas surprenant chez les nomades pauvres, et même elle me parle en me voyant l’examiner. Cela est rare, très rare. Je tire de ma poche une pièce d’argent et je la lui donne ; sa joie est immense. Elle la manifeste par des rires, des mouvements de mains et des paroles expressives que je ne comprends pas, d’ailleurs. Puis elle se lève et s’en va, en se retournant encore pour me faire des gestes de reconnaissance. Et moi, je suis des yeux cette sauvage aux pommettes saillantes, et là-bas, sur la route conduisant au désert, les nomades qui s’en vont débandés. Ce n’est pas une tribu, mais un groupement de quelques familles assemblées pour chercher, selon les saisons, de quoi nourrir les bêtes et les gens.
Horde errante, étrange, sans cesse en quête de pâturages, ignorant la maison, notre domicile bâti sur la terre, elle porte ses demeures de toile sur les bosses de ses chameaux, les plante au soir, les enlève au matin, les déplaçant ainsi du nord au sud au gré des étés et des hivers, de la pluie qui fait pousser l’herbe, et du soleil qui la brûle.
Ils me font pitié, ils me font peine, ils me font plaisir aussi à voir, ces primitifs buveurs d’eau du Cheliff. Je ne vous regrette pas, aujourd’hui, fleuves d’Europe, fleuves de pêcheurs à la ligne, rivières à fleurs, à saules, à joncs et à nénuphars, cours d’eau gentils de poètes et d’amoureux.
La nuit suivante fut encore passée dans l’auberge de Boghari à entendre hurler les chiens sous les fenêtres. Au soleil levant j’étais debout, et je voulus revoir le Cheliff avant de partir pour la fête de Bou-Guezoul.
Ô stupeur, la plaine est verte. Une petite herbe minuscule et fine, à peine soupçonnable hier, faite d’aiguilles de gazon innombrablement pressées, a tant germé, pendant la nuit, sur toute cette campagne sèche et rouge, qu’elle l’a vêtue d’une mince toison de prairie, car elle a plutôt l’air, cette herbe, d’une espèce de poil de la terre que d’une végétation véritable.
Une fête arabe
( L’Écho de Paris , 13 avril 1891)
La Fête
C’est un vrai jour de l’été africain ; tout Boghari descend du ksar pour se rendre à Bou-Guezoul ; et les Ouled Naïl, couvertes de leurs bijoux, chamarrées d’étoffes éclatantes, petites pour la plupart, avec des têtes gentilles et douces, quand elles sont jeunes, horribles quand elles sont vieilles, se mêlent aux femmes des Arabes vêtues de blanc et voilées, et aux grands hommes drapés dans leurs burnous. Tout cela s’en va par groupes, en des voitures empruntées ou louées, inimaginables véhicules du désert, ou bien sur des chevaux aux jambes fines, sur des mulets, sur des bourricots trottinants.
Le long de la route on en aperçoit de tous côtés, sur la droite ou sur la gauche, se dirigeant vers le même point. Des troupes de cavaliers dessinent par places les fiers profils des Arabes à cheval. Ce sont des caïds entourés de leurs hommes. Le sol n’est plus couvert de la petite herbe de Boghari, et nous suivons une espèce de val, dont un horizon démesuré forme les bords et dont le vaste espace est coupaillé dans tous les sens par des montelets de rochers aux pointes rouges dressées sur le ciel comme des dents. Puis nous quittons la grand-route et tournons à droite pour suivre une ondulation qui nous conduit vers une hauteur, lointaine encore. Mais voilà qu’au sommet d’un de ces petits soulèvements qui ressemblent à des vagues et empêchent cette contrée d’être jamais unie, nous apercevons un goum qui accourt vers nous ventre à terre en jouant avec des cannes ou des cravaches, avec les longs fusils, au bout d’un bras levé.
Comme il arrive droit à nous, chargeant à fond de train, la troupe se divise, en nous enveloppant ; et les armes tonnent à nos oreilles ; les coups nous partent dans la figure tandis que les cavaliers aux burnous blancs, aux burnous rouges, aux burnous bleus nous frôlent au galop furieux de leurs chevaux. C’est un honneur qu’on nous rend, le commencement de la fantasia qui va durer jusqu’au soir.
Un affluent du Cheliff se présente à franchir. Des mulets et deux chameaux en grande tenue saharienne nous attendent pour ce passage, qui n’a pas trois mètres de large. Devant ce déploiement de pompe, on s’émerveille d’abord de l’hospitalité arabe, tandis que mon serviteur murmure derrière moi, avec son sourire goguenard : « Une planche là-dessus aurait été plus commode que cette ménagerie. » C’était si vrai que je me mis à rire.
Le fait lui donna raison.
Le premier chameau, portant deux dames, passa fort bien. Il balançait les voyageuses emprisonnées dans une hutte en tapis d’Orient, édifiée sur sa bosse, tandis qu’au-dessus de ce monumental animal, oscillait, comme un mât de navire dans la tempête, une immense perche honorifique faite de roseaux liés ensemble et qu’on appelle le bassour . Puis la bête continua sa route vers la kouba de Sidi Mohammed Bel-Kassem qu’on apercevait sur la hauteur prochaine.
La traversée du second chameau qui portait les suivantes des dames ne fut pas également heureuse. La bête fit un faux mouvement, et les Arabes affirment que ses passagères se mirent à crier. Alors le chameau, saisi de peur, lâché par ses conducteurs, détala avec de telles secousses que la tente aérienne finit par culbuter sur son flanc. Il en sortait des clameurs perçantes et des jambes levées au ciel.
A mesure que nous avancions sur la longue pente montant vers le marabout, un extraordinaire spectacle se déroulait à nos yeux. A perte de vue sur la gauche, le mirage apparaît ; une vision de marais et de roseaux dedans. Puis autour du mamelon couvert d’indigènes, auquel nous arrivions, dans la plaine étendue en cercle, dix-huit ou vingt tribus arabes étaient campées. Les tentes brunes, basses, presque rampantes, vrais champignons du sable, laissaient voir un peu seulement leur sommet pointu, et leurs arêtes inclinées et déjà, au-dessus de ces villages errants piqués là pour un jour, s’élevaient des fumées droites, de fines colonnes grises, dans l’air, transparente annonce des festins de kous-kous .
A travers ces campements, les chameaux rôdaient par groupes, profilant sur la terre nue leurs silhouettes invraisemblables, et devant nous la fête arabe faisait sonner son bruit sauvage de fusillade ininterrompue, de tambourins et de flûtes perçantes.
L’administrateur civil, M. Arnaud, et son adjoint, M. Chambige, qui nous ont invités et reçus, nous conduisent au milieu de la foule vers la tente préparée pour eux et pour nous. Elle a appartenu au sultan du Maroc et appartient maintenant à un caïd voisin qui l’a prêtée pour cette réjouissance. L’intérieur en est orné de décorations orientales en drap rouge. Entourée d’un peuple d’hommes en burnous, de femmes voilées et de courtisanes, elle nous sert d’abri contre le soleil dont la brûlure devient cuisante. Elle est ouverte au sud et au nord. D’un côté là-bas, vers le désert, c’est le paysage admirable de cette plaine éclatante de lumière, où les tribus sont reposées ; de l’autre, sur une lente montée de sol rouge vers une crête voisine hérissée de rocs, ce sont des centaines de cavaliers qui vont et viennent, au pas, au trot, au galop, le fusil à la main ou pendu sur la cuisse, une année-arabe en délire. Ils s’éloignent et vont se grouper là-bas, à mille mètres environ des tentes, car la nôtre n’est pas seule ; et la fantasia recommence pour nous.
Читать дальше