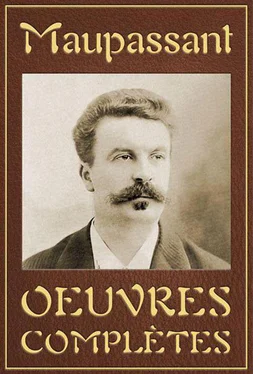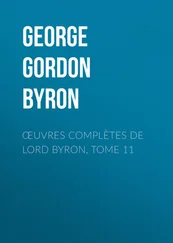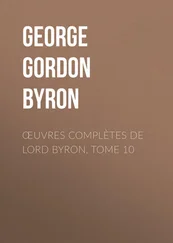FIN
Une fête arabe
( L’Écho de Paris , 7 avril 1891)
La Route
Le Duc de Bragance, un des transatlantiques du dernier type à grande vitesse qui font le service entre Marseille et Alger, glissait sur une mer sans rides, sous une lune claire que des nuages déchiquetés et festonnés voilaient et découvraient, déroulant une fantasmagorie d’effets lumineux et sombres dans l’infini pays des astres.
On appelle transatlantique du dernier type à grande vitesse un bateau mince et long, qui, par cela même qu’il est très rapide, secoue ses voyageurs d’une inimaginable façon dès que s’élève la moindre houle, les asphyxie, quand la mer est forte, dans ses flancs étroits chauffés comme une étuve par les chaudières, et offre aux voyageurs de première classe une salle à manger sur l’avant, admirablement exposée au tangage pour faciliter sans doute les économies de cuisine de la Compagnie. Ces économies, d’ailleurs, elle les pratique avec beaucoup d’adresse, car je n’ai jamais été plus mal nourri, même dans les trains de luxe, que sur ce bateau, et le pain qu’on vous y présente serait refusé par des mendiants.
Mais la mer est belle, tout unie, et, entre les nuages, tombe dessus une cendre de lumière lunaire éclatante et triste. Ces traînées d’argent sur l’eau s’effacent puis recommencent. Elles sont délicieuses, mystérieuses et mélancoliques. Quelque chose y manque pour moi, non pour mes yeux qui sont charmés, mais pour mon âme qui voudrait là quelque apparition surnaturelle. Laquelle ? Une seule, hélas impossible, disparue avec la Foi, celle de celui qui marchait sur les flots.
Je me mis à rêver à la terre que j’allais revoir et qui a mis en moi des désirs de retour dont je ne me croyais point capable. Les grands horizons nus, pierreux et jaunes où apparaît au loin, presque invisible, la tache blanche d’un Arabe qui pousse devant lui la forme plus haute, brune et bossue, d’un chameau, flottaient dans ma pensée, aveuglants de soleil. Je sentais déjà ma chair pénétrée et brûlée par ce souverain féroce qui règne sur l’Afrique, du haut du ciel, et j’avais envie d’être arrivé dans le port de la blanche Alger, afin d’en repartir pour les bords du désert.
Une dépêche m’attendait à l’hôtel, venue d’un fonctionnaire français, à qui j’avais été adressé et annoncé. Saharien fervent, administrateur de Boghari, il me faisait savoir qu’une fête arabe annuelle, d’une nature toute spéciale, allait avoir lieu près de Bou-Guezoul, sur la route de Laghouat, quelques jours plus tard.
Je me mis en route le lendemain pour refaire ce voyage si beau, que Fromentin a raconté, en coloriste incomparable. Un landau, le seul existant à Blida, paraît-il, nous attendait à la gare de la Chiffa. L’Atlas, immense barrière de montagnes, limitant vers le sud la plaine de la Mitidja et soutenant, sur ses reins de rochers soulevés, les hauts plateaux qui conduisent au désert, laisse voir de loin l’entaille gigantesque de la Chiffa, couloir tortueux et boisé par où passe la route de Médée, de Boghari et de Laghouat. Nous partons au train lent et ininterrompu de trois chevaux infatigables, qui graviront puis descendront, pendant plusieurs jours successifs, d’interminables montées, du même trottinement régulier qu’ils garderont aux descentes. Sur le dos du cocher, vêtu d’un veston de drap gris, une telle nuée de mouches s’installe et s’immobilise, qu’on dirait un enduit de grains volants collés sur lui.
Au moindre mouvement de nos ombrelles blanches, cette colonie ailée et vagabonde d’insectes noirs se dissipe dans l’air en une seconde avec la rapidité d’une disparition, puis elle revient aussi vite s’installer au grand soleil, sur le gros dos pacifique du gros homme qu’elle a choisi. Et elle nous suivra, sur ce dos de cocher, toujours plus nombreuse, d’étape en étape, d’auberge en auberge, l’innombrable foule aérienne et légère de petites bêtes tournoyantes qui vont ainsi n’importe où, avec n’importe qui, vers le désert ou vers la mer, au hasard des voitures qui passent.
Quand notre attelage eut gravi la longue vallée profonde de la Chiffa, nous arrivâmes dans les plaines cultivées qui forment le territoire de Médée. Je n’avais pas vu cette contrée depuis huit ans, et mon étonnement fut grand de traverser, avant comme après la ville, un superbe pays vignoble. Médée, vulgaire sous-préfecture de colonie, sans quartier original, sans caractère, sans grâce aucune, insinue par les yeux, dans le cœur et jusque dans la chair, toute la tristesse monotone, toute la mélancolie profonde que doit prendre la vie des exilés qui font du vin sur cette terre lointaine.
Ils s’enrichissent d’ailleurs, et les vendanges que nous voyons partout nous montrent l’admirable fertilité de ce terrain qui semble suer, comme des gouttes de sang, toutes ces grappes de raisin luisant et noir dont est garni chaque pied de vigne.
L’étonnante grosseur des grains et leur rougeur teintant de taches de meurtre les bras et les mains des vendangeurs font songer, dans ce décor de l’Atlas qui emplit l’horizon de sommets énormes, au beau sonnet de Louis Bouilhet :
« LE SANG DES GÉANTS
Quand les géants tordus sous la foudre qui gronde
Eurent enfin payé leurs complots hasardeux,
La terre but le sang qui stagnait autour deux
Comme un linceul de pourpre étalé sur le monde.
On dit que, prise alors, d’une pitié profonde,
Elle cria « Vengeance ! » et, pour punir les Dieux,
Fit du sable fumant sortir le cep joyeux
D’où l’orgueil indompté coule à flots comme une onde.
De là cette colère et ces fougueux transports
Dès que l’homme ici-bas goûte à ce sang des morts
Qui garde jusqu’à nous sa rancune éternelle.
Ô vigne, ton audace a gonflé nos poumons
Et sous ton noir ferment de haine originelle
Bout encor le désir d escalader les monts. »
Et les grands hommes maigres, arabes, moricauds et marocains à la peau brûlée par le soleil, aux membres empourprés par cette moisson de vins, circulent, la tête chargée de paniers qui portent des ivresses futures.
Nous avons passé la nuit à Médéah et nous en sommes repartis à trois heures de l’après-midi pour éviter le trop grand soleil et arriver à Boghari vers quatre ou cinq heures du matin, la distance étant de soixante-seize kilomètres.
La route gravit des montagnes aux plans démesurés ; la végétation disparaît ou plutôt ne se révèle plus que par petites plaques vertes sur les immenses ondulations de terre rousse, crevassée, pierreuse, soulevées en vagues gigantesques vers les cimes éloignées dont le soleil à son déclin colore les pentes des reflets du soir.
C’est un des plus vastes, des plus larges, des plus désolés paysages de cette contrée aux aspects changeants, féerie ininterrompue de lumières tombées du ciel sur des solitudes. Le soir de chez nous, c’est bien le soir, l’approche de la nuit, l’entrée de l’ombre ; mais le soir, en Afrique, devient souvent une fantastique aurore, aurore éblouissante et courte de lueurs roses qui se traînent et se promènent sur les lointains, dorées et changeantes, transformées sans cesse, passant en quelques minutes par tous les tons imaginables des roses. Puis elles s’éteignent peu à peu sur les crêtes, et finissent par s’effacer sous un voile gris léger, bleuâtre, qui enveloppe la terre entière, doux comme un adieu charmant du jour.
Читать дальше