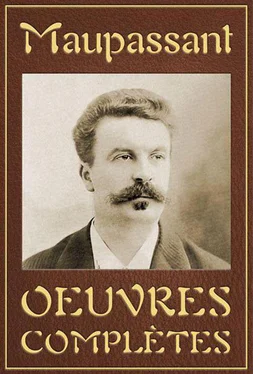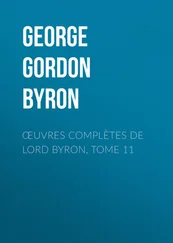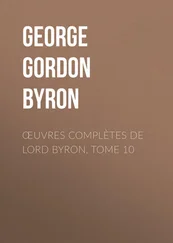Et voilà où apparaît toute l’attraction de ce livre inédit, c’est l’histoire d’un triomphateur à moitié barbare, d’une sorte de brute géniale, sainte et dépravée. On y trouve, on y comprend toutes les joies de ces grands vainqueurs à qui rien sur la terre ne fut refusé au milieu d’une civilisation brutale et raffinée, magnifique et corrompue.
Tout ce qui suivit ce mariage est d’un intérêt extrême, et la lutte imprévue du patriarche Polyeucte, interdisant à l’Empereur tout-puissant de franchir la très sainte porte médiane de l’Iconostase parce qu’il avait commis un crime canonique en contractant de secondes noces, est pleine de révélations particulièrement curieuses sur les doctrines religieuses d’alors. Ce Polyeucte apparaît comme un vrai prélat du Moyen Age, intraitable et brave, ne craignant rien et armé d’une piété et d’une foi de casuiste inexprimablement surprenantes. Il est enfin vaincu parce que tous les évêques de l’empire sont venus à Byzance pour le couronnement et pour demander des grâces.
D’innombrables détails sont amusants et curieux, en particulier tout ce qui concerne la si bizarre ambassade de l’évêque de Crémone Luitprand, envoyé près de Nicéphore par Othon Ier dit le Grand, empereur d’Allemagne. Puis la fin du volume est saisissante. On dirait un dénouement de Dumas père. L’impératrice, maltraitée et exaspérée par Nicéphore, conspire contre lui avec son amant Jean Tzimiscès, le plus brillant capitaine de l’armée byzantine, mis en disgrâce par le souverain. Et c’est un sombre assassinat de drame, un palais envahi la nuit, escaladé dans une tempête par les conjurés, cachés ensuite dans le gynécée impérial. Quand l’heure du meurtre est arrivée, ils ne trouvent pas l’Empereur dans son lit. Ils se croient dénoncés, perdus. On le découvre enfin. Inquiet, prévenu sans cesse des dangers qui le menacent, de plus en plus détaché d’un monde d’imposture et d’abjection, le rude maître de Byzance, après avoir longtemps prié, s’était couché sur une peau de tigre étendue su-dessous des images du Christ, de la Théotokos et du Précurseur, enveloppé simplement dans le vieux manteau du saint moine Michel Maleinos.
Pour la première fois de sa vie, il dormait sans avoir ses armes à ses côtés.
Le récit du crime est terrible. L’ayant découvert, les conjures se jettent ensemble sur lui et le frappent à grands coups de pied. Il se soulève, veut se défendre. Léon Balantès lui ouvre la tête qu’il avait nue, car son bonnet était tombé. L’arme trancha la face, coupant profondément le front, le sourcil et la paupière sans cependant fendre le crâne. Jean Tzimiscès regarde assis sur le lit, et injurie furieusement le souverain lié avec des cordes, qui roule sur le sol, ne pouvant plus rester debout. Le Basileus ne répond pas. Il appelle Dieu et la Théotokos à son aide. Tous, en l’insultant, lui arrachent la barbe et lui fracassent la mâchoire. On lui brise les dents à coups de pommeau d’épée. Et après l’avoir lardé de la tête aux talons, comme le palais s’éveille, un conjuré le transperce enfin de part en part.
C’est ainsi que mourut cet homme étrange et grand ; et c’est là que finit le livre si curieux, attrayant comme un conte d’Orient, qui nous révèle une Byzance inconnue.
Gustave Flaubert
( L’Écho de Paris , 24 novembre 1890)
J’ai publié déjà tout ce que je voulais dire de Gustave Flaubert comme écrivain. Je parlerai un peu de l’homme, mais comme il n’aimait les révélations d’aucune nature, je n’en ferai point sur lui d’indiscrètes. Je veux seulement, à l’heure où ses amis offrent à Rouen, qui fut sa patrie, l’œuvre remarquable de M. Chapu, montrer quelques côtés caractéristiques de sa nature. J’ai connu Flaubert très tard, bien que sa mère et ma grand-mère eussent été des amies d’enfance. Mais les circonstances éloignent les amis et séparent les familles. Je l’ai donc vu deux ou trois fois seulement pendant ma première jeunesse.
C’est après la guerre, quand je vins à Paris, devenu homme, que j’allai lui faire une visite, définitive dans nos relations, et dont le souvenir est resté en moi inoubliable.
Il a dit et il a écrit lui-même que son amour immodéré des lettres lui a été en partie insufflé, au commencement de sa vie, par son plus intime et plus cher ami, mort tout jeune, mon oncle, Alfred Le Poittevin, qui fut son premier guide dans cette route artiste, et pour ainsi dire le révélateur du mystère enivrant des Lettres. Je trouve dans sa correspondance avec moi, cette phrase :
« Ah ! Le Poittevin, quelles envolées dans le rêve il m’a fait faire ! J’ai connu tous les hommes remarquables de ce temps, ils m’ont semblé petits auprès de lui. »
Il avait gardé le culte, la religion de cette amitié.
Quand il me reçut il me dit, en m’examinant avec attention : « Tiens, comme vous ressemblez à mon pauvre Alfred. » Puis il reprit : « Au fait, ce n’est pas étonnant puisqu’il était le frère de votre mère ».
Il me fit asseoir et m’interrogea. Ma voix aussi, parait-il, avait des intonations toutes semblables à celles de la voix de mon oncle ; et tout à coup je vis les yeux de Flaubert pleins de larmes. Il se dressa, enveloppé des pieds à la tête dans cette grande robe brune à larges manches qui ressemblait à un froc de moine, et levant ses bras, il me dit d’une voix vibrante de l’émotion du passé :
« Embrassez-moi, mon garçon, ça me remue le cœur de vous voir. J’ai cru tout à l’heure que j’entendais parler Alfred. »
Et ce fut là certainement la cause vraie, profonde, de sa grande amitié pour moi.
Certes je lui ai rapporté toute sa jeunesse disparue, car élevé dans une famille qui fut presque la sienne, je lui rappelais toute une manière de penser, de sentir, même d’exprimer, des tics de langage dont quinze ans de sa vie première avaient été bercés.
J’étais pour lui une sorte d’apparition de l’Autrefois.
Il m’attira, m’aima. Ce fut parmi les êtres rencontrés un peu tard dans l’existence le seul dont je sentis l’affection profonde, dont l’attachement devint pour moi une sorte de tutelle intellectuelle, et qui eut sans cesse le souci de m’être bon, utile, de me donner tout ce qu’il me pouvait donner de son expérience, de son savoir, de ses trente-cinq ans de labeurs, d’études, et d’ivresse artiste.
Je le répète : ayant parlé ailleurs de l’écrivain, je n’en veux plus rien dire. Il faut lire ces hommes-là, et ne pas bavarder sur eux.
Je signalerai seulement deux traits de sa nature intime une vivacité naïve d’impressions et d’émotions que la vie n’émoussa jamais ; et une fidélité d’amour pour les siens, de dévouement pour ses amis, dont je n’ai jamais vu d’autre exemple.
Comme il avait l’horreur du bourgeois (et il le définissait ainsi : quiconque pense bassement) il passa parmi la plupart de ses contemporains pour une espèce de misanthrope féroce qui eût volontiers mangé du rentier à ses trois repas.
C’était au contraire un homme doux, mais de parole violente, et très tendre, bien que son cœur, je crois, n’eût jamais été ému profondément par une femme. On a beaucoup parlé, beaucoup émit sur sa correspondance publiée depuis sa mort, et les lecteurs des dernières lettres parues l’ont cru atteint d’une grande passion parce qu’elles sont pleines de littérature amoureuse. Il aima comme beaucoup de poètes, en se trompant sur celle qu’il aimait. Musset n’en fit-il pas autant ; celui-là au moins, fuyait avec Elle en Italie ou dans les Iles Espagnoles, ajoutant à sa passion insuffisante le décor du voyage, et le légendaire attrait de la solitude au loin. Flaubert préféra aimer tout seul, loin d’elle, et lui écrire, entouré de ses livres, entre deux pages de prose.
Читать дальше